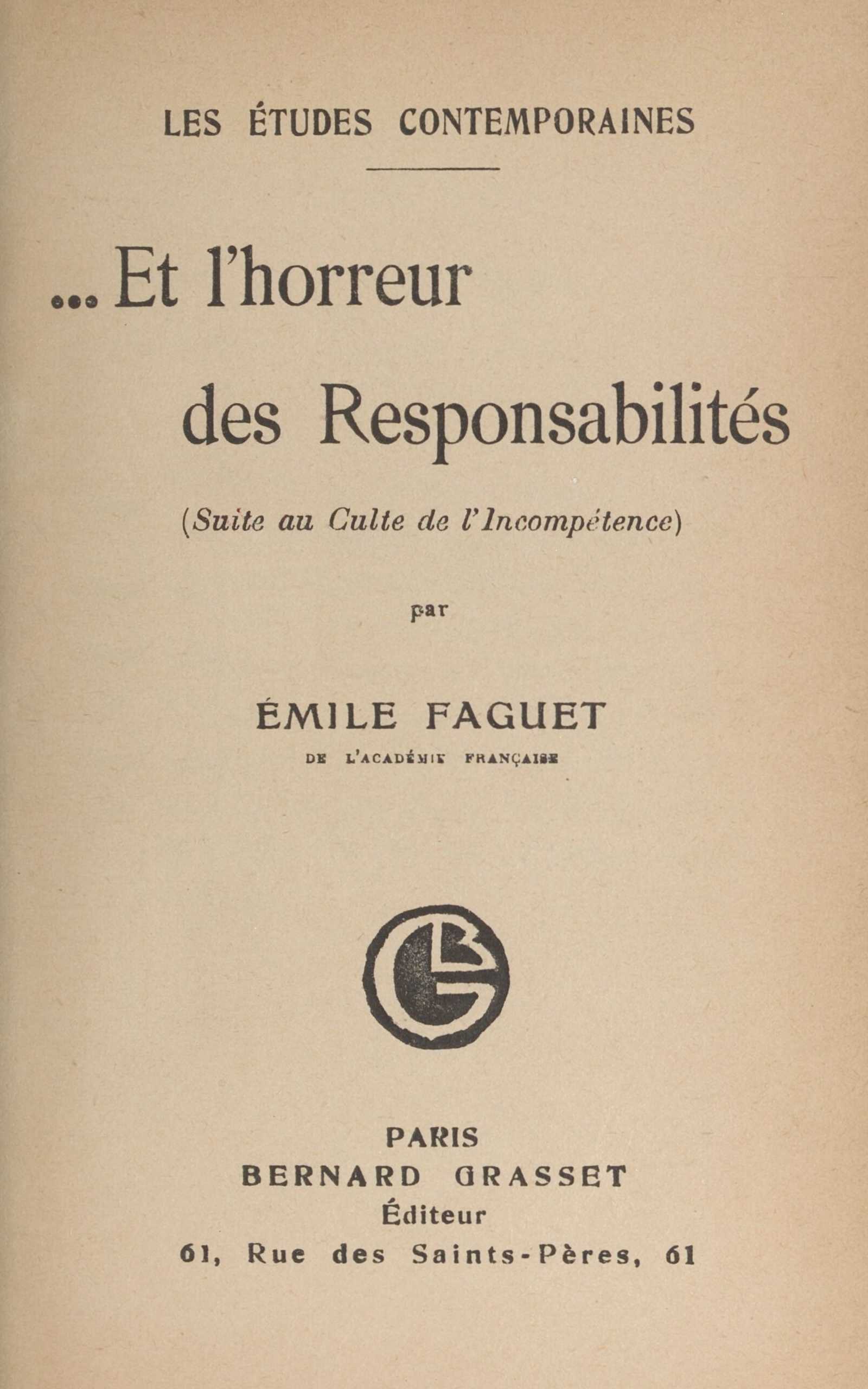
Title: ... Et l'horreur des responsabilités (suite au Culte de l'incompétence)
Author: Émile Faguet
Release date: October 22, 2025 [eBook #77110]
Language: French
Original publication: Paris: Bernard Grasset, 1929
Credits: Laurent Vogel (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))
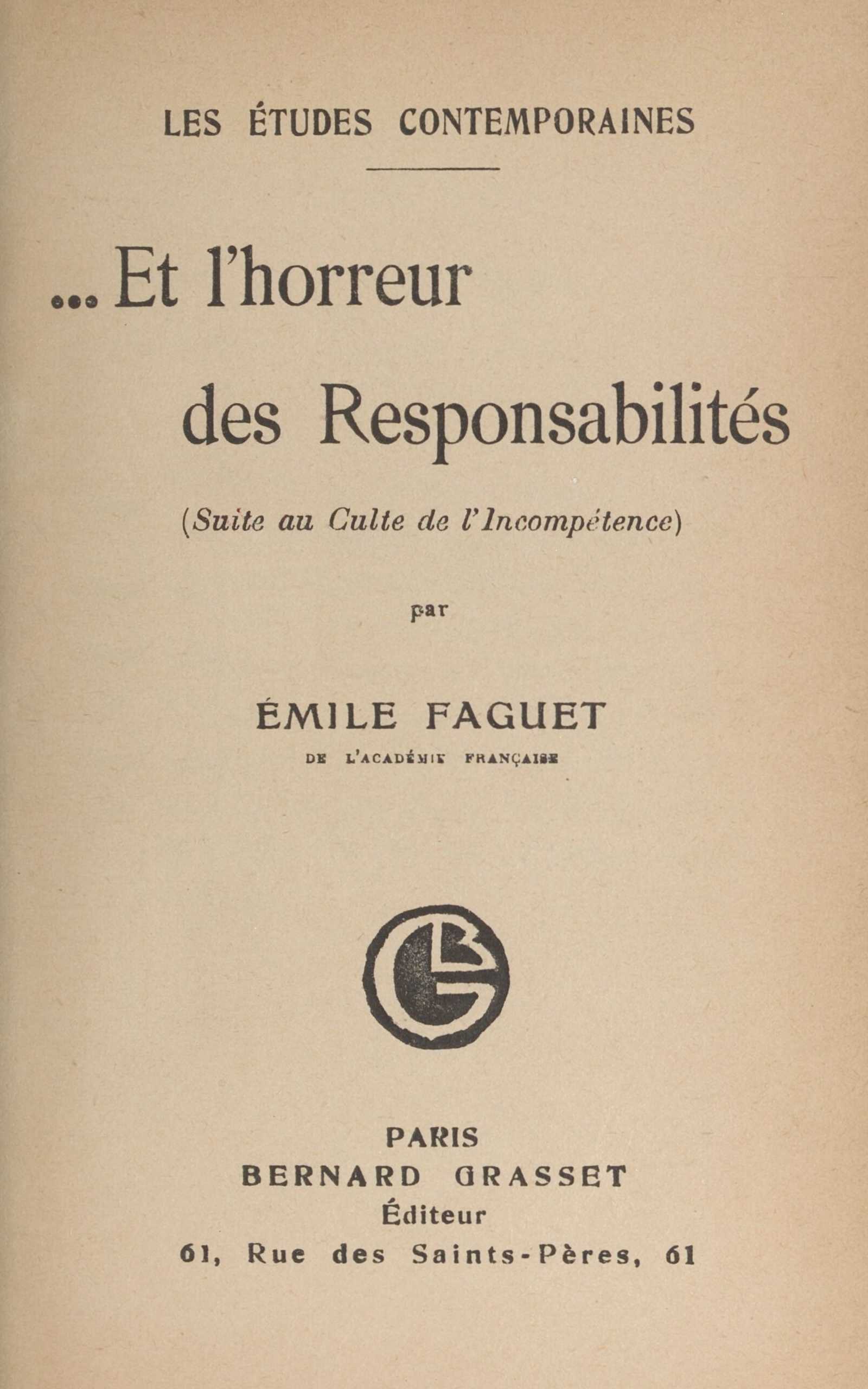
LES ÉTUDES CONTEMPORAINES
par
ÉMILE FAGUET
DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE
PARIS
BERNARD GRASSET
Éditeur
61, rue des Saints-Pères, 61
OUVRAGES PARUS DANS LA MÊME COLLECTION
… ET L’HORREUR DES RESPONSABILITÉS
(SUITE AU CULTE DE L’INCOMPÉTENCE)
Que veulent-ils être ? Irresponsables. C’est l’histoire même des Français depuis un siècle et ce sera leur histoire indéfiniment, à moins que ce livre ne les corrige, sur quoi je compte, mais peu. Ils veulent être irresponsables. Ils conduisent leurs idées juridiques selon ce dessein ; ils organisent leurs professions et ils les pratiquent dans cette vue ; ils ont une vie de famille gouvernée par cette pensée ; ils ont une vie sociale dirigée par ce principe.
Tout le système juridique et toute la coutume juridique du régime qui a suivi 1789 sont dominés par cette idée générale que celui qui juge soit irresponsable, et que l’on ne puisse rien lui reprocher. En effet : 1o Le juge ne juge point en équité, mais selon la loi ; autrement dit il n’est pas un juge, il est un greffier ; il est un homme qui, à propos d’un fait, dit la loi qui a prévu ce fait et qui s’y applique ; il est un homme qui ajuste un fait à la loi ce qui dit que la loi s’adapte exactement à ce fait, « couvre » ce fait, comme disent les Allemands et qui fait arrêt en conséquence.
Par suite, il est absolument irresponsable ; c’est la loi, ce n’est pas lui qui a fait arrêt ; l’arrêt est sorti de la loi, d’une manière pour ainsi dire automatique ; à qui peut s’en prendre le lésé ? Au juge, évidemment non ; à la loi tant qu’il voudra ; au juge, il est impossible ; le juge est strictement irresponsable.
Aimeriez-vous mieux, me dira-t-on, que le juge jugeât en équité, c’est-à-dire en arbitraire ? Ce serait beau ! Ne savez-vous point que les Savoyards ayant été réunis au royaume de France demandèrent pour première faveur au Roi de France de n’être plus jugés en équité, mais de l’être selon une loi et n’importe laquelle, très satisfaits pourvu que ce ne fût plus l’équité, toujours si parfaitement inéquitable ? Seriez-vous un disciple du président Magnaud, qui, de 1890 à 1900 environ, se rendit très célèbre et fit même des fanatiques par sa doctrine et son habitude de juger contre la loi et de substituer le juge à la loi toutes les fois que le juge, c’est-à-dire lui, considérait la loi comme mauvaise ? Êtes-vous contraire à ces maximes de Montesquieu : « Plus le gouvernement approche de la République, plus la façon de juger devient fixe. C’était un vice de la République de Lacédémone que les éphores jugeassent arbitrairement, sans qu’il y eût des lois pour les diriger. A Rome les premiers consuls jugèrent comme les éphores ; on en sentit les inconvénients et l’on fit des lois précises. Dans les États despotiques il n’y a point de loi ; le juge est lui-même sa règle. Dans les États monarchiques il y a une loi et là où elle est précise, le juge la suit et là où elle ne l’est pas il en cherche l’esprit. Dans le gouvernement républicain il est de la nature de la constitution que les juges suivent la lettre de la loi. Il n’y a point de citoyen contre lequel on puisse interpréter une loi quand il s’agit de ses biens, de son honneur ou de sa vie. »
Je ne songe nullement à vouloir ou à souhaiter que le juge juge en équité et je trouve très bon qu’il juge selon une loi précise. Je fais remarquer seulement que toute chose a son mauvais côté et que si juger sur texte a d’incomparables avantages et incomparables est le mot auquel je tiens, la pratique de juger sur texte a aussi cet inconvénient qu’elle décharge les juges de toute responsabilité morale. Elle leur laisse celle d’avoir ou de n’avoir pas compris la loi, d’avoir ou de n’avoir pas bien appliqué la loi au fait dont s’agissait, ou le fait dont s’agissait à la loi, ou de n’avoir pas bien observé les formes ; mais elle ne leur laisse que celle-ci. En un mot elle leur laisse une responsabilité intellectuelle ; elle les décharge de toute responsabilité morale ; et ceci est peut-être l’inconvénient d’un grand bien, mais c’est un bien grand inconvénient.
Dans l’Ancien Régime les lois étaient si compliquées et si confuses que, tout en s’appuyant sur la Loi et tout en se piquant très fort de ne s’appuyer que sur elle et, comme disait Montesquieu, de « n’avoir que des yeux », les juges jugeaient, dans une très large mesure, en équité. Il en résultait qu’ils avaient une très grande responsabilité morale. Ils étaient ce que sont encore les juges anglais. La loi anglaise n’est qu’une jurisprudence, qu’une collection de précédents. A travers ces précédents, souvent contradictoires, comme on peut penser, le juge anglais a une très grande latitude d’interprétation, de théorisation, de doctrination, s’inspirant des précédents, mais librement et sans aucune raison d’être servile. Car cette loi qu’ont faite ses prédécesseurs par les précédents qu’ils ont laissés, très légitimement il la fait à son tour par le jugement qu’il élabore et qu’il laissera derrière lui comme précédent. Au fond les juges anglais ont été législateurs et comme ils l’ont été, partiellement, mais dans une large mesure, le juge anglais continue de l’être.
Il ressemble assez, quoique je ne songe point à identifier, au préteur romain. Le préteur romain n’était pas seulement un homme qui disait le droit, il était un homme qui faisait le droit. En entrant en charge il publiait une espèce de manifeste législatif, edictum prœtoris, et il y énonçait les principes généraux de droit qu’il comptait suivre. Ils ont créé ainsi, successivement, tout un droit, c’est à savoir le droit prétorien, que l’on étudiait à Rome au temps d’Auguste et aux temps suivants jusqu’à Papinien, beaucoup plus que la législation des législateurs et qui était tout compte fait le vrai droit, d’où tout le droit romain codifié plus tard est sorti.
Je n’ai pas besoin de dire que le droit ainsi fait est le plus vivant, est le droit vivant, s’étant formé peu à peu des faits et de la raison humaine s’appliquant aux faits, éclairé par les faits antérieurs analogues ; et non pas issu de telle ou telle idée, souvent très a priorique, d’un législateur.
Tant y a que les préteurs romains étaient des juges-législateurs, des juges disant le droit et faisant le droit et que les juges anglais ne laissent pas de leur ressembler.
De tels juges ont une responsabilité énorme et se sentent une énorme responsabilité et sont maintenus dans le devoir de justice et dans la dignité du magistrat par le sentiment constant de cette responsabilité même. Ils sentent qu’ils jugent en équité, en équité éclairée par la connaissance d’une jurisprudence très étendue, très lointaine, très vénérable, très considérable, qu’il faut connaître et qu’en effet ils connaissent, ils consultent, ils considèrent et ils vénèrent ; mais enfin, pour part considérable aussi, en équité, c’est-à-dire en raison et en raison qui contribuera à faire le droit du pays qui leur est cher ; et ils sont traditionnistes de deux manières, ce qu’il faut être du reste sous peine de n’être traditionnistes qu’à moitié ; ils sont traditionnistes en arrière par toute la tradition qui aboutit à eux, traditionnistes en avant et dans l’avenir par la tradition qu’ils fondent.
Oui, tout cela doit très fortement développer et confirmer en eux le sentiment profond de la responsabilité.
Tels étaient les préteurs de Rome, tels les juges anglais, tels les juges de l’ancien régime français. Encore maintenant un juge très vertueux me disait :
Les textes sont si nombreux, si contradictoires et, malgré leur rigueur apparente, si malléables que l’on peut toujours juger en équité.
— Et on le fait.
— Jamais ; parce que, à juger en équité, on assume une responsabilité dont personne ne veut.
— A la bonne heure !
— Peut-être.
Cette terreur de la responsabilité on la voit bien dans le passage célèbre de Beccaria. Il est pour la littéralité du jugement, pour le juge jugeant par simple rapprochement du fait à juger et du texte de loi auquel il se rapporte, pour le juge qui n’a que des yeux. Bien, certes, et je ne songe pas à le contredire. Mais voyez comme il a peur de juger selon l’esprit de la loi et surtout pourquoi il en a peur : « Rien n’est plus dangereux que l’axiome communément répandu : « consulter l’esprit de la loi » ; adopter cet axiome, c’est rompre toutes les digues et jeter les lois au torrent des opinions. Chaque homme a sa manière de voir : l’esprit d’une loi est donc le résultat de la logique bonne ou mauvaise d’un juge, d’une digestion aisée ou pénible, de la faiblesse de l’accusé, de la violence des passions du magistrat, de ses relations avec l’offensé, enfin de toutes les petites causes qui changent les apparences et dénaturent les objets de l’homme. A adopter ce principe nous verrions l’esprit d’un citoyen changer de face en passant d’un tribunal à un autre et la vie des malheureux serait à la merci d’un faux raisonnement ou de la mauvaise humeur de son juge. Nous verrions les mêmes délits permis différemment en différents temps par le même tribunal, parce que, au lieu d’écouter la voix constante et invariable des lois, ils se livreraient à l’instabilité trompeuse des interprétations arbitraires. » Rien de plus juste et je répète que je préfère l’application passive de la loi et au jugement par équité et même au jugement selon l’esprit de la loi ; mais encore voyez bien ce que craint Beccaria, c’est l’intervention du juge dans le procès. Il veut qu’il ne soit qu’une machine enregistreuse, qu’il ne soit pas un homme qui raisonne, qui digère, qui a des passions, qui a des amitiés, qui change d’avis ; soit et très bien ; mais aussi qu’il ne soit pas un homme sensible aux nuances qu’il y a entre un délit et un autre délit qui, selon le texte de la loi est le même et qui n’est pas du tout le même aux yeux de la raison ; qu’il ne soit pas un homme pesant les circonstances, pesant le danger plus ou moins grand couru par la société ; qu’en un mot il ne soit pas un homme appréciant et qu’il ne soit qu’une mécanique collant des textes sur un cas.
Pourquoi ? Dans l’intérêt de l’accusé, répond la phrase de Beccaria. Il est possible, mais plus encore dans l’intérêt du juge qui est ainsi délivré et soulagé d’un grand poids, celui de juger. Que veulent-ils ? Être irresponsables.
Ajoutez ceci, sur quoi on trouvera que je me répète, sur quoi j’estime que je ne me répéterai jamais assez. Comment, en France, sont nommés les juges ? Par le Prince. Par qui payés ? Par le Prince. Par qui favorisés d’un avancement ou laissés indéfiniment dans des postes infimes ? Par le Prince. Donc « le fait du prince » c’est-à-dire les volontés du gouvernement les domine et ils jugent selon la volonté du gouvernement, sauf dans les causes dont le gouvernement se désintéresse et en France, il n’y a qu’un mot qui serve : on est jugé par le gouvernement.
Il n’en était pas de même sous l’ancien régime parce que les juges y étaient propriétaires de leurs charges et par conséquent indépendants ; car il n’y a guère d’autre moyen d’être indépendant que d’être propriétaire. La vénalité des charges c’était l’indépendance de la magistrature. On sait comment Montesquieu la défendait et comment Voltaire attaquait Montesquieu sur ce point. Montesquieu disait : « La vénalité des charges est bonne dans les États monarchiques parce qu’elle fait faire comme un métier de famille ce qu’on ne voudrait pas entreprendre par vertu… »
Voltaire s’écrie : « La fonction divine de rendre la justice, de disposer de la fortune et de la vie des hommes, un métier de famille ! »
A quoi je réponds : Ce n’est pas la principale raison que Montesquieu ait donnée de son opinion ; mais cette raison est déjà loin d’être méprisable au point de pouvoir être réfutée par un haussement d’épaules. Nous avons ici tout simplement l’idée aristocratique, à laquelle Voltaire, despotiste obstiné, n’a jamais rien compris. Montesquieu veut dire : la vénalité met une charge de judication dans une famille ; voilà des juges de pères en fils. Toute aristocratie repose sur cela. Chez les sénateurs romains, chez les sénateurs vénitiens la fonction divine de veiller aux intérêts de l’État est un métier de famille et c’est précisément pour cela qu’elle est bien remplie. S’étonnera-t-on que la fonction divine de se faire casser la figure sur les champs de bataille soit un métier de famille ? Elle n’est pourtant pas autre chose dans la noblesse française et elle est remplie d’une façon assez brillante. Il n’y a pas autre chose et il y a tout cela dans le mot de Montesquieu qui est le plus naturel du monde pour quiconque sait ce que c’est que l’aristocratie.
« Cette vénalité rend les ordres de l’État plus permanents, continue Montesquieu. Suidas dit très bien qu’Anastase avait fait de l’Empire une espèce d’aristocratie en vendant toutes les magistratures. » — Voltaire ne relève pas ces lignes, précisément parce qu’elles contiennent toute la pensée de Montesquieu et que c’est dans cette pensée que Voltaire ne peut pas entrer. Les ordres de l’État pour lui n’existent pas et ne doivent pas exister ; il ne doit y avoir qu’un roi absolu et des sujets égaux. Il va sans dire, par conséquent, que ce qui a créé un ordre de l’État qui est un frein aux fantaisies de l’absolutisme est pour Montesquieu une bonne chose, pour Voltaire une chose détestable ; et si Voltaire ne rapporte pas ce texte important c’est sans doute qu’il se dit : « Bon. Ceci c’est la marotte aristocratique de Montesquieu ; il n’y faut même pas faire attention. Passons. »
Et il était plus facile de passer que de discuter le fond même de la question, qui est ici, à savoir si le régime aristocratique est bon ou mauvais.
Montesquieu continue en reconnaissant que Platon ne peut pas souffrir cette vénalité et qu’il prétend qu’elle est comme si, dans son navire, on faisait pilote le plus riche ; mais, fait-il remarquer, Platon parle en citoyen d’une République et lui, Montesquieu, en sujet d’une monarchie : « Or dans une monarchie où, quand les charges ne se vendraient pas par un règlement public, l’indigence et l’avidité des courtisans les vendraient tout de même, le hasard donnera de meilleurs choix que ceux du Prince. »
Montesquieu touche ici le point juste, qui est celui-ci : il faut choisir entre la vénalité des charges et la vénalité des juges. Si le juge est propriétaire de sa charge il ne sera pas vénal ; si la charge lui est donnée, c’est lui qui le sera. D’abord, pour l’avoir, il sera souvent forcé de l’acheter, non pas du propriétaire, puisqu’il n’y en aura pas ; mais du ministre qui en disposera ou des gens ayant influence sur le même ministre qui en disposera ; ensuite, pour garder cette charge, ou pour en conquérir une plus belle et plus lucrative, il sera toujours à la disposition de ceux qui les donnent et son métier divin sera un métier de serviteur. Il faut choisir entre la vénalité des charges et la vénalité, (ou la servitude, ce qui est la même chose), des magistrats.
Voltaire répond, ce me semble, bien latéralement, comme il fait toujours parce que le fond des questions lui échappe ou parce que les approfondir répugne à son naturel léger : « Pourquoi la France est-elle la seule monarchie de l’Univers qui soit souillée de cet opprobre de la vénalité passée en loi de l’État ? Pourquoi cet étrange abus ne fut-il introduit qu’au bout de onze cents années ? On sait assez que ce monstre naquit d’un roi alors indigent et prodigue et de la vanité de quelques citoyens dont les pères avaient amassé de l’argent. On a toujours attaqué cet abus par des cris impuissants parce qu’il eût fallu rembourser les offices qu’on avait vendus. Il eût mieux valu mille fois, dit un sage jurisconsulte, vendre les trésors de tous les couvents et l’argenterie de toutes les églises que de vendre la justice. Lorsque François Premier prit la grille d’argent de Saint-Martin, il ne fit tort à personne ; Saint-Martin ne se plaignit point ; il se passa très bien de sa grille. Mais vendre publiquement la place du juge et faire jurer à ce juge qu’il ne l’a pas achetée c’est une sottise sacrilège qui a été une de nos modes. »
Soustraction faite des turlupinades, il n’y a que ceci dans ce texte : c’est une monstruosité de vendre la justice. Or c’est précisément ce que disait Montesquieu, qu’acheter le droit de rendre la justice était le moyen de ne pas la vendre, parce que si vous achetez le droit de la vendre vous êtes le propriétaire de ce droit et n’avez plus aucune raison de vendre vos arrêts et ne les vendrez point ; tandis que si vous n’êtes pas propriétaire de votre charge vous l’achetez sans cesse en rendant les arrêts que celui qui vous la donne désire qui soient rendus : vous l’achetez sans cesse en la payant en arrêts. Ou vénalité des charges, ou vénalité des juges.
Voltaire comprend si peu la question qu’il appelle vendre la justice ce qui précisément empêche que les arrêts soient à vendre.
Pour ce qui est de sa remarque très juste que la monarchie française était la seule en Europe où la magistrature fût propriétaire de ses offices, ce n’est pas une monstruosité, c’est une supériorité. Cela revient à dire que seule en Europe la magistrature française était un Ordre de l’État. Dans tous les autres pays la magistrature est un corps de fonctionnaires, comme les douaniers. Elle ne juge pas ; c’est le gouvernement qui juge par elle. Dans ces pays il n’y a pas séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire ; et donc (du moins d’après la Déclaration des droits de l’homme, de 1789, article 16) il y a despotisme. Mais justement pour Voltaire c’est le despotisme qui est le vrai. Sans doute et c’est ce qui le sépare de Montesquieu pour qui le despotisme est un monstre et qui, voyant dans l’indépendance de la magistrature un frein du despotisme, quelle que soit l’origine historique de cette indépendance, est satisfait que la magistrature soit indépendante.
Et que vous lui disiez avec scandale qu’il n’y a qu’en France qu’elle l’est, il serait capable de vous répondre que c’est en cela que la France est non pas le dernier pays de l’Europe, mais le premier.
— Le dernier ! s’écrierait Voltaire puisqu’il est celui où le despotisme est le plus endigué.
— Le premier ! répondrait Montesquieu, puisqu’il est celui où il y a le moins de despotisme.
Quand la discussion, ce qui est son seul effet, a ramené chacun des disputants très précisément au point de départ de toutes ces idées, à son premier principe, elle s’arrête.
Montesquieu, sur cette même question, ajoute encore quelque chose à quoi Voltaire n’a rien répondu : « Enfin la manière de s’avancer par les richesses inspire et entretient l’industrie, chose dont cette espèce de gouvernement [la monarchie] a grand besoin. Paresse de l’Espagne : on y donne tous les emplois. »
Ceci a besoin d’être expliqué parce que c’est mal écrit ; Montesquieu veut dire : un père est industriel et fait fortune ; il s’est appliqué à faire fortune, c’est pour acheter à son fils une charge de judicature et pour que son fils, ainsi, avançât dans la hiérarchie sociale. Voilà un joli stimulant à l’industrie. Dans les pays où l’on n’accède pas ainsi d’une classe à une classe supérieure, on ne travaille pas, on intrigue. Paresse de l’Espagne, les emplois y sont donnés ; dès lors on ne travaille pas pour les acheter ; on les demande.
Et comme il arrive à ceux qui ont toutes leurs idées à la fois, Montesquieu donne ici l’idée générale de tout le régime. Les pays les plus grands du monde sont ceux où il y a une aristocratie très traditionnelle mais toujours ouverte, sans cesse rajeunie par un afflux venant des parties actives et énergiques des classes inférieures. Or, en France, il y a trois aristocraties : la noblesse, la plus fermée, ouverte cependant, puisque le Roi peut créer des nobles et en crée ; le clergé, absolument ouvert puisqu’il se recrute, non par hérédité mais par cooptation, c’est-à-dire par une sorte d’hérédité élective ; la magistrature qui est moitié héréditaire, moitié achetable par gens qui auront gagné de l’argent en travaillant. Ces trois ordres aristocratiques forment ensemble une aristocratie qui, étant très ouverte, est une élite. Il n’y a pas de pays plus intelligemment et plus heureusement aristocratique que la France ; c’est le premier pays du monde.
Voilà à quoi Voltaire n’a pas répondu ; parce que dès qu’il s’agissait de doctrine aristocratique il ne comprenait plus rien. Mais on voit bien tout l’ensemble des idées de Montesquieu sur la vénalité des charges.
Mirabeau devait dire plus tard : « Il ne doit y avoir dans l’État que des mendiants, des voleurs et des salariés. » C’est la pure doctrine socialiste ; cela exclut le propriétaire et le travailleur indépendant ; il n’y aura plus de propriétaire ; car il n’est ni salarié, ni voleur, ni mendiant ; il n’y aura plus de travailleur indépendant ; il y aura des travailleurs mais ils seront des salariés de l’État. C’est à cette doctrine que Montesquieu répond d’avance : « Justement ! A moi qui ne suis pas socialiste, à moi qui ne veux pas d’un gouvernement qui fasse tout, qui puisse tout faire et de qui tout dépende, à moi qui veux un gouvernement limité et endigué par des volontés libres, il me faut des travailleurs indépendants qui visent à la propriété et qui y arrivent et qui, par elle, arrivent à des fonctions sociales conquises par eux et non données par l’État, indépendantes de lui. Par exemple, la magistrature conquise par l’industrie et le travail en est une. Mes magistrats, grand pouvoir social, ne seront ni mendiants, ni voleurs, ni salariés. Il m’importe qu’ils ne soient pas salariés, parce que s’ils étaient salariés ils seraient mendiants. Or des mendiants peuvent très bien juger ; mais dans les procès où le gouvernement sera en conflit avec un particulier les assistés du gouvernement jugeront peut-être avec une impartialité incomplète.
Ces idées de Montesquieu ont été, trois ans après la publication de l’Esprit des Lois, soutenues presque d’une façon originale et avec plus de vigueur précise que par Montesquieu lui-même, par un jeune homme qui devait avoir une destinée aventureuse et très traversée, mais qui, à vingt-cinq ans, promettait bien, Angliviel de La Beaumelle. Dans son premier ouvrage, Mes Pensées, La Beaumelle disait : « La vénalité des charges fit murmurer tous les bons Français. C’est l’avarice des princes et la nécessité du temps qui l’a introduite ; les mêmes causes l’ont étendue et la maintiennent. Je suis fâché pour l’honneur de la politique que ce n’en soit pas l’ouvrage ; ce serait un de ses chefs-d’œuvre. C’est une chose admirable qu’il y ait une nation où le droit de juger se vende et où les jugements ne s’achètent pas, où l’industrie soit encouragée par les emplois [le texte de Montesquieu reparaît] et où les emplois ne soient pas avilis [et ne puissent pas l’être, puisque le pouvoir n’a aucune prise sur eux]. Cette vénalité des charges de judicature est un des plus grands biens de la police de la France. »
La Révolution a annexé la magistrature au pouvoir central et c’est-à-dire qu’elle a supprimé cet ordre de l’État comme elle supprimait les deux centres et c’est-à-dire aussi qu’elle a décidé que désormais ce serait le pouvoir exécutif qui jugerait. C’était un grand progrès si c’est du côté du despotisme que nous nous dirigeons, ce que je crois ; c’était une grande régression si c’est la liberté qui est le but.
Or, pour revenir à cette question des responsabilités, dont nous ne nous sommes nullement éloignés, comme vous allez voir, au point de vue des responsabilités, qu’a fait ici le nouveau régime ? A une irresponsabilité il en a ajouté une autre. Les juges de l’ancien régime étaient moins couverts que ceux du nouveau, parce qu’ils jugeaient selon la loi, il est vrai, mais beaucoup moins strictement que ceux du nouveau régime, comme nous l’avons montré. Ceux du régime actuel sont absolument couverts par la loi, plus précise, moins multiple, moins susceptible d’interprétations ; ils doivent, simplement, dire le droit et c’est le droit qui est responsable. Or à cette irresponsabilité s’ajoute celle-ci, que, puisqu’ils sont le gouvernement jugeant, quand le gouvernement leur dit de juger de telle manière ils doivent juger de cette manière-là et c’est le gouvernement, non pas eux, qui est responsable.
On se rappelle ce haut magistrat qui, devant une commission de parlementaires, interrogé sur une opération de procédure parfaitement contraire à la loi, répondit : « Le fait du Prince ! » Il fut sévèrement jugé par l’opinion. Pourquoi ? Il n’avait fait que se décharger d’une responsabilité en replaçant la responsabilité là où elle est selon le régime. Il pouvait dire : « Nous avons reçu un ordre du gouvernement et nous avons obéi à cet ordre. C’est une félonie ? En quoi ? Sommes-nous un ordre de l’État ? Point du tout. Sommes-nous un corps intermédiaire, comme disait Montesquieu, entre le Prince et le peuple ? Point du tout. Sommes-nous le peuple lui-même jugeant, comme les Héliastes d’Athènes ? Point du tout. Sommes-nous délégués des Sénateurs ou des Chevaliers comme, successivement, à Rome, et par conséquent des représentants d’un ordre de l’État ? Nullement. Sommes-nous, comme à Rome encore, des préteurs, nommés par le peuple ? En aucune façon. Nous sommes nommés, payés, avancés ou laissés en arrière par le Gouvernement ; nous sommes des officiers de justice du gouvernement ; le gouvernement juge par nous ; nous ne sommes que des instruments ; quand il veut juger lui-même, c’est évidemment son droit et dès qu’il l’exerce nous n’avons qu’à nous taire. C’est ce que nous avons fait. Par la façon dont nous sommes faits ce que nous sommes, nous nous sentons absolument irresponsables. Du temps de la première dynastie en France, si le prévôt avait appelé quelqu’un à comparoir et qu’il ne fût pas venu il allait à lui et lui disait : « Je t’ai envoyé chercher et tu n’as pas daigné venir. Rends-moi raison de ce mépris » ; et l’on se battait. Voilà des gens qui se sentaient terriblement responsables. Savez-vous bien qu’il faudrait que nous agissions ainsi à l’égard du Gouvernement quand il commande et que nous n’avons pas son ordre pour agréable ? Et de quel droit ? Nous ne pouvons pas lui dire : « Qui t’a fait prince ? » et il peut nous dire : « Qui t’a fait juge ? » Nous sommes pouvoir dépendant, pouvoir de délégation, avec perpétuelle reprise possible de notre pouvoir par celui qui nous l’a prêté. Nous sommes dépendants par définition et par conséquent irresponsables, de quoi nous sommes charmés ; car nous n’avons pas le point d’honneur des prévôts du moyen âge. »
Un autre exemple de ce sentiment de leur irresponsabilité qu’ont évidemment les magistrats français dès qu’il s’agit d’une affaire où la politique est mêlée. Une « lettre » des évêques français aux fidèles (1910) déconseille l’école laïque aux familles pour beaucoup de raisons, entre autres pour celle-ci qu’il y a des écoles laïques où petits garçons et petites filles sont mêlés ensemble, tant en classe et en étude, qu’en récréation. Procès intenté à Mgr le Cardinal Luçon, signataire de cette lettre, par des sociétés d’instituteurs. Gain de cause des instituteurs en première instance ; appel ; la Cour d’appel, à savoir la Cour de Paris, 14 janvier 1911, condamne de nouveau le cardinal Luçon ; un de ses considérants est celui-ci : « Considérant qu’elles [les accusations contenues dans la lettre des évêques] ajoutent spécialement pour les écoles mixtes que le mélange des enfants des deux sexes y est admis, alors que l’appelant [le cardinal de Luçon] N’IGNORE POINT qu’en classe comme en récréation les jeunes garçons et les filles sont séparés, qu’aucune école n’est bâtie et acceptée sans remplir cette condition… »
Par le texte de ce considérant « alors qu’il n’ignore pas » la Cour de Paris taxait formellement Mgr le Cardinal Luçon de mensonge et elle le condamnait comme menteur.
Le journal La Croix fit immédiatement une enquête (janvier 1911) pour savoir s’il y avait réellement des écoles mixtes laïques où les sexes fussent mélangés. Elle n’en trouva guère que deux cents, qu’elle nomma, avec détails.
Détail curieux : précisément, dans la plupart des communes où le fait avait lieu les choses se passaient ainsi : l’instituteur prenait avec lui les grands garçons et les grandes filles et l’institutrice les petits garçons et les petites filles, de sorte que la répartition se faisait, comme si c’eût été à dessein, de manière que la cohabitation fût la plus dangereuse possible. Certes ce n’était qu’absurde, et sans mauvaise intention ; mais enfin c’était ainsi.
En tout cas la cohabitation existait et Mgr Luçon n’avait pas menti et la Cour de Paris l’avait faussement déclaré menteur. Avant de déclarer, si légèrement, Mgr Luçon menteur, que devait faire la Cour de Paris ? Une enquête pour savoir s’il avait menti, l’enquête même que le journal La Croix a faite depuis. Pourquoi n’a-t-elle pas fait cette enquête ? Pourquoi s’est-elle contentée évidemment, comme son texte l’indique, de plans de maison d’école que lui a passés le ministère de l’Instruction publique, comme si ces plans prouvaient quelque chose sur la façon dont on use des maisons bâties d’après eux ; comme si une partie de la maison étant réservée à l’institutrice et une autre à l’instituteur, l’instituteur ne pouvait pas prendre dans sa partie de maison tous les grands sans distinction de sexe et laisser à l’institutrice tous les petits sans distinction de sexe, ce qui est justement ce qui a été fait souvent ? Enfin pourquoi la Cour de Paris n’a-t-elle pas fait l’enquête et a-t-elle si légèrement proclamé menteur le cardinal Luçon ?
Parce que, quand il s’agit d’une affaire politique, la magistrature française ne se sent plus responsable. Pour elle, dans ces affaires-là, c’est le gouvernement qui doit juger et elle ne doit être que son tuyau acoustique.
Ici il me semble que nous saisissons cette pratique sur le fait ; car enfin on voit comment la Cour procède. Il y a une question de fait, donc il y a une enquête à faire ; elle ne la fait point ; mais, parce que c’est une affaire politique, elle la regarde comme concernant le gouvernement, elle dit : « c’est au gouvernement de parler » et elle consulte l’Instruction publique. L’Instruction publique répond : « légendes, fables, mythologie ; voici les plans de maison d’école ; vous voyez qu’il est matériellement impossible qu’il y ait cohabitation des deux sexes. » Évidemment, répond la Cour. Pourquoi dit-elle : « évidemment » ; pourquoi ne se demande-t-elle pas si, malgré les plans, il n’y a pas quelque part, réellement, une cohabitation théoriquement impossible ? Parce que, pour elle, le gouvernement a jugé ; il n’a pas, à ses yeux, fourni un renseignement ; il a jugé ; c’était une affaire politique, elle concernait le gouvernement et l’avis ou le désir, ou la velléité, ou la tendance du gouvernement était l’arrêt ; il n’y avait plus qu’à la rédiger. Mgr Luçon avait menti parce que le gouvernement semblait désirer qu’il fût déclaré que Mgr Luçon était menteur. L’irresponsabilité de la magistrature en toute affaire politique semble être un principe juridique pour la magistrature française des XIXe et XXe siècles.
Il y a plus — ou autant — dans cette même affaire. Mgr Luçon avait produit pour sa défense une consultation de maître Hannotin, avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation et c’est sur cette consultation même de maître Hannotin que l’arrêt de la Cour de Paris du 4 janvier 1911 s’appuie pour condamner Mgr Luçon. Et pour s’appuyer sur lui elle le cite et voici la manière dont elle s’appuie sur lui et le cite : « Considérant… qu’aussi bien la consultation produite en son nom [au nom de Mgr Luçon] proclame qu’à l’école du hameau les filles et les garçons sont soigneusement séparés ; qu’ainsi par cette pièce même du dossier la dénonciation [contenue dans la lettre des évêques relativement au mélange des deux sexes dans les écoles mixtes] est reconnue inexacte et injuste… » — Or maître Hannotin avait-il dit cela dans sa consultation ? Avait-il dit qu’à l’école du hameau les filles et les garçons sont soigneusement séparés ? S’il avait dit cela il aurait eu une singulière manière de défendre Mgr Luçon ; il aurait eu une singulière manière de plaider pour lui ; qu’aurait-il fait pour l’attaquer ? Mais enfin il est possible qu’il l’ait dit ; la force de la vérité arrache quelquefois un propos accusateur à qui veut défendre et un propos de justification à qui veut accuser ; il est possible qu’il l’ait dit, mais enfin l’a-t-il dit ?
Mon Dieu, il a dit exactement le contraire. Il a dit : « Ce que la lettre pastorale a en vue ce n’est pas l’école du hameau où un instituteur ou une institutrice enseigne à la fois les filles et les garçons soigneusement séparés les uns des autres, c’est l’école où volontairement, systématiquement… les deux sexes sont mélangés. » Voilà ce qu’avait dit maître Hannotin ; il avait mis de côté, par scrupule de précision et aussi de justice, les pauvres petites écoles de hameau où soit un instituteur soit une institutrice, faisant la classe à six petits garçons et quatre petites filles, est bien forcé de n’être qu’un, mais du reste peut maintenir, soit en classe, soit en récréation la séparation et la maintient en effet ; il avait visé les écoles, très nombreuses, ainsi que l’enquête de La Croix l’a prouvé, où volontairement, systématiquement, (pourquoi ? pour leurs convenances personnelles), instituteurs et institutrices, étant deux, mélangeant les sexes, l’institutrice prenant petits garçons et petites filles de très jeune âge, l’instituteur prenant petits garçons et petites filles d’âge plus avancé.
Or, que fait la Cour ? Elle isole le membre de phrase où maître Hannotin fait la concession qu’il devait faire ; elle ne tient pas compte du membre de phrase où est la critique ; et elle conclut qu’il a reconnu que dans les écoles les sexes sont rigoureusement séparés ; et elle fait entendre qu’il a reconnu que dans toutes les écoles les sexes sont rigoureusement séparés.
Notez encore que pour conclure ainsi et pour faire entendre ainsi, elle est forcée d’altérer le texte qu’elle met en guillemets, de sorte qu’il n’y a pas seulement citation tronquée mais citation altérée. Car comment cite-t-elle ? « à l’école du hameau les filles et les garçons sont soigneusement séparés. » Le texte de maître Hannotin était « ce que la lettre pastorale a en vue ce n’est pas l’école du hameau où un instituteur enseigne à la fois les filles et les garçons soigneusement séparés ; c’est l’école où… » le contraire a lieu. De sorte qu’à une forme verbale indiquant, par elle-même, qu’il y a des écoles irréprochables et qu’il y en a d’autres très condamnables, la Cour substitue une forme verbale qui affirme que toutes les écoles sont irréprochables.
Voilà comment par isolation d’un texte, puis, en surcroît, par altération d’un texte qu’on a déjà dénaturé en l’isolant, on arrive à faire dire non à quelqu’un qui a dit oui. Il y a des occasions, qui malheureusement se multiplient, où je regrette de n’être pas Pascal.
Or là-dessus certains s’indignent et crient que les magistrats français n’ont pas de sens moral. C’est une erreur complète, absolue. Ils ont autant de sens moral que quiconque ; mais ils ont une conception particulière de la magistrature. Ils considèrent la magistrature comme un organe du gouvernement, comme faisant partie de lui. Elle est nommée par le gouvernement, elle est payée par lui ; elle fait partie de lui ; elle est le gouvernement qui juge. Donc dans toute affaire où le gouvernement n’est pas engagé elle juge justement et juridiquement ; mais dans toute affaire où est engagé le gouvernement elle juge selon l’avis du gouvernement et après l’avoir préalablement demandé, reçu ou supposé ; ce n’est pas elle, selon elle, qui peut juger dans une telle affaire ; c’est directement le pouvoir prenant la magistrature pour simple porte-voix.
On objectera que c’est dire qu’on ne prend le gouvernement pour juge que quand il est juge et partie. Mais précisément ! Quand il n’est pas partie il peut laisser d’autres juges à sa place, mais quand il est partie il juge lui-même, parce que d’autres pourraient lui donner tort, ce qui est inadmissible. Qui dit cela ? Moi, magistrature, qui faisant partie du gouvernement n’admets pas que le gouvernement ait jamais tort, parce que le gouvernement c’est moi. On ne peut pas me demander de me condamner moi-même.
— Mais il s’ensuit que dans toute affaire où un individu ou groupe d’individus est contre l’État, il est condamné d’avance.
— Évidemment.
— Ne vaudrait-il pas mieux qu’il en fût autrement ?
— Peut-être, mais pour qu’il en pût être d’autre sorte il faudrait avoir institué un pouvoir entre l’État et l’individu. Or c’est ce qui n’existe pas. Ce qu’on a institué c’est la confusion du judiciaire et de l’exécutif ; ce que l’on a institué c’est l’exécutif jugeant. Eh bien, il juge très bien dans toute affaire qui ne le touche pas et dans toute affaire qui le touche il juge pour lui. Et nous, étant confondus avec lui, étant lui, nous le prions purement et simplement de juger à notre place. Et qu’on ne nous reproche pas, ce qui serait jeu puéril de petits journalistes, les singularités de nos considérants quand il s’agit d’affaires politiques. Dès qu’il s’agit d’affaires où le gouvernement est engagé, comprenez donc que nous ne sommes plus des magistrats, nous sommes des gens du roi, des gens du prince, nous sommes le gouvernement jugeant, c’est-à-dire se défendant ; et nos considérants ne sont plus que des discours de ministre sans portefeuille défendant la politique du ministère dont il fait partie et à qui l’on n’ira pas sans doute reprocher ses parologismes, ses sophismes, ses citations tronquées, ses altérations de textes et ses inversions.
Voilà qui est très bien raisonné, mais qu’est-ce que c’est ? C’est la responsabilité judiciaire transportée par les juges, très allègrement, de la tête des juges sur la tête du gouvernement, tout au moins pour toutes affaires où le gouvernement est intéressé. Une responsabilité de moins voilà le gain, sur ce point, de la magistrature moderne relativement à la magistrature d’ancien régime.
Remarquez, si vous vous souvenez de ce que nous avons dit plus haut, que cela fait deux responsabilités de moins. Donc, pour ce qui est du pouvoir judiciaire deux irresponsabilités : irresponsabilité pour cause de stricte application de la loi, pour cause de justice automatique ; irresponsabilité pour cause de dépendance, de non autonomie du côté du pouvoir central.
Comme il devait arriver, il advient que ces deux irresponsabilités se superposent, se surajoutent l’une à l’autre. Il arrive aussi qu’elles entrent en conflit. Conflit d’irresponsabilités, conflit, non de devoirs, mais de non-devoirs, cela est curieux. Cela s’est vu parfaitement. En juillet 1906 la cour de cassation a à juger une fois de plus l’affaire du capitaine Dreyfus. D’après la loi elle ne peut, si elle le trouve mal jugé par le second conseil de guerre, que le renvoyer devant un troisième conseil de guerre. Il existe bien un article (445 du Code d’instruction criminelle) qui admet cassation sans renvoi ; mais il ne s’applique, quand il s’agit d’un condamné vivant encore, qu’au cas où de l’affaire il n’existe plus rien qui puisse être qualifié crime ou délit. Par exemple, si j’ai été accusé d’avoir tué Paul et condamné pour cela et s’il a été prouvé depuis que Paul s’est donné la mort, il ne subsiste plus rien qui, à mon égard ou à l’égard de qui que ce soit, puisse être qualifié crime ou délit. Or cet article ne s’appliquait pas à l’affaire Dreyfus, puisque, que M. Dreyfus fût innocent, il était possible ; mais qu’il y eût eu un acte de trahison en 1894 ce n’était pas contestable ni contesté et cela subsistait. Et d’autre part M. Dreyfus étant vivant, l’exception marquée par l’article 445 n’existait pas.
Et pour toutes ces raisons légalement la Cour de cassation ne pouvait qu’envoyer M. Dreyfus devant un troisième Conseil de guerre. C’est ce qu’avait dit, lors de la première révision, le procureur général Manau, quoique favorable à M. Dreyfus : « Pour qu’il fût possible à nous d’abord [ministère public], à vous ensuite [juges] de proclamer [nous-mêmes, hic et nunc] l’innocence de Dreyfus, IL FAUDRAIT QUE DREYFUS FÛT MORT… La loi ne laisse aucun doute à cet égard. Il suffit de la connaître et pour la connaître, de la lire. »
La Cour de cassation ne pouvait donc que ne pas casser, ou casser avec renvoi.
Mais le gouvernement en avait assez de cette interminable affaire et n’eut même pas besoin de le dire à la Cour de cassation ; la Cour de cassation le savait comme tout le monde.
Or voyez-vous le conflit des deux irresponsabilités ? Si la Cour se conforme à la loi, elle est irresponsable : « Je suis couverte par la loi ; prenez-vous-en à la loi ; de ce que je décide je me lave les mains ; car c’est la loi, non moi qui décide. » — Si la Cour, obéissant au gouvernement ou aux désirs du gouvernement, n’obéit pas à la loi, elle est irresponsable tout de même : « Je suis agent du gouvernement ; je me lave les mains de ce que je décide ; c’est lui qui juge par ma bouche, ce n’est pas moi. »
— Mais il fausse la loi, ce qui n’est pas plus permis à lui qu’à vous, puisqu’il n’est permis à personne.
— Il se peut ; mais dites-le, non à moi, mais à lui.
La Cour était donc bien à son aise… Mais pas du tout ; parce que dans cet étrange conflit, si elle avait irresponsabilité de tous les côtés il fallait cependant que, dans la forme, elle contentât tout le monde, la loi et le prince ; car, encore que la magistrature, dans le nouveau régime, ne soit qu’agent du prince, il faut, selon la loi, qu’elle juge selon texte de loi.
Alors, voulant casser sans renvoi, bien que d’après la loi elle ne pût casser qu’avec renvoi, elle a imaginé, pour casser sans renvoi, de s’appuyer sur le texte même par lequel la loi l’interdisait. Mais il fallait pour cela le fausser. C’est ce qu’elle a fait d’une manière très ingénieuse. Au lieu de citer l’article 445 comme il est : « Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse plus rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit aucun renvoi ne sera prononcé », elle le vise ainsi : « Si l’annulation de l’arrêt ne laisse rien subsister qui puisse à la charge du condamné être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé. » — Vous voyez les différences. D’abord il y a dans le texte de l’arrêt : « A la charge du condamné », au lieu de : « A l’égard d’un condamné vivant », ce qui n’est pas du tout la même chose.
Par la suppression de vivant le rédacteur a sans doute voulu écarter l’esprit du lecteur de cette idée qu’il fallait, pour que fût possible cassation sans renvoi, que Dreyfus fût mort.
Par le changement de « à l’égard » en « à la charge » le rédacteur a voulu éviter cette tournure peu française « être qualifié crime ou délit à l’égard de », tournure où l’amenait sa nouvelle façon de disposer les morceaux du texte ; il a voulu surtout bien indiquer que rien à son avis ne subsistait chargeant M. Dreyfus.
Mais ces infidélités au texte sont encore légères. La plus grave, l’essentielle c’est celle qui a consisté à mettre les mots « à l’égard du condamné » après les mots « ne laisse rien subsister qui puisse » au lieu de les laisser avant, comme ils y sont dans le texte de la loi. C’est un invertatur, comme on dit en langue typographique. Or un invertatur peut ne rien changer au sens d’une phrase, comme dans « blanc bonnet » et « bonnet blanc » ; mais il peut la changer du tout au tout et c’est ce qui a lieu ici.
Dans « si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit », « à l’égard d’un condamné » se rapporte à arrêt et la phrase veut dire : « Si on annule un arrêt concernant un condamné vivant et s’il ne subsiste plus rien qui soit crime, rien du tout, à la charge de qui que ce soit. »
Dans « si l’annulation de l’arrêt ne laisse plus rien subsister à l’égard du condamné qui puisse être qualifié crime ou délit », « à l’égard du condamné » se rapporte à subsister et cela veut dire : « Si l’accusé n’est plus considéré par nous comme coupable. »
Les deux sens sont à cent lieues l’un de l’autre, si bien que celui de la loi défend de casser sans renvoi et que le texte adopté par la Cour le permet ; et cela par une simple inversion. C’est le triomphe de la prestidigitation verbale ; les membres de la Cour de cassation de juillet 1906 devaient être d’incomparables joueurs de puzzle.
Il y a eu contestation sur ce point. M. Armand Charpentier (Annales de la Jeunesse Laïque de mars 1911) écrit : « Pour pouvoir accuser de faux les magistrats de la Cour de cassation, l’Action Française leur attribue faussement un texte fabriqué pour elle. Voici en effet ce que dans son ridicule langage l’Action Française appelle « le Talisman » :
Article 445
Texte du Code. |
Texte inexistant visé par la Cour. |
| Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant, ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé. | Si l’annulation de l’arrêt ne laisse rien subsister qui puisse, à la charge du condamné, être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé. |
« A gauche sont transcrits en lettres italiques les sept mots inscrits dans le texte du Code et que la Cour de cassation a supprimés. A droite sont transcrits les mots que la Cour a ajoutés à un autre endroit du texte. »
« Or, écrit M. Charpentier, voici le seul passage de l’arrêt de la Cour où se trouve cité le texte de l’article en question : « Attendu que de l’ensemble des moyens de révision qui précèdent… il résulte que des faits nouveaux ou des pièces inconnues du Conseil de guerre sont de nature à établir l’innocence du condamné… et qu’il y a lieu de rechercher, au fond, s’il faut, dans la cause, appliquer le paragraphe final de l’article 445 du Code d’instruction criminelle aux termes duquel, si l’annulation prononcée à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé. »
« Il suffit, reprend M. Charpentier, de se reporter à la colonne de gauche pour voir que cette citation est scrupuleusement exacte. C’est l’Action Française QUI A COMMIS LE FAUX QU’ELLE ATTRIBUE A LA COUR DE CASSATION. »
Il est parfaitement exact que dans le corps de son arrêt la Cour a cité le texte de la loi comme le cite à son tour M. Charpentier. Mais il est parfaitement exact aussi qu’à la fin de son arrêt la Cour vise cet arrêt et s’appuie sur lui en le rappelant ainsi : « Attendu, en dernière analyse, que de l’accusation portée contre Dreyfus rien ne reste debout ; et que l’annulation du jugement du Conseil de guerre ne laisse rien subsister qui puisse à sa charge être qualifié crime ou délit ; Attendu dès lors que, par application du paragraphe 445 aucun renvoi ne doit être prononcé… »
D’où il appert que la Cour de cassation a cité deux fois le texte du 445 : une première fois très fidèlement, une seconde fois et quand elle s’appuie sur lui pour sa décision, en l’altérant. On dirait qu’elle a voulu montrer elle-même, par ces deux citations, comment elle aurait dû juger d’après la loi et comment elle jugeait contre elle. Et, au fond, c’est mon avis et c’est dans mon système : la Cour aura voulu montrer qu’elle connaissait très bien la loi, qu’elle l’avait devant elle, qu’elle la lisait et qu’elle jugeait contre elle par raison d’État. Et cette interprétation que je fais est certainement celle qui lui est le plus favorable.
Un détail curieux : La Gazette des Tribunaux rapportant l’arrêt, le fait précéder (c’est pour la Jurisprudence) de cet esprit de l’arrêt, de cet axiome, je ne sais pas trop comment il faut dire : « Lorsque l’annulation d’une décision dont la révision est demandée ne laisse rien subsister, qui puisse, à la charge du condamné, être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne doit être prononcé par la Cour de cassation aux termes du paragraphe final de l’article 445 du Code d’instruction criminelle. » — De sorte que c’est le texte vrai de l’article 445 qui reste enfoui dans un coin de l’arrêt du 12 juillet 1906, et qui du reste demeure dans la loi ; mais c’est le texte altéré qui fera jurisprudence. Cela peut faire rire Héraclite.
Tant y a que la Cour a appliqué une loi qu’elle inventait. Les défenseurs eux-mêmes de M. Dreyfus le reconnaissent et disent seulement, peut-être avec raison, qu’il fallait faire l’apaisement et que la Cour de cassation a ainsi réussi à le faire. Il est possible. Son arrêt ayant, à la vérité, ravivé les polémiques, mais évité un troisième procès public en Conseil de guerre, il a peut-être un peu plus favorisé l’apaisement qu’il ne lui a été contraire.
Seulement, ce qui n’était peut-être pas le but poursuivi : 1o il a laissé ouverte, pour toute la suite des temps, pour toute l’histoire, au lieu de la clore, l’affaire Dreyfus ; 2o il a condamné M. Dreyfus.
Il a laissé ouverte, au lieu de la clore, pour toute l’histoire, l’affaire Dreyfus. En effet éternellement on pourra dire : M. Dreyfus a été condamné par deux Conseils de guerre, d’autre part envoyé en révision par un arrêt de la Cour de cassation, puis acquitté par la Cour de cassation mais par altération avérée de la loi ; les choses sont au moins en balance ; l’affaire reste ouverte ; elle peut être discutée indéfiniment. Et en effet mon opinion est qu’elle le sera indéfiniment et que c’est bien légitimement, d’après le dernier arrêt même de la Cour de cassation et la façon dont il a été rédigé, qu’elle le sera.
Et la Cour de cassation par son dernier arrêt a condamné M. Dreyfus. Oui, certainement ; car par son arrêt, contraire à l’esprit et à la lettre de la loi et imposé par la seule volonté que M. Dreyfus ne passât point devant un troisième Conseil de guerre ; d’une part elle a déclaré que la cassation sans renvoi ne pouvait être faite que par une altération de la loi, ce qui est une condamnation morale très précise ; d’autre part elle a déclaré qu’à quelque Conseil de guerre que fût renvoyé M. Dreyfus, elle estimait qu’infailliblement il serait condamné de nouveau, ce qui est une condamnation morale assez précise encore.
Par son arrêt la Cour de cassation dit très nettement : « La loi veut que M. Dreyfus soit encore jugé par un Conseil de guerre ; mais comme il serait condamné encore par tous les Conseils de guerre, je l’acquitte moi, contre la loi. » C’est une condamnation éclatante.
Si éclatante, remarquez-le, que M. Dreyfus n’a été condamné que par deux Conseils de guerre et que par son arrêt la Cour de cassation le donne comme devant être condamné par tous les Conseils de guerre possibles, puisque, pour ne pas le renvoyer devant quelque Conseil de guerre que ce soit, elle l’acquitte. Elle aurait voulu dire : « Je proclame que M. Dreyfus sera toujours condamné » qu’elle ne s’y serait pas prise autrement. Un humoriste dirait : « La Cour de cassation était animée des plus mauvaises intentions du monde contre M. Dreyfus ; car elle a crié à l’univers par son arrêt qu’il n’était pas possible que M. Dreyfus fût acquitté. »
Ce n’est pas cela ; et la Cour n’avait pas de mauvaises dispositions à l’endroit de M. Dreyfus ; mais il faut avouer qu’on pourrait le croire. Toujours est-il qu’elle l’a moralement condamné autant qu’il pouvait l’être.
Cela est si vrai que, comme on sait, les gens pacifiques ont été contents de l’arrêt ; mais les Dreyfusistes purs en ont été très choqués. Ils ont bien senti ce que je viens de dire et que l’affaire n’était que rouverte, sans désormais pouvoir être close ; et que l’acquittement avec de pareils artifices et un pareil aveu qu’il n’était possible qu’ainsi procuré, était une condamnation assez cruelle. L’arrêt du 12 juillet 1906 est une prestidigitation juridique et de plus une incomparable maladresse.
Or cette contorsion juridique et cette maladresse est-ce la Cour de cassation qui les a commises ? Pas le moins du monde. C’est le gouvernement. C’est le gouvernement qui, dès le mois de juillet 1899, avait dans son dessein d’imposer aux juges de M. Dreyfus, quels qu’ils fussent, un verdict d’acquittement, comme il résulte de cette lettre de M. de Galliffet, ministre de la Guerre, à M. Waldeck-Rousseau, président du Conseil : « Lundi, 10 juillet 1899. Mon cher président et ami, vous avez trouvé trop « ouvertes » [d’après le contexte, veut dire probablement : laissant trop le champ libre] les instructions que j’étais disposé à donner au commissaire du gouvernement près le Conseil de guerre de Rennes ; je les trouvais, moi, trop fermées [probablement : trop strictes]. Depuis deux jours toute mon attention a été portée sur cette affaire et pour des raisons que je vous expose sur cette lettre j’ai résolu de n’envoyer aucune instruction, ce qui est conforme aux usages et qui a été pratiqué lors du procès Bazaine par exemple. Croyez-moi quand je vous affirme que ce qui serait utile à l’égard des magistrats de l’ordre civil est nuisible quand il s’agit de commissions du gouvernement, de présidents du Conseil de guerre et de juges militaires… Si nous nous mêlons de l’affaire en quoi que ce soit je suis convaincu que nous aurons préparé une condamnation. J’en suis tellement certain que je me garderai bien d’y travailler. Les juges du Conseil de guerre ainsi que le commissaire du gouvernement ont été chapitrés par leurs camarades. « Ne tenez compte d’aucun conseil, d’aucun ordre, leur a-t-on dit, ce serait autant de pièges tendus par le gouvernement ! » Ils sont tous, sous ce rapport, hors de leur assiette. Nos instructions ne resteraient pas secrètes ; elles seraient publiées, commentées, décrites, et le commissaire du gouvernement n’en tiendrait aucun compte. Il est un homme parti pour la gloire et se fera un piédestal de toutes nos instructions qu’il aura foulées bruyamment de ses deux pieds. Nous ne pouvons pas le changer en ce moment. Je n’ai aucune idée des règles de la jurisprudence ; mais quelque connaissance des différents états d’âme des officiers… Je termine vous affirmant que si nous parlons et si nous écrivons la condamnation deviendra certaine… — Galliffet. »
Cette lettre historique prouve bien des choses. Elle prouve d’abord que le gouvernement de 1899 avait voulu exercer une pression, non seulement sur son commissaire auprès du Conseil de guerre, ce qui était parfaitement légitime, mais sur le président du Conseil de guerre et sur les juges de ce Conseil, puisque M. de Galliffet dit à M. Waldeck-Rousseau : « croyez-moi… » notre intervention serait nuisible auprès de « commissaire du gouvernement, président de Conseil de guerre, juges militaires » ; donc M. Waldeck-Rousseau avait été d’avis, et assez énergiquement, d’une intervention auprès du commissaire du gouvernement et même du président et des juges.
Cette lettre prouve d’abord cela, qui, à la vérité, n’avait pas besoin d’être prouvé. Ce que M. de Galliffet disait de son commissaire du gouvernement, M. Waldeck-Rousseau a dû le dire avec quelque amertume de M. de Galliffet. « Je ne puis pas le changer maintenant. »
Cette lettre prouve ensuite que, malgré leurs divergences, M. Waldeck-Rousseau et M. de Galliffet sont parfaitement d’accord en ceci que cette intervention du gouvernement auprès de ceux qui jugent, que le fait du prince « SERAIT TRÈS UTILE AUPRÈS DES MAGISTRATS DE L’ORDRE CIVIL ». Là-dessus point de divergences, point de désaccord, point de différend, parce qu’il n’y a ni doute, ni hésitation possible ; unanimité ; M. Waldeck-Rousseau est aussi convaincu que M. de Galliffet et M. de Galliffet est aussi convaincu que M. Waldeck-Rousseau que des magistrats civils obéiraient.
Et, remarquez, c’est parce que M. Waldeck-Rousseau, avocat, est habitué aux usages de la magistrature civile qu’il est entraîné à penser que des juges militaires agiraient de même et qu’on peut les traiter de la même manière ; c’est parce que M. de Galliffet, soldat, a « quelque connaissance des états d’âme des officiers » qu’il n’est pas du tout du même avis et qu’il croit que plus on voudra qu’ils obéissent, moins ils obéiront. Mais de l’avis de l’un comme de l’avis de l’autre, c’est du côté des magistrats civils qu’est l’obéissance militaire.
Pourquoi cela ? Parce qu’il y a comme une différence de race entre les officiers et les magistrats ? Point du tout ; qui soutiendrait cela ? Mais tout simplement parce que les juges d’un Conseil de guerre se sentent parfaitement indépendants et que des magistrats civils ne se sentent point tels. Un officier, juge pour un temps dans un Conseil de guerre, opine comme il l’entend et rentre le lendemain dans le rang à très peu près comme ferait un juré civil. Je dis à très peu près, parce qu’il est vrai que ce n’est pas tout à fait la même chose ; cet officier court un peu plus de risques que le juré civil ; on peut se souvenir plus tard qu’il a fait partie d’un Conseil de guerre qui a jugé contrairement aux désirs du gouvernement et son avancement peut en souffrir et s’il ne consulte que son intérêt il fera mieux de juger selon les instigations ou selon les désirs du pouvoir ; mais enfin il n’est pas, comme le magistrat civil, destiné à rester magistrat toute sa vie et à avoir tous les jours des rapports avec le gouvernement. Son indépendance est beaucoup plus grande ; elle est intermédiaire, en dernière analyse entre celle du magistrat de l’ordre civil, qui ne peut être que très faible, et celle du juré civil, qui est absolue.
Voilà pourquoi la pression du gouvernement sur celui qui doit juger est utile s’il s’agit de magistrats civils et nuisible quand il s’agit de juges militaires et est aussi nuisible quand il s’agit de juges militaires, qu’elle est utile quand il s’agit de magistrats civils.
Notez que, dans l’espèce, je n’attaque personne. La conduite des juges militaires de Rennes en 1899 peut être blâmée, la conduite des juges civils en 1906 peut être défendue. On peut dire que les juges militaires de Rennes ont obéi à des passions (entêtement à ne pas démentir les premiers juges, instinct de solidarité militaire, etc.) et l’on peut dire que les juges civils de 1906 ont obéi… sans doute au gouvernement, mais, en obéissant au gouvernement, n’ont fait qu’obéir à la raison d’État qui est une chose considérable.
Resterait à savoir si précisément il n’est pas d’une raison d’état supérieure qu’il y ait un pouvoir qui puisse s’opposer à la raison d’état telle qu’à tel moment le gouvernement l’envisage. Ce serait encore à discuter. Mais je reviens ; et considérant simplement l’arrêt de 1906 en lui-même, arrêt très évidemment ajusté aux circonstances, je demande : pourquoi une cour de justice peut-elle, matériellement, en quelque sorte, agir ainsi ? Parce qu’elle se sent et parce qu’elle se veut irresponsable. Prise entre deux irresponsabilités, ce qui est un cas très rare et assez piquant, elle rejette tout sur d’autres qu’elle. D’une part elle rejette son arrêt sur la loi, que du reste elle sollicite : « Ce n’est pas moi qui juge ; c’est la loi. » D’autre part, elle rejette l’indépendance singulière qu’elle se permet à l’égard de la loi sur le gouvernement : « Tout le monde comprendra bien qu’en fléchissant la loi pour arrêter l’affaire Dreyfus, j’obéis à un désir du gouvernement. Qu’on s’en prenne au gouvernement. » Mais qu’est-ce que c’est que cette magistrature-là ? C’est une magistrature très sage, très prudente, très éclairée, même très honnête, chez qui tout souci de la responsabilité a disparu ; et il n’y a que cela.
Un de ses ancêtres, sous la Restauration, a dit au gouvernement d’alors : « La Cour rend des arrêts et non pas des services. » Voyez-vous « les morts qui parlent » ? Voyez-vous, chez ce magistrat de 1820, la survivance de la mentalité qui animait les magistrats de 1750 ? La Cour rend des arrêts et non pas des services ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Ces paroles dans la bouche d’un magistrat de 1750, membre d’un ordre de l’État et qui en aucune façon ne dépend du pouvoir central, sont toutes naturelles et témoignent seulement d’un grand sentiment de sa dignité ; mais, prononcées par un magistrat de 1820, elles ne sont qu’un archaïsme. Le magistrat de 1820 étant un fonctionnaire, comme un préfet, tout précisément n’a pas autre chose à rendre que des services. Il lui est loisible, du reste, dans toutes les affaires où le gouvernement n’intervient pas, de juger en conscience, selon la loi ; mais dès que le gouvernement intervient, par cela seul qu’il est homme du gouvernement, il ne doit avoir de loi ni de conscience que le gouvernement lui-même ; — ou il serait bien illogique et même monstrueux ; il serait un homme du gouvernement jugeant contre le gouvernement, en d’autres termes le gouvernement jugeant contre le gouvernement ; ce serait l’anarchie pure.
En prononçant, pour clore l’affaire Dreyfus, un arrêt qui ne tient pas debout, la Cour de cassation a simplement obéi au désir de n’être pas anarchiste.
C’est à ces conséquences plaisantes et un peu tristes qu’aboutit le fait d’avoir délivré la magistrature de toute responsabilité. Elle peut s’en réjouir, sans doute ; rien n’est plus agréable que de le dire : « Personne, à moins d’être fou, ne peut s’en prendre à moi. » Cependant la chose est grave. Une nation jugée par des hommes qui sont irresponsables, qui se savent irresponsables, qui se disent irresponsables, qui montrent qu’ils sont irresponsables et que le pouvoir veut qu’ils soient irresponsables, peut se sentir en danger. Elle peut se demander s’il n’est pas très périlleux pour les particuliers que, la magistrature n’étant que l’État jugeant, tout démêlé entre un particulier et l’État soit nécessairement jugé contre le particulier. Elle peut se dire : « Ne serait-ce pas le despotisme ? »
Il est très probable que c’est le despotisme. Il a commencé en France, à l’état intégral, en 1789. Mais il a été perfectionné depuis dans les détails. Il peut être perfectionné, du reste, encore. Ce sera l’affaire du régime socialiste.
Montesquieu était comme épouvanté de cette idée : le gouvernement juge. Il disait : « Dans les États despotiques le prince peut juger lui-même [et inversement tout régime où le prince juge lui-même est despotique]. Il ne le peut dans les monarchies : la constitution serait détruite ; les pouvoirs intermédiaires anéantis ; on verrait cesser toutes les formalités du jugement [et la loi elle-même tournée, dont les formalités ne sont que la sauvegarde], la crainte s’emparerait de tous les esprits ; on verrait la pâleur sur tous les visages ; plus de confiance, plus d’honneur, plus d’amour, plus de sûreté, plus de monarchie… le prince est la partie qui poursuit les accusés et les fait punir ou absoudre : s’il jugeait lui-même il serait le juge et la partie. »
Mais précisément, en despotisme ce qui importe c’est que, ayant un différend avec un particulier, le prince soit en même temps partie et juge. Sans cela il n’y aurait plus de despotisme.
C’est justement là que nous en sommes. En faisant de la magistrature un organe de lui-même, l’État s’est despotisé, de ce côté-là, autant qu’il a pu.
Cette situation a été très vivement mise en lumière par M. Raymond Poincaré dans une éloquente préface qu’il a mise en tête d’un livre de souvenirs d’un vieux magistrat. Il commence par rappeler le mot de Guizot : « Dès que la politique pénètre dans l’enceinte des tribunaux il faut que la justice en sorte. » Et c’est bien l’évidence elle-même. Mais, se demande M. Poincaré, « jamais la magistrature n’a été plus incorruptible ni plus consciencieuse ; comment se fait-il donc que son impartialité soit si souvent suspectée ? » Il n’en accuse pas la malice croissante des hommes ; il se dit que c’est peut-être parce que « rarement justice et politique ont été si exposées à des contrats périlleux et à des confusions funestes. Autrefois [vers le milieu du XIXe siècle] la magistrature composait une sorte de famille, étroitement fermée, animée d’un esprit corporatif, hiérarchique, presque sacerdotal, et isolée du monde dans une tour d’ivoire. Elle avait les défauts de cette condition. Elle était doctrinaire, formaliste, réfractaire aux idées nouvelles. Mais elle passait d’ordinaire pour indépendante et pour impartiale. Ce n’est pas cependant qu’elle fût alors tout à fait à l’abri des influences politiques. Elle était trop souvent, elle aussi, dans la main du pouvoir. Il y a quelque part dans Balzac, un juge d’instruction qui est le digne précurseur des magistrats de MM. Brieux et Arthur Bernède. Il se nomme Camusot. Il a une femme qui soigne jalousement sa carrière et qui, rêvant pour lui un siège au tribunal de la Seine, lui murmure en douceur : « De là, mon chat, à la présidence d’une chambre à la Cour il n’y aura pas d’autre distance qu’un service rendu dans quelque affaire politique. » Les services de ce genre, le juge, du moins, n’était autrefois mis en demeure de les rendre qu’au gouvernement. C’était trop ; mais au prix de ce qui se passe maintenant ce n’était presque rien. Aujourd’hui le pouvoir exécutif affaibli n’ose plus guère porter atteinte à la dignité des magistrats que lorsqu’il cède à l’impulsion du pouvoir législatif. Mais le Parlement, en bloc et en détail, est porté à considérer que la justice est à sa dévotion et le public lui-même finit par être convaincu qu’il en doit être ainsi.
« Combien de justiciables qui ont peur de perdre un procès n’ont-ils pas la candeur [mais non, l’intelligence] de s’adresser à leur député ! Et combien de députés ne s’aventurent-ils pas à faire, auprès du juge, une demande insolente ou discrète ! Encore ces ingérences personnelles sont-elles moins graves que les immixtions collectives auxquelles les Chambres se croient autorisées : interpellations sur les affaires judiciaires, instructions réclamées du haut de la tribune, injonctions au garde des sceaux, commissions d’enquête, que sais-je ? La politique a imaginé mille moyens de se glisser au foyer de la justice et il y a longtemps que la justice, séduite ou découragée, a renoncé à résister : ne sont-ce pas les Chambres qui sont les vraies dépositaires de la puissance publique et les dispensatrices souveraines de l’avancement ? Il s’est rencontré en 1906 un garde des sceaux qui a eu la courageuse velléité de ramener un peu d’ordre dans cette anarchie, de soustraire les juges à la mainmise parlementaire et de donner quelque solidité à leur statut personnel. Le décret qu’il a contresigné a soulevé de telles tempêtes qu’il a fallu le remanier et l’édulcorer. On a parlé depuis lors, d’instituer un Conseil suprême de la magistrature, analogue à ceux qui fonctionnent dans plusieurs ministères et chargé d’apprécier en toute indépendance les titres à l’avancement. Et certes, il n’y aurait aucune impossibilité à ce qu’il existât à la chancellerie un organe comparable au conseil général des mines ou des ponts et chaussées, au comité des inspecteurs généraux de l’enseignement secondaire ou à tout autre groupement professionnel destiné à limiter l’arbitraire des choix ministériels. Tout ce qu’on fera pour séparer la politique de la justice et pour les confiner toutes deux dans leur domaine respectif sera une œuvre de salut national. Si le juge ne parvenait pas à s’affranchir de la tutelle parlementaire ce serait bientôt fait de l’autorité de la justice. Besoin ne serait plus d’écrire ni de lire des essais sur l’art de juger. L’art d’intriguer suffirait à tout. »
Tout est à méditer dans cette lumineuse et forte page. Remarquez-y, en les distinguant, l’ordinaire et l’extraordinaire des pratiques judiciaires. L’ordinaire c’est l’ingérence du gouvernement dans les affaires à juger. Ceci est le quotidien, la vie de tous les jours. Dès que le gouvernement a un intérêt dans une affaire, par définition elle est sienne et la magistrature reconnaît qu’elle appartient au gouvernement et que c’est lui qui en connaît et qui doit la juger.
L’ordinaire encore c’est l’ingérence des députés, personnellement, dans les affaires judiciaires et ceci est intéressant parce qu’il nous met une fois de plus — ceux qui m’ont lu savent combien souvent j’ai examiné cette question — en face de cette institution illégale mais qui n’en est pas moins une des institutions de la France : les gouvernements locaux. La France est beaucoup plus décentralisée qu’on ne le croit généralement. Chaque département est administré par un préfet et un conseil général.
— Par le préfet et le conseil général.
Point du tout et vous répondez comme un élève de l’école primaire ; ce dont vous parlez n’est que la façade. Chaque département est gouverné par ses Quinze-Mille, c’est-à-dire par ses députés et ses sénateurs, un peu plus par ses députés que par ses sénateurs, parce que les députés renversent plus souvent les ministères que ne font les sénateurs ; mais enfin par ses sénateurs et ses députés.
Avant d’aller plus loin il faut encore faire une distinction. Voulez-vous, vous département de Saône-et-Marne, être bien gouverné, à peu près ? Ne nommez que des sénateurs et des députés de l’opposition. Pourquoi ? Parce que si vous ne nommez que des sénateurs et des députés de l’opposition ils n’auront aucune influence sur votre préfet, sur vos magistrats, sur vos ingénieurs, sur vos agents voyers et vous serez gouvernés administrativement, c’est-à-dire à peu près régulièrement, à peu près légalement. Mais si vous nommez des sénateurs et des députés du gouvernement, c’est par eux que vous serez gouvernés. La France ainsi est partagée un peu comme elle l’était — il y a du moins analogie — du temps du droit coutumier et du droit écrit. Comme il y avait des pays de droit coutumier et des pays de droit écrit, il y a des pays d’État et des pays de Parlement. Les pays dont la représentation parlementaire est d’opposition, sont gouvernés par le gouvernement ayant pour agents ses préfets ; les pays dont la représentation parlementaire est gouvernementale sont gouvernés par leur représentation, devant laquelle le préfet n’est rien du tout et à laquelle le préfet et aussi le procureur général obéissent. Il en résulte — de toutes les choses sérieuses la politique étant la plus bouffonne — que les préfets ne désirent rien tant que d’être nommés dans les départements d’opposition ; car ils y ont leurs coudées franches ; et n’aiment guère être nommés dans les pays gouvernementaux où ils sont subordonnés ; il en résulte aussi que le gouvernement français ne gouverne réellement que dans les départements d’opposition, qui, parce qu’ils sont d’opposition, sont pays d’État ; et ne gouverne que d’une façon très partagée et très précaire dans les départements gouvernementaux, qui, parce qu’ils sont gouvernementaux, sont pays de Parlement.
Mais ne considérons que ces derniers, qui sont les plus nombreux. Ils ont un véritable gouvernement local. Leurs sénateurs et députés forment un comité départemental qu’il ne faudrait pas que le préfet contrariât. Ils font les nominations en imposant au ministre celles qui dépendent du ministre, en imposant aux préfets celles qui dépendent du préfet ; ils déplacent les instituteurs qui ne sont pas agents électoraux puisqu’ils manquent à la seule mission pour laquelle on les a nommés et aussi ceux qui ne sont pas agents électoraux assez zélés, puisqu’ils manquent de zèle dans la seule fonction pour laquelle on leur en demande ; ils interviennent auprès des magistrats dans les affaires où un de leurs partisans pourrait être condamné, ce qui serait d’un mauvais exemple et ce qui compromettrait la République ; enfin ils gouvernent.
Ces gouvernements locaux, très bien organisés et très forts, institués uniquement en somme pour que la loi ne gouverne pas, parce que la loi pourrait favoriser des ennemis de la République, sont un des aspects les plus curieux du régime actuel, s’imposent à l’attention de l’historien par leur mécanisme ingénieux et du reste sont peut-être l’institution essentielle de la troisième République française.
On comprend combien la magistrature trouve dans cette institution un excellent prétexte à se décharger de toute responsabilité et du reste est à peu près dans l’impossibilité d’en conserver une. Car il est plus difficile de résister à un gouvernement local qu’à un gouvernement central ; le gouvernement local vous tient de plus près, vous surveille de plus près, vous serre plus étroitement. Au gouvernement central on peut refuser l’acquittement d’un de ses partisans convaincu de délit de chasse ; tout compte fait on sait bien qu’il s’en moque ; à un gouvernement local il serait bien irrespectueux et il serait très dangereux de le lui refuser.
Ajoutez que si la magistrature désobéissait au gouvernement local, elle aurait contre elle et le gouvernement local et le gouvernement central, puisque les membres du gouvernement local la dénonceraient comme antirépublicaine au gouvernement central et que le gouvernement central dépend du gouvernement local en tant que celui-ci est composé de parlementaires par qui le gouvernement central peut être si facilement renversé. La chaîne est parfaitement rivée ; elle est très solide.
En conséquence la magistrature française obéit le plus qu’elle peut, ou, si l’on veut, désobéit le moins possible au gouvernement local dans les pays de Parlement et lui passe volontiers la responsabilité de ses arrêts.
Et ceci, comme nous avons dit, est l’ordinaire, le quotidien. L’extraordinaire, que nous avons vu, que M. Poincaré n’a pas manqué de viser aussi, ce sont ces occasions, assez nombreuses encore, où le pouvoir législatif évoque à lui une affaire judiciaire qui lui semble avoir été mal engagée ou mal jugée. Exemple, en 1910, l’affaire Rochette. Rochette, banquier et lanceur d’affaires, qui semble, du reste, peu intéressant, a un succès énorme et une popularité immense. Tous les actionnaires de ses innombrables entreprises ont confiance en lui. Le gouvernement, soit par souci de la petite épargne, comme il l’a dit, et il n’est pas impossible ; car il se peut que le gouvernement ait quelquefois souci des intérêts généraux de la nation et cela est tout à fait dans la tradition du gouvernement monarchique, du gouvernement paternel et cet intérêt porté à des gens dont pas un ne se plaint mais qui devraient se plaindre a quelque chose d’aussi touchant que burlesque ; — soit, ce qui est, non pas plus probable, mais aussi probable, par intérêt porté à des banquiers amis de lui et ennemis de Rochette ; décide de perdre celui-ci. Ne pouvant pas agir directement sur le parquet parce qu’il n’y a pas de plaignant, il trouve un plaignant, le suscite, l’invente et met en mouvement la machine judiciaire. La Chambre des députés, qui n’a pas, semble-t-il, la même sollicitude que le gouvernement pour la petite épargne, décide une enquête parlementaire c’est-à-dire moralement au moins, évoque l’affaire à elle et se fait juge. Qu’est-ce à dire ? C’est-à-dire que le Roi ordonne des Grands Jours. Sous l’Ancien Régime quand, dans une province, la Justice, à cause de la multiplicité des crimes et de la puissance des criminels, était impuissante, le Roi ordonnait des Grands Jours, à savoir constituait une haute cour de justice à pleins pouvoirs qui le représentait lui, le Roi, exactement ; et qui avait le droit de faire tout ce qu’il aurait fait lui-même. Tout ainsi, la Chambre, c’est-à-dire le Souverain, c’est-à-dire le prince, c’est-à-dire la France, constatant ou croyant constater que la magistrature, dans une affaire dont le gouvernement se mêle, obéit, comme toujours et comme c’est son axiome, au gouvernement ; constatant de plus que le gouvernement a peut-être cédé à la voix de son intérêt propre et non à la voix de l’intérêt de la France, fait ses Grands Jours, déclare qu’elle, pouvoir suprême, jugera souverainement elle-même. Elle se substitue au gouvernement qui s’est substitué lui-même à la magistrature ; elle jette son « fait du prince » sur « le fait du prince » que le gouvernement a jeté sur la magistrature ; elle dessaisit le gouvernement qui a dessaisi le magistrat ; elle déclare détestable l’arbitraire du gouvernement, ce pourquoi elle le remplace par le sien à elle.
Montesquieu aurait blanchi en une nuit devant cette confusion des pouvoirs, corrigée par une plus grande confusion des pouvoirs, devant cette confusion des pouvoirs doublée, devant une première hérésie amendée par une hérésie plus détestable et aurait dit que c’était là du despotisme à la seconde puissance.
Rien de plus vrai ; mais cependant que faire ? Si, parce que la magistrature n’est plus rien en affaires où la politique se mêle, le gouvernement est juge en affaires politiques, il est logique que, en tant que juge, comme en tant que pouvoir exécutif, il ait comptes à rendre au pouvoir législatif. Moi, pouvoir législatif, j’empiète sur votre pouvoir judiciaire à vous, pouvoir exécutif ; oui, mais parce que vous, pouvoir exécutif, vous avez empiété sur le pouvoir judiciaire ; et cela fait double empiétement ; oui, peut-être, mais cela est peut-être un empiétement qui en corrige un autre et une usurpation qui met à la raison une autre usurpation.
— En attendant, c’est l’anarchie.
— Oh ! pour cela oui ; et c’est encore une raison pour quoi la magistrature se sent irresponsable et finit par se résoudre à l’être avec un sourire. « Ils sont trop, dit-elle. Fait du prince de la part de l’exécutif sur moi ; fait du prince de la part du législatif sur l’exécutif. Je dépends de l’exécutif qui dépend du législatif. J’ai des comptes à rendre au gouvernement qui en a à rendre à la Chambre. Dans tout cela il n’y a qu’une chose qui soit claire, c’est que je suis très peu de chose et que je n’ai pas de responsabilité du tout. En affaires ordinaires, sauf interventions, quotidiennes du reste, des gouvernements locaux, je fais ce que je crois devoir faire d’après la loi et mon interprétation de la loi, en matière d’affaires où le gouvernement s’intéresse, je dis au gouvernement : « Qu’est-ce que vous voulez ? » je dis au pouvoir législatif : « Qu’est-ce que vous voulez ? » Je dis aux deux : « Êtes-vous d’accord ? que votre volonté commune soit faite. Vous ne l’êtes point ? Discutez et arrangez-vous et quand vous serez d’accord, je le serai avec vous. Je n’ai ni autre chose à dire, ni autre chose à faire. Ainsi le veut la Constitution réelle, qui, derrière la façade solennelle de la Constitution officielle, régit ce pays. »
En d’autres termes le pouvoir judiciaire en France n’existe plus, en France il n’y a pas de pouvoir judiciaire. « Un peu d’ordre dans cette anarchie, dit M. Poincaré, un garde des sceaux a voulu cela et il a soulevé des tempêtes parlementaires. » Je voudrais bien savoir en effet qui, dans aucune des deux Chambres, aurait pu avoir la fantaisie de restreindre le pouvoir des deux Chambres en assurant, même dans une petite mesure, l’autonomie ou seulement l’indépendance relative du pouvoir judiciaire. On réussit auprès des corps politiques, comme auprès de tous les autres, en leur proposant de les augmenter, mais non, sans doute, en leur proposant de les amoindrir. M. Poincaré conclut que de ce train c’en sera bientôt fait de l’autorité de la justice. Je suis tout à fait de son avis, sauf que je ne vois pas très distinctement pourquoi il emploie le futur ; et il conclut aussi que l’art de juger sera délaissé par l’art de l’intrigue. Peut-être bien ; mais que peuvent naturellement désirer les parlementaires sinon que tout en France soit, avec plus ou moins de perfection, à leur image ?
Autre irresponsabilité qu’a acquise la magistrature française. On l’a débarrassée de toute la responsabilité des procès criminels ; les procès criminels ne sont jugés que par le jury. L’histoire du jury est extrêmement intéressante. Elle remonte à une antiquité assez reculée. Les Héliastes à Athènes étaient un jury[1]. C’était n’importe qui (pourvu qu’il fût citoyen) allant juger, parce que c’est amusant de juger et parce qu’il disait « Je veux aller juger. » On les payait du reste un peu pour cela. Le plus célèbre de leurs jugements est la condamnation à mort d’un flâneur un peu sarcastique qu’on appelait Socrate.
[1] Je remarque après coup que Montesquieu y a bien songé ; parlant du jury anglais il dit : « La puissance des juges exercée par des personnes tirées du corps du peuple » et il jette en note « comme à Athènes ».
Il n’a jamais existé à Rome, le Romain n’ayant jamais eu pleinement le sens démocratique.
Chez les Anglais il est très ancien.
A l’imitation des Anglais les philosophes français du XVIIIe siècle le recommandèrent — Montesquieu lui-même — de tout leur courage. Il ne manque pas et retenez bien ceci, de quoi je discuterai plus tard, de dire que la juridiction du jury « n’étant attaché ni à un certain état ni à une certaine profession, devient pour ainsi dire invisible et nulle ; on n’a point continuellement les juges devant les yeux et l’on craint la magistrature et non pas les magistrats ». Il ajoute : « Il faut même que les juges soient de la condition de l’accusé ou ses pairs, pour qu’il ne puisse pas se mettre dans l’esprit qu’il soit tombé entre les mains de gens portés à lui faire violence. »
Voltaire loua fort ce jury dans ses lettres sur l’Angleterre et le considéra comme un des remparts de la liberté, étant déjà pénétré de cette haine contre les Parlements qu’il a conservée toute sa vie.
Il est beaucoup plus explicite sur ce point tout à la fin de son existence dans sa lettre à M. Élie de Beaumont (1771) : « … J’aime mieux tout simplement l’ancienne méthode des jurés qui s’est conservée en Angleterre. Ces jurés n’auraient jamais laissé rouer Calas et conclu sous Riquet [procureur général au Parlement de Toulouse] à faire rouer sa respectable femme ; ils n’auraient pas fait rouer Martin sur le plus ridicule des indices ; le chevalier de la Barre, âgé de dix-neuf ans et le fils du président d’Etallonde, âgé de dix-sept ans, n’auraient pas eu la langue arrachée par un arrêt, le poing coupé, le corps jeté dans les flammes pour n’avoir pas fait la révérence à une procession de capucins et pour avoir chanté une mauvaise chanson de grenadiers… »
Voilà qui est bien ; seulement quand Voltaire s’occupait de l’affaire Calas et de l’affaire de la Barre, il a pris très diligemment des informations et c’est à son honneur. Or qu’a-t-il appris ? Il a appris touchant l’affaire La Barre que « pendant une année entière on ne parla dans Abbeville que de sacrilèges ; qu’on disait qu’il se formait une nouvelle secte qui brûlait tous les crucifix, qui jetait par terre toutes les hosties et qui les perçait à coups de couteau ; qu’on assurait qu’elles avaient versé beaucoup de sang : qu’il y avait eu des femmes qui croyaient en avoir été témoins ; qu’on avait renouvelé toutes les calomnies répandues contre les Juifs dans tant de villes de l’Europe ; et vous connaissez, ajoutait-il, à quels excès la populace porte la crédulité du fanatisme toujours encouragé par les moines. »
Il a appris touchant l’affaire Calas ce qu’il dit à Damilaville dans sa lettre du 1er mars 1765 : « Quel fut mon étonnement lorsqu’ayant écrit en Languedoc sur cette étrange aventure, catholiques et protestants me répondirent qu’il ne fallait point douter du crime du Calas ! Je ne me rebutai point. Je pris la liberté d’écrire à ceux-mêmes qui avaient gouverné la province, à des commandants de provinces voisines, à des ministres d’État ; tous me conseillèrent unanimement de ne me point mêler d’une si mauvaise affaire ; tout le monde me condamna ; et je persistai… » Dans une autre lettre il dit : « Le fanatisme du peuple a pu passer jusqu’à des juges prévenus [à Toulouse]. Plusieurs étaient pénitents blancs ; ils peuvent s’être trompés… »
Eh bien alors ! Si le peuple d’Abbeville était forcené contre La Barre et d’Etallonde, si le peuple de Toulouse et du Toulousain, aussi bien protestants que catholiques, était forcené contre Calas ; si le fanatisme du peuple était tel qu’il a pu passer jusqu’aux juges ; étant plus sûr encore qu’il s’exercerait plus violemment n’ayant pas à passer du peuple aux juges et restant dans le peuple lui-même ; il est assez probable qu’un jury tiré du peuple d’Abbeville eût condamné La Barre et d’Etallonde et qu’un jury tiré du peuple toulousain eût condamné Calas ; et il est assez comique de venir dire après : « le jury n’eût jamais laissé rouer Calas », la conclusion plus logique étant que c’est précisément ce qu’il eût fait ; et, « le jury n’aurait jamais brûlé La Barre », la conclusion plus logique étant que selon toute apparence, il n’aurait pas manqué de le faire[2]. La vérité est qu’en attribuant au jury la connaissance du procès des criminels, on en a soustrait l’examen, la répression ou l’acquittement aux passions des juges et l’on en a confié l’examen, la répression ou l’acquittement aux passions du peuple ; et que juges et peuple aient des passions, c’est tout à fait mon avis ; mais que chez les juges les passions soient amorties par une plus grande culture, par la connaissance de la loi et de la jurisprudence, par la lecture des philosophes juristes et par l’habitude du raisonnement, c’est ce que je suis porté à croire et ce que je me permets de dire ; et par conséquent il me semble qu’il y a moins de passions du côté des juges et qu’il n’y a que des passions du côté du peuple.
[2] Pour Martin, pour lequel il y a erreur judiciaire certaine, il n’y a de son histoire rien à tirer pour ou contre le jury : un voyageur avait été assassiné ; des empreintes de pas où les souliers de Martin s’ajoutaient menaient du lieu du crime à la maison de Martin ; l’assassin, vu par quelqu’un, ressemblait, quant à ses habits à Martin ; un témoin du crime arrivé devant Martin dit : « Je ne le reconnais pas », et Martin s’écrie : « Dieu soit loué, en voilà un qui ne me reconnaît pas. » Dans ces paroles amphibologiques le juge voit un aveu ; il condamne Martin. La Tournelle (chambre du Parlement de Paris) confirme. Martin est roué. Le véritable assassin, arrêté pour autre chose, se déclara auteur du meurtre mis au compte de Martin. Ici rien à dire en aucun sens. Voltaire est sûr qu’un jury n’aurait pas condamné Martin ; il n’en sait rien, ni moi non plus.
J’ajoute que les passions chez les juges sont amorties par le sentiment de la responsabilité et que le jury n’a aucune responsabilité. Revenons aux très belles paroles de Montesquieu : « La juridiction du jury n’étant attachée ni à un certain état ni à une certaine profession devient pour ainsi dire invisible et nulle. On n’a point continuellement les juges devant les yeux et l’on craint la magistrature et non pas les magistrats. » Cela est très ingénieux et même très profond. Mais si le jury est une magistrature invisible et nulle, les magistrats ne sont plus redoutés et détestés des coquins et cela est agréable aux magistrats ; mais il n’y a plus personne que les coquins détestent et redoutent et cela est dangereux.
Si ! dites-vous : on ne craint pas les magistrats, qui sont invisibles ; mais on craint la magistrature que l’on ne voit pas, mais qu’on sait qui existe.
Je ne sais pas trop ; je ne sais pas si une magistrature pour ainsi dire invisible et nulle inspire une très grande terreur. Je crois qu’elle inspire la terreur qu’inspire le hasard ; car elle est précisément le hasard. Le jury à qui songe le criminel sera-t-il faible, sera-t-il sévère ? Il n’en sait rien. Qu’il n’en sache rien, cela vous rassure parce que cela doit l’effrayer et cela m’effraie parce que cela peut le mettre en confiance. Le criminel que des juges attendent agit avec certitude d’être puni s’il est pris ; le criminel que le jury attend agit dans l’incertitude d’être acquitté ou condamné. Cette incertitude même est encourageante plutôt, ce me semble, qu’intimidante. Le criminel qu’attend le juge n’a pas à compter sur l’avocat, jamais avocat n’ayant changé l’opinion d’un juge ; le criminel qu’attend le jury compte sur l’avocat qui change très souvent l’état d’âme de plusieurs jurés. Tout compte fait il n’y a pour être contents de la translation des procès criminels des juges au jury, que les juges et les criminels, les juges parce que cela les débarrasse d’une lourde responsabilité, les criminels parce que, aux chances qu’ils ont de n’être pas pris, — 50 % — cela ajoute la chance d’être acquittés par le jury — 75 %. — Cela est rassurant et, dans une certaine mesure, encourageant. Étant donné que sur 100 crimes, 50 % restent inconnus ; que sur les 50 qui restent 50 % des auteurs ne sont pas découverts ; que sur les 25 qui restent, 75 % des auteurs sont acquités ; on peut calculer sans aucune exagération, et au contraire, qu’un criminel, quand il commet un crime, a 94 chances contre 6 de n’être pas puni, ce qui fait l’industrie criminelle beaucoup moins aléatoire que celle du petit boutiquier, 50 % des petits boutiquiers faisant faillite, 6 % seulement des industriels de la criminalité faisant mal leurs affaires.
C’est ce qui explique la progression continuelle et très rapide de la criminalité. On a essayé de l’expliquer par la diminution de l’éducation religieuse, par l’influence de la morale athéistique des instituteurs ; tout cela, sans doute, peut contribuer et je doute peu qu’il ne contribue ; mais le fond de la chose c’est que la plupart des métiers offrent beaucoup plus de chances d’insuccès que celui d’assassin ; que la profession d’assassin sans, il faut l’avouer, présenter une sécurité absolue, est, du moins, une des plus sûres ; que fonctionnaire ou assassin sont les seuls métiers à peu près de tout repos. Cela dirige du côté de la criminalité et du fonctionnarisme et détourne de l’industrie un très grand nombre d’esprits sérieux.
Remarquez encore que « cette magistrature invisible et nulle », comme dit Montesquieu, c’est à savoir le jury, se sait invisible et nulle et que cela, à son irresponsabilité ajoute le sentiment et la conscience de son irresponsabilité. Le jury en effet se sent invisible et nul ; il n’est pas, formellement et nommément, désigné aux rancunes et aux colères des criminels punis ou des amis des criminels châtiés…
— Eh bien, cela le rend plus rigoureux !
— … et il n’est pas désigné, formellement et nommément, aux indignations et aux colères des honnêtes gens non défendus et non protégés et cela le laisse libre de céder aux mouvements de sa sensibilité. Le jury est un groupe de citoyens investi pour huit jours du droit de juger ; qui, d’abord, parce qu’il n’a aucune connaissance juridique ni aucune connaissance psychologique du criminel, juge à tort et à travers, soit par opinion politique, soit par sensibilité et selon que l’éloquence de l’avocat ou du ministère public aura fait plus d’impression sur lui ; et qui ensuite, ayant conscience qu’il a jugé à tort et à travers, a une tendance à diminuer encore la responsabilité presque nulle qui pèse, si peu, sur lui ; à augmenter l’irresponsabilité presque absolue dont il jouit.
Il est très rare depuis une dizaine d’années qu’un jury qui a condamné ne signe pas un recours en grâce, après avoir condamné. Qu’est-ce que cela signifie ? Vous ne savez donc pas ce que vous faites et vous avouez donc que vous ne savez pas ce que vous faites ? Vous avez pleins pouvoirs. Il vous est loisible d’acquitter un criminel certain, un criminel, même, qui a avoué ; car on ne vous demande pas : « L’accusé a-t-il fait cela ? » ; mais : « L’accusé est-il coupable ? » et vous pouvez toujours dire, ce qui n’a rien d’irrationnel, qu’un homme qui aura tué son père et sa mère n’est pas coupable. Vous avez donc, immensément et absolument, pleins pouvoirs. Or, ayant pleins pouvoirs, vous condamnez et de la même main et dans le même quart d’heure vous signez un recours en grâce ! C’est là qu’éclate, à aveugler, votre passion de l’irresponsabilité. Vous condamnez parce que quelque répugnance à condamner que vous ayez, vous ne pouvez pas, en conscience et sans vous prendre en mépris, faire autrement ; mais vous voulez déplacer la responsabilité ; vous voulez qu’en définitive ce soit un autre que vous qui condamne, à savoir celui qui refusera la grâce.
Nous saisissons ici sur le fait l’horreur de la responsabilité, la passion de l’irresponsabilité : « Avant tout, surtout, que ce ne soit pas ma faute ! »
Nous saisissons ici, du reste, deux choses qui tout compte fait, reviennent à la même : d’abord le goût du Français pour se laver les mains : « J’ai fait quelque chose ; mais je ne suis pas parti d’ici sans avoir fait en sorte que ce que j’ai fait ici soit nul et non avenu » ; c’est proprement : « Je ne m’en mêle pas ; je ne veux jamais m’en mêler et même quand on m’y a mêlé de par la loi, je cherche et je trouve un moyen de ne m’en être pas mêlé ». Et ensuite, nous saisissons ici non moins pleinement, je crois, le goût tout Français depuis un siècle pour que ce soit le gouvernement qui fasse tout.
De même que la magistrature assise, la Cour de cassation, par exemple, est enchantée de dire : « C’est le fait du prince ; j’étais commandée ; je n’y suis pour rien » ; de même le jury est enchanté de pouvoir dire « je n’y suis pour rien ; dans cette indulgence je ne suis pour rien ; j’avais condamné ; j’avais signé mon recours en grâce ; le gouvernement a grâcié ; ce n’est pas ma faute ; dans cette exécution je ne suis pour rien ; j’avais condamné, il est vrai, j’avais signé un recours en grâce, le gouvernement pouvait grâcier, il ne l’a pas fait, ce n’est pas ma faute ; j’avais transporté mes pouvoirs de moi au gouvernement ; car en France il est juste et il est comme constitutionnel que le gouvernement fasse tout. »
Vous les voyez assez tous fuir les responsabilités avec ardeur ! Par un code relativement simple et cohérent on décharge les magistrats de la responsabilité qui résultait de ce qu’ils étaient obligés d’interpréter la loi et de juger, un peu, en équité ; ils sont contents ; on les décharge de juger un criminel en chargeant de cela le jury, ce qui est agréable aux juges et avantageux aux criminels, et criminels et juges sont satisfaits ; mais le jury lui-même, quoique irresponsable par son invisibilité et sa nullité, n’est pas satisfait du tout de cette responsabilité invisible et quasi-nulle qu’on a transportée sur lui et s’en décharge et la transporte sur le gouvernement par le recours en grâce.
Et ainsi nous avons le spectacle d’une responsabilité errante, mal voulue de toutes parts, chassée d’ici, mal reçue là, repoussée par les uns, repoussée par les autres, odieuse à tous et venant enfin se reposer sur le gouvernement, qui, du reste, ne s’en soucie aucunement.
Tout ceci est significatif de l’état d’esprit du Français aux XIXe et XXe siècles. Mais ce n’est pas tout. A l’irresponsabilité des juges, à l’irresponsabilité du jury, on a depuis une vingtaine d’années ajouté l’irresponsabilité des criminels. Tous les honnêtes gens veulent être irresponsables de la condamnation ; mais il faut savoir aussi que les criminels sont irresponsables de la faute. Il a été posé en principe par le Code lui-même bien avant, notez ce point, qu’on en sût bien précisément ce que c’est un fou : 1o que ce qu’on devait condamner c’était le coupable. (De là la question que l’on pose au jury, non pas : « l’accusé a-t-il fait l’acte dont il s’agit ? » ; mais : « l’accusé est-il coupable ? ») 2o que le fou n’est pas coupable.
Or, on s’est aperçu, en étudiant d’une part la criminalité et d’autre part la folie, que le criminel était toujours un fou, que par conséquent le criminel n’est jamais coupable et que par conclusion définitive le criminel ne doit jamais être condamné.
Reprenons en analysant. Peut-on dire que le fou est coupable ? Non, évidemment ; cela tombe sous le bon sens. Le fou est un malade qui ne sait pas ce qu’il fait et à qui ce qu’il fait n’est pas imputable. Il faut le soigner, non le châtier. Il est irresponsable.
Soit ; mais n’y a-t-il pas des degrés dans la folie ? Oui ; on est plus ou moins fou ; il y a des demi-fous qui sont très dangereux, plus peut-être que les fous complets, parce qu’ils sont fous moins manifestement ; mais enfin qui ne sont fous qu’à moitié.
Bien. N’y a-t-il pas des quarts de fous, des cinquièmes de fous ? Mon Dieu, oui, certainement ; car il est évident qu’il y a beaucoup de degrés. Donc il y aura aussi des irresponsabilités incomplètes ou des responsabilités limitées ? Sans doute.
De là est venu tout le système et tout l’étiage des responsabilités plus ou moins limitées. Il s’est trouvé des médecins pour trouver des huitièmes de responsabilité ; il s’en est trouvé un (c’est historique) pour trouver à un criminel une responsabilité de 45 %.
— Soit ; mais quel est le signe de l’irresponsabilité totale ou partielle chez un criminel ? — S’il vous plaît, c’est sa criminalité même. Les annales de la justice sont toutes pleines d’arrêts indiquant pleinement que ce critérium est le seul. On arrête un homme pour avoir volé dans un grand magasin. On le condamne, on l’emprisonne ; sa peine faite, on le relâche. Il vole une seconde fois, une troisième, une dixième. Cette fois on ne le condamne plus ; car s’il vole dix fois, il n’est plus voleur, il est cleptomane : c’est un fou, il n’est plus coupable. De sorte que plus on est criminel, moins on est coupable ; l’intensité de la criminalité efface toute culpabilité ; on n’est coupable qu’à la condition de l’être peu ; en avançant dans la criminalité on diminue en culpabilité ; et, très grand criminel on n’est plus coupable du tout ; et, en dernière analyse seul est coupable le très honnête homme qui commet une faute.
Notez que c’est très vrai ; c’est très vrai dans l’ordre de l’imputabilité comme disaient les théologiens. Peut-on imputer et c’est-à-dire reprocher à un homme qui a tué toute sa famille depuis sa grand’mère jusqu’à son petit-fils, ce qu’il a fait ? Non, non ! il est trop évident que c’est une brute ; il n’y a absolument rien à lui dire. — Doit-on reprocher, imputer à faute à un très honnête homme, très sage, très éclairé, d’avoir commis une légère malversation ? Évidemment ! C’est lui qui est très coupable, sachant le bien, voyant le bien, le voyant sans cesse, de faire le mal, ne fût-ce qu’une fois ; il est coupable extrêmement.
C’était la discussion entre Pascal et les Jésuites. Les Jésuites disaient : « Celui qui n’a aucune pensée de Dieu, ni des péchés qu’il commet, ni aucune connaissance de l’obligation d’exercer les actes d’amour de Dieu [en langage philosophique : aucune connaissance du devoir] ou de contrition [remords]… ne fait aucun péché en omettant ses actes… Pour faire qu’une action soit péché, il faut que ceci se passe dans l’âme : connaissance de la chose bonne, inclination à la faire, résistance de l’instinct du mal, etc., et si ces choses ne se sont point passées dans l’âme, il n’y a point culpabilité ! »
Pascal répondait, avec un certain talent, je le reconnais : « Oh ! mon père le grand bien que voici pour des gens de ma connaissance ! Il faut que je vous les amène. Peut-être n’en avez-vous guère vu qui aient moins de péchés, car ils ne pensent jamais à Dieu ; les vices ont prévenu leur raison ; ils n’ont jamais connu ni leur infirmité ni le médecin qui peut les guérir. Ils n’ont jamais pensé à désirer la santé de l’âme ni encore moins à prier Dieu de la leur donner ; de sorte qu’ils sont encore selon vous, dans l’innocence du baptême. Ils n’ont jamais été contrits de leurs péchés ; leur vice est dans une recherche continuelle de toutes les sortes de plaisirs dont jamais le moindre remords n’a interrompu le cours. Tous ces excès me faisaient croire leur perte assurée ; mais, mon père, vous m’apprenez que ces mêmes excès rendent leur salut assuré. Béni soyez-vous, mon père, qui justifiez ainsi les gens ! Les autres apprennent à guérir les âmes par des austérités pénibles ; mais vous, vous montrez que celles qu’on aurait crues les plus désespérément malades se portent bien. Oh ! la bonne voie pour être heureux en ce monde et en l’autre ! J’avais toujours pensé qu’on péchait d’autant plus qu’on pensait moins à Dieu. Mais, à ce que je vois, quand on a pu gagner une fois sur soi de n’y plus penser du tout, toutes choses deviennent pures pour l’avenir. Point de ces pécheurs à demi qui ont quelque amour pour la vertu. Ils seront tous damnés, ces demi-pécheurs ; mais pour ces francs pécheurs, pécheurs endurcis, pécheurs sans mélange, pleins et achevés, l’enfer ne les tient pas : ils ont trompé le diable à force de s’y abandonner. »
Il y a de la vérité : c’est pourtant les Jésuites qui ont raison. Au point de vue de l’imputabilité, du reproche à faire et en un mot de la culpabilité bien proprement dite, celui-là n’est pas coupable du tout qui n’a aucune idée du bien ; celui-là est très coupable qui ayant une idée très nette du bien fait le mal ; et les demi-coupables ou les partiellement coupables s’échelonnent entre ces deux extrêmes.
Donc au point de vue de la culpabilité, c’est le criminel atroce qui est innocent, parce qu’il est irresponsable et il est très vrai que c’est à la criminalité même qu’on reconnaît l’irresponsabilité et à la grandeur du crime que l’irresponsabilité se mesure.
Et la conséquence est que l’on n’est jamais coupable quand on est criminel, mais qu’on est fou.
Quand les magistrats demandent à un médecin : « Est-il fou ? » le médecin devrait toujours répondre : « évidemment, puisqu’il est criminel. » Ce n’est pas toujours la folie furieuse ; mais c’est toujours la stupidité. On tue par jalousie, ou par rancune ou par esprit de vengeance, parce qu’on est idiot ; on tue pour voler parce qu’on est inepte, car jamais ce qu’on doit acquérir ne vaut ce qu’on perd ; on vole, sans tuer, par bêtise encore, tant la chute est grande pour un mince profit ; l’homme d’affaires indélicat lui-même n’est qu’un très pauvre hère, d’esprit très borné, qui est bête à ce point de croire que s’enrichir est un profit et qui ne s’aperçoit qu’après coup à quel point c’est une duperie. Tout coupable est un dégénéré ; voilà le principe vrai. L’homme irréprochable n’est qu’un homme intelligent.
Et la vertu, où commence-t-elle ? A être non seulement irréprochable, mais dévoué à son semblable ; à, non seulement ne pas faire le mal, pour quoi il suffit d’être intelligent, mais à faire du bien, ce que l’intelligence n’enseigne pas.
Donc les criminels sont des fous, les délinquants sont des imbéciles ; et aucun n’a le cerveau sain et tous sont des malades et aucun n’est coupable.
Alors acquittons-les tous ! — Non, condamnons-les tous, non comme coupable, mais comme dangereux et comme devant être intimidés. C’était le principe qui était faux, le principe de culpabilité, reste de théologie confuse. Le principe vrai, c’est de ne voir des coupables nulle part et de voir des dangereux dans tous ceux qui font des infractions à la loi.
— Et cela reviendra au même et il n’était pas besoin de tant parler pour ne rien changer aux choses.
— Précisément ; cela ne reviendra pas du tout au même et nous voilà au point. Avec ce principe de culpabilité, d’imputabilité, le juge ou le juré, le juré surtout, moins délié d’esprit, est affolé, parce que le principe, comme guide pratique, est archifaux. « Est-il coupable, crie l’avocat, cet homme que la monstruosité même de son crime montre idiot ; cet homme qui, depuis sa naissance, avant l’acte qui l’amène devant vous, n’a jamais fait que des extravagances ? Non, c’est un malade ; soignez-le ! »
— C’est vrai, dit le juré, il n’est certainement pas coupable [et c’est vrai] Donc je l’acquitte ».
C’est le donc qui est stupide ; c’est justement parce que cet homme était incapable de culpabilité qu’il fallait le coffrer.
— « Est-il coupable, cet homme qui, condamné trois fois pour vol, vole encore ? C’est un maniaque. Punit-on les maniaques ?
— Non il n’est pas coupable puisqu’il l’est si souvent » dit le juré et il acquitte.
— « N’est-il pas dix fois coupable, dit le ministère public, cet homme jusque-là homme de bien, très sain d’esprit et même très intelligent qui commet une escroquerie, abusant justement de sa réputation d’honorabilité pour se donner des facilités à la commettre.
— Oui il est dix fois coupable se dit le juré [et c’est vrai] Donc celui-ci je ne le manque pas. »
C’est le Donc qui ne vaut rien. Il faut attendre pour punir, ou pour punir sévèrement, qu’il y ait récidive.
Ainsi de ce principe faux — dans l’ordre pratique, dans l’ordre de la répression — de la culpabilité, de l’imputabilité, dérivent des collections d’absurdités dans les jugements ; et tout au moins et toujours dérive une incertitude continuelle dans l’esprit de ceux qui jugent, puisqu’ils ne savent plus, dont on ne peut leur en vouloir, si c’est le plus coupable qui doit être puni le moins ou le plus, si c’est le moins coupable qui doit être puni moins ou davantage.
C’est que le principe est faux ; il en faut un autre. Il faut se placer au point de vue de la nocivité et de l’intimidation.
De la nocivité ; il ne s’agit pas de savoir s’il est coupable ou non coupable ; nous n’en savons rien ; c’est une question de philosophie ; s’il est responsable ou irresponsable ; nous n’en savons rien ; c’est une question de philosophie ; il s’agit de savoir s’il est dangereux et dans quelle mesure il l’est. Il l’est effroyablement si c’est une brute et si, par conséquent, il est non coupable. Non coupable peut-être ; mais je le mets hors d’état de nuire parce qu’il est dangereux. Il est assez dangereux s’il est à demi brute, à demi intelligent ; je le mets hors d’état de nuire en le soignant, en l’éduquant, en tâchant de faire que sa partie intelligente arrive à prendre le pas sur l’autre. Il est peu dangereux s’il est très intelligent et a fait une sottise ; plus coupable peut-être qu’un autre ; mais c’est sur quoi les philosophes disserteront ; je le châtie car il a besoin d’une leçon ; mais surtout je le mets entre les mains de gens qui lui montreront combien, précisément parce qu’il était intelligent, il a été absurde.
De l’intimidation : ces gens, non seulement ceux qu’on amène devant nous qui jugeons, mais leurs congénères, sont susceptibles de peur des coups et les plus bêtes d’entre eux ne sont même susceptibles que de cela. La peine doit être un moyen de mettre hors d’état de nuire ; elle doit être surtout un moyen d’intimidation. Les animaux, plus sensibles du reste que les hommes aux moyens de douceur, sont tous, d’autre part, éducables par intimidation ; les hommes qui se rapprochent de l’animalité sont très sensibles à l’intimidation et partiellement éducables par elle. Il faut que les dangereux, que les nocifs aient peur de la peine ; que la peine ne soit pas douce, qu’il n’y ait aucune raison de ne pas la craindre, de la désirer ou de s’y risquer par avance avec une insouciance gaie. Les peines corporelles usitées en Angleterre sont des choses excellentes parce qu’elles intimident et celui qui les subit, qui n’aura pas envie, une fois sorti de geôle, de s’y exposer de nouveau et les vicieux qui n’ont pas encore commis de crime et que la connaissance qu’ils ont de la peine à subir n’encourage pas à en commettre.
Il va sans dire que jamais ces peines ne doivent empêcher, dans les intervalles, de travailler à l’éducation, au redressement, à l’amendement du coupable. Toute prison doit être un hôpital puisque nous avons affaire à des malades ; toute prison doit être une école puisque l’école est l’hôpital des malades du cerveau ; mais il ne faut pas que la prison-hôpital-école soit un lieu agréable pour le criminel, puisque l’un des moyens de redressement et d’amendement est l’intimidation elle-même.
Quant à la peine de mort elle a contre elle, évidemment, qu’elle exclut l’intimidation de celui qui la subit et l’amendement de celui qui la subit et qu’elle n’a pour elle que l’intimidation de ceux qui seraient disposés à se mettre dans le cas de la subir. C’est — je vous demande pardon d’écrire en pareil sujet un mot qui peut faire sourire — c’est une peine incomplète ; c’est parfaitement, au point de vue de la doctrine, une peine incomplète : elle n’a qu’un objet sur trois ; elle ne vise qu’à l’intimidation générale. Je la crois nécessaire dans certains pays et dans certains temps ; dans les pays et dans les temps où l’absence générale d’éducation religieuse et d’éducation morale crée une couche sociale très considérable qui est toute composée de purs bandits ; dans les temps et dans les lieux où la douceur, voire même la nullité des autres répressions ne laisse intimidante que celle-ci ; dans les temps où une recrudescence de la criminalité rend nécessaire un retour offensif d’intimidation.
Par exemple au commencement du XXe siècle en France, pendant cinq ou six ans, il n’y eut plus d’exécution ; la criminalité s’accrut d’une façon si foudroyante que l’on revint à la pratique des exécutions capitales. Ce retour est trop récent pour que l’on ait pu constater par statistique si une diminution des crimes a coïncidé avec lui. Très partisan de la peine de mort s’il est prouvé qu’il n’y a que cela qui fasse de l’effet, très adversaire d’une peine qui n’est qu’intimidante, si d’autres sont aussi intimidantes qu’elle, je souhaiterais un essai qui serait facile à faire. Qu’un pays comme l’Angleterre, qui châtie dans les prisons, et durement, et chez qui la prison n’est pas un simple lieu de réunion, suspende la peine de mort pendant dix ans. Si, pendant ces dix ans, la criminalité n’augmente pas, ce sera preuve que la prison avec châtiment et régime d’intimidation suffit ; et l’on devra abolir la peine de mort ou la laisser suspendue. Si la criminalité augmente, ce sera preuve que la prison avec châtiment ne suffit pas et que la peine de mort a une vertu intimidante, spéciale et spécifique, à laquelle on aurait le plus grand tort de renoncer.
En doctrine pénale il ne faut parler ni de culpabilité, ni de responsabilité, ni d’imputabilité ; il ne faut parler que de danger social plus ou moins grand. Il faut revenir au sens vrai des mots. Que veut dire innocent ? Il veut dire qui ne nuit pas ; que veut dire nocent ? Il veut dire qui nuit. Voilà le sens social des mots. Que par intervention d’une subtile philosophie et en considération de la responsabilité et de l’irresponsabilité, innocent ait fini par désigner le plus nocif des hommes et d’autant plus innocent qu’il est plus nocif, laissons cela et ne nous défendons que contre le nocent ; en lui accordant si l’on veut qu’il n’est pas coupable ; mais en l’empêchant rigoureusement d’être nocif.
Voilà la vérité pénale. Mais on conçoit combien cette invention de l’irresponsabilité morale, insidieusement confondue avec l’irresponsabilité sociale a jeté de trouble dans l’âme des jurés. L’irresponsabilité des criminels a augmenté chez les jurés la passion d’être irresponsables eux-mêmes et, aimant à acquitter par bonté d’âme et douceur française, ils ont été ravis d’avoir un prétexte à le faire. Chaque juré s’est dit : « A ces questions de responsabilité psychique je n’entends pas grand’chose ; mais ce que je comprends à ces criminels irresponsables, c’est que c’est moi qui le deviens. Voilà une très bonne affaire. »
Irresponsabilité des magistrats qui peuvent se décharger sur la loi du soin de juger ; irresponsabilité des magistrats qui peuvent et qui croient devoir, dans les affaires les plus importantes, se décharger sur le gouvernement du soin de juger ; irresponsabilité des jurés, qui, outre qu’ils n’ont pas à donner de considérants, peuvent se décharger sur le gouvernement, par recours en grâce, du soin de juger et en particulier de juger rigoureusement ; irresponsabilité des criminels augmentant chez les jurés la terreur de prendre la responsabilité de juger ; voilà les différentes et assez nombreuses, je crois, irresponsabilités qui énervent en France toute la justice et particulièrement la justice répressive et en font un pays où la sécurité la plus assurée est encore, quoique malheureusement incomplète, celle des criminels.
Faut-il donc et abolir le jury et revenir à la vénalité des charges ? Il faut certainement abolir le jury qui a fait toutes ses preuves d’incapacité, à tel point qu’il est considéré par tout le monde comme le hasard et que tout le monde, avocats comme ministère public, disent toujours : « Avec le jury il n’y a rien à prévoir. »
Pour le rétablissement de la vénalité des charges j’en serais très partisan. Quelque monstrueuse qu’elle paraisse, elle existe encore pour certaines charges ; les charges d’avoués et de notaires sont vénales et cela n’excite pas l’indignation publique, parce que cela existe. Or seriez-vous mal jugés par des notaires ou des avoués dont on exigerait d’ailleurs qu’ils fussent docteurs en droit ? Vous le seriez fort bien, avec une très grande indépendance et un mépris, sinon absolu, du moins très grand et très général, des compromissions. Préfériez-vous l’être par des préfets et des sous-préfets ? Non ? Eh bien c’est précisément par des préfets et des sous-préfets que vous l’êtes.
Mais à la rigueur on peut ne pas revenir à la vénalité des charges. Encore qu’elle vaille mieux que tout, je n’hésite pas à le dire, on peut trouver autre chose. J’ai dix fois exposé, ce qui m’engage à être court, qu’il suffirait de faire de la magistrature un ordre de l’État indépendant, comme elle l’était, par exemple par le moyen suivant : l’État paye les magistrats ; mais il ne les nomme pas et ne les avance pas ; il n’intervient aucunement dans leurs nominations ni dans leurs promotions ; les voilà indépendants.
Qui les nomme et qui les avance ? La Cour de cassation ; c’est elle qui fait toutes les nominations et promotions de toute la magistrature assise de France.
Mais si c’est le gouvernement qui nomme la Cour de cassation ?
Il ne la nomme pas.
Qui la nomme ?
La magistrature de France par élection, au fur et à mesure des extinctions.
De la sorte la Cour supérieure nommant la magistrature et la magistrature nommant la Cour suprême, la magistrature est un corps fermé, autonome et autogène, qui ne dépend que d’elle-même et ne provient que d’elle-même, exactement comme la magistrature de l’ancien régime, ce qui est précisément ce qu’il fallait obtenir.
Seulement comme, à la différence de l’ancien régime, le gouvernement paye la magistrature, et que celui qui paye est toujours un peu le maître ; comme aussi la loi constituant la magistrature comme je viens d’indiquer qu’elle est constituée peut être changée par le Parlement en un tournemain, il faut que la loi constituant la magistrature comme un ordre de l’État soit une loi constitutionnelle entourée des plus fortes garanties et qui, par exemple, ne pourrait être changée que par un plébiscite.
Ainsi la magistrature sera un ordre de l’État, ce qu’il faut qu’elle soit pour que l’on soit bien jugé.
— Mais cela est ultra-aristocratique !
— Je reconnais que cela est ultra-aristocratique.
Le Français dans le choix de sa profession obéit exactement aux mêmes tendances. Sa passion, soit pour lui, soit pour ses fils, soit pour ses filles, est une profession de tout repos. Et par profession de tout repos il en entend une où il n’y ait aucun risque ni aucune responsabilité. Le Français veut de toutes ses forces, de tout son appétit, que son fils soit fonctionnaire et que sa fille épouse un fonctionnaire. Un fonctionnaire est un homme qui a pour premier devoir et presque pour seul devoir de n’avoir pas de volonté : « Il réunissait, dit Goncourt, les deux grandes vertus du fonctionnaire, la paresse et l’exactitude. » C’est bien dit : le fonctionnaire est un rouage ; on ne lui demande que de s’engrener exactement ; on ne lui demande pas d’initiative, ni de zèle, ni de travail ; cela troublerait tout, gênerait le mouvement général, mettrait une perturbation dans l’ordre établi. Travailler infiniment peu et ne jamais penser par lui-même ; mais venir s’ajuster à la machine à l’heure juste et à la minute où la machine le réclame, c’est tout ce qu’on lui demande.
— Va pour l’exactitude et l’absolue passivité, me dira-t-on, mais pour ce qui est du travail il en faut cependant ; puisqu’il y a une certaine quantité de travail qu’il faut qui soit faite.
— Point du tout, répondrai-je. Étant évaluée à huit heures par jour la quantité de travail ressortissant à un emploi et à huit mille francs par an la somme qu’il conviendrait d’appliquer à cet emploi, l’État, connaissant bien la manie du Français et que, quelque peu qu’il paye l’emploi, l’emploi sera toujours demandé, coupe cet emploi en deux et a deux fonctionnaires à qui il ne donne que quatre mille francs, à qui il ne demande que quatre heures de travail ; — puis, avec le temps, chacun de ces deux demi-emplois il le subdivise en deux et il a quatre fonctionnaires à qui il ne donne que deux mille francs et à qui il ne demande que deux heures de travail par jour ; — puis il subdivise encore et a huit fonctionnaires à qui il donne mille francs par an, à qui il ne demande qu’une heure de travail par jour. Il est bien forcé de s’arrêter là. Il s’y arrête pour ce qui est de ce qu’il donne comme traitement, mais non point pour ce qu’il demande de travail. Les sollicitations croissant en nombre sans cesse, il subdivise encore pour créer des emplois nouveaux et, pour payer les nouveaux fonctionnaires, il demande à l’impôt public un nouvel effort et il arrive ainsi à avoir des fonctionnaires qui reçoivent à peu près mille francs, mais qui ne donnent et ne peuvent donner qu’une demi-heure de travail.
Et le vœu du Français est satisfait : ne pas travailler, toucher peu, avoir une retraite, n’avoir aucune volonté ni aucune responsabilité. Le métier de tout repos, il l’a dans tous les sens et dans toute l’étendue de l’expression.
Tout cela vient des deux traits principaux de la bourgeoisie française : la peur du risque et la paresse, qui sont deux formes de l’horreur des responsabilités. La peur du risque est effroyable chez nous. Mettre ses fonds dans une entreprise industrielle où le rapport serait 10 %, avec deux chances sur trois de les perdre, ou les placer en rentes sur l’État où ils rapporteront 3 %, c’est mathématiquement la même chose. Moralement c’est tout différent et deux chances sur trois de tout perdre, cela terrifie le Français comme la perspective de la mort ; cela lui fait dresser les cheveux sur la tête. Mais encore pourquoi ? Parce que risquer est assumer une responsabilité terrible ; le Français se sent responsable devant ses enfants de cette fortune qu’il aventurerait ; le rouge lui monte au front de la honte qu’il aurait à dire : « J’ai tout perdu » ; et sa satisfaction est immense de penser qu’il dira : « J’ai très peu augmenté votre avoir ; mais je l’ai très peu aventuré. » Il n’aura jamais été responsable.
Cela devient pour les Français une sorte de devoir. Prêter à l’État français leur semble patriotique ; prêter à l’industrie leur paraît frustrer l’État comme si le plus grand service à rendre à l’État, n’était point de contribuer à lui faire une nation industrielle, commerçante et riche. J’en sais qui considéraient comme antipatriotique d’avoir des fonds russes, comme si le moyen d’avoir des alliances n’était pas de créer des liens financiers entre des peuples, puissants du reste, et même faibles, mais ayant de l’avenir, et nous-mêmes. Mais il y a un risque. « La raison nous enseigne qu’il faut travailler pour l’incertain » nous dit Pascal. De tous les penseurs français, et non pas seulement à ce point de vue, Pascal est bien celui qui a eu le moins d’influence sur la mentalité française.
La paresse, cette autre forme de l’horreur du risque, d’ailleurs dérivant aussi d’autres sources, a son influence encore, considérable, sur le goût du Français pour « avoir une place ». Cette bourgeoisie est bien curieuse ; par admiration ancestrale, mêlée d’envie pour l’ancienne aristocratie de ce pays, elle a pris exactement tous ses défauts sans prendre aucune de ses qualités. Tous ses défauts sans qu’il en manque un. Elle méprise le peuple et vous ne sauriez croire à quel point elle se croit d’une autre race que lui, si ce n’est pas d’une autre espèce ; et, comme le peuple travaille beaucoup, elle croit fermement que c’est signe de haut rang que de « vivre noblement », c’est-à-dire ne rien faire. Vivre noblement est absolument son idéal. L’employé qui doit aller à son bureau de dix heures à midi et de deux heures à cinq, vous ne le verrez jamais dans la rue avant dix heures, parce qu’il aurait l’air d’un homme qui gagne sa vie dès l’aurore ; en revanche il se promènera avec orgueil de cinq à sept aux endroits passants de sa petite ville, pour bien marquer que sa journée à lui est bien finie, trois heures avant celle où est finie celle de l’ouvrier.
Et du reste il jalouse de tout son cœur celui, peu différent de lui cependant, qui ne fait rien du tout et que l’on voit flâner de deux heures à cinq. Celui-ci se montre fastueusement à toutes les heures où ceux qui ont un métier sont dans leurs bureaux.
Cette bourgeoisie, encore, veut tout tenir de l’État, comme la noblesse ancienne voulait tout tenir du roi et elle court la sinécure comme les Lauzun couraient la pension, chacun pour lui, pour ses enfants, pour ses gendres et ses neveux et cela est partie orgueil, partie platitude, partie paresse.
La combinaison de paresse et d’orgueil a été bien vue par Montesquieu. Voyez, dit-il, « les maux infinis qui naissent de l’orgueil de certaines nations : la paresse, la pauvreté, l’abandon de tout, la destruction des nations que le hasard a fait tomber entre leurs mains et la leur même. La paresse est l’effet de l’orgueil… »
La paresse est surtout l’effet de la paresse ; mais il est très vrai qu’elle l’est un peu de l’orgueil : se distinguer de l’ouvrier et s’en distinguer par le signe le plus visible ; il travaille, ne pas travailler ; les citoyens des républiques anciennes, qui étaient des aristocrates, avaient le mépris profond de celui qui faisait quelque chose ; pour Aristote lui-même, si intelligent, l’artisan est un demi-esclave.
« La paresse est l’effet de l’orgueil, le travail est une suite de la vanité. »
Il y a du vrai ; cependant la vanité n’étant qu’un petit orgueil ou plutôt que l’orgueil dans une âme petite, il a le plus souvent les mêmes effets que l’orgueil lui-même ; c’est par orgueil-vanité que la petite bourgeoisie française ne travaille pas.
« Le travail est une suite de la vanité : l’orgueil d’un Espagnol le portera à ne pas travailler ; la vanité d’un Français le portera à savoir travailler mieux que les autres. Toute nation paresseuse est grave ; car ceux qui ne travaillent pas se regardent comme souverains de ceux qui travaillent. »
Songez à la morgue espagnole de la bourgeoisie française ; elle est très grave ; elle n’aime pas rire ; elle n’aime pas l’esprit ; elle aime s’ennuyer avec dignité.
« Toute nation paresseuse est grave ; car ceux qui ne travaillent pas se regardent comme souverains de ceux qui travaillent. Examinez toutes les nations et vous verrez que dans la plupart [il dit la plupart parce qu’évidemment il fait une exception mentale pour l’Angleterre] la gravité, l’orgueil et la paresse marchent du même pas. Les peuples d’Achem sont fiers et paresseux ; ceux qui n’ont point d’esclaves en louent un, ne fût-ce que pour faire cent pas et porter deux pintes de riz : ils se croiraient déshonorés s’ils le portaient eux-mêmes. »
Dans toute petite ou moyenne ville de France, tout bourgeois et bourgeoise se croiraient déshonorés s’ils portaient dans la rue un paquet gros comme le poing.
« Les femmes des Indes croient qu’il est honteux pour elles d’apprendre à lire ; c’est l’affaire, disent-elles, des esclaves qui chantent des cantiques dans les pagodes… »
Les jeunes filles de la bourgeoisie française méprisent celles qui poussent leurs études au delà de l’enseignement primaire : c’est donc que celles-ci veulent apprendre un métier, qu’elles veulent devenir institutrices, professeurs, qu’elles veulent déchoir ; elles n’ont donc pas de quoi ?
La bourgeoisie française ressemble encore à l’ancienne noblesse en ce qu’elle a le culte de l’ignorance. Elle méprise le savant, le littérateur, l’artiste, gens de peu de bon sens, à idées souvent excentriques, et tout compte fait, peu équilibrés et surtout qui font quelque chose, signe d’infériorité de race et d’infériorité mentale ; et encore qui, pour la plupart, n’ont pas une place du gouvernement ; car les deux signes de supériorité sociale c’est de vivre noblement et d’avoir une place de l’État, deux choses qui le plus souvent se confondent.
La bourgeoisie française ne lit pas. Nos éditeurs le savent ; n’étaient les livres scolaires pour les lycéens, et les journaux et la papeterie, il n’y aurait pas de libraires en province, sauf dans trois ou quatre grandes villes.
Le souci de la gloire scientifique, littéraire et artistique de la France est parfaitement inconnu de la bourgeoisie française. Vivre de l’État en le servant nonchalamment et mépriser tout le reste, c’est son état d’âme permanent.
Elle ne se doute pas à quel point elle est socialiste et à quel point, quand elle reproche aux ouvriers d’être socialistes, elle est illogique. Ou plutôt elle se rend compte obscurément de la chose : elle est socialiste pour elle et ne veut pas que les autres le soient pour eux. J’ai entendu un beau mot d’un parfait bourgeois, fonctionnaire, républicain, radical, anticlérical : « Les socialistes ! Tous fonctionnaires, c’est leur doctrine ; ils veulent tous être fonctionnaires ; ils veulent que tous soient fonctionnaires. » C’est parfaitement la vérité ; mais le ton dont il le disait était à mettre en musique. Les ouvriers fonctionnaires, les paysans fonctionnaires ! N’était-ce pas à faire pitié ou à éclater de rire. Voyez un peu la belle espèce ! Ces gens-là être fonctionnaires comme moi, payés par l’État comme moi ! Avez-vous idée de cela ! Je croyais entendre M. de la Pretintaille disant : « Ces marauds prétendent à être tous nobles ! »
La petite bourgeoisie française ressemble encore trait pour trait à l’ancienne noblesse par la façon d’élever ses enfants. Pour les fils, l’ancienne noblesse cherchait tout de suite quelque grand seigneur qui pût les prendre en faveur et les pousser dans le monde ; pour les fils, la bourgeoisie actuelle cherche tout d’abord quelque gros fonctionnaire qui puisse être « protecteur » ; la recherche des protections est tout le souci et toute l’angoisse du bourgeois père de famille. Pour les filles, l’ancienne noblesse avait le couvent ; la bourgeoisie pauvre n’a pas le couvent mais, ayant tout l’orgueil de caste de l’ancienne noblesse, elle élève ses filles exactement comme l’ancienne noblesse élevait les siennes. Elle ne leur apprend rien, ni métier manuel ni métier intellectuel. Il ne faut pas qu’une petite bourgeoise devienne une ouvrière, même de premier ordre, patronne, et gagnant dix mille francs par an ; ni un professeur gagnant six mille ; ni une artiste gagnant vingt mille ; cela est une épouvantable déchéance ; il ne faut même pas qu’elle ait l’air de se préparer par l’éducation qu’on lui donne à un de ces métiers-là ; cela indiquerait qu’elle en a besoin, qu’elle n’a pas de dot ; la dignité de la famille s’oppose à cette révélation ou à ce qui aurait l’air d’être une révélation de ce genre.
La jeune fille n’apprend rien par orgueil de caste et par conséquent se met bien au-dessous de la fille du peuple matériellement et moralement. Matériellement : ou elle se mariera ou elle ne se mariera pas. Si, par insuffisance dotale ou revers de famille aboutissant à insuffisance dotale non prévue, elle ne se marie pas, elle reste vieille fille pauvre, exactement comme la jeune fille de l’ancienne noblesse qui était mise au couvent, et elle est beaucoup plus malheureuse que la fille du peuple qui, elle, a toujours son métier en main.
Si elle se marie, ou elle a un bon mari, ou elle en a un mauvais, ou elle devient veuve. Si elle a un bon mari, il n’y a rien à dire sinon qu’elle a eu de la chance à la loterie ; si elle a un mauvais mari, elle est forcée de le subir, n’étant pas un être capable de gagner sa vie et elle est épouvantablement malheureuse, puisqu’elle l’est sans possibilité ni espoir de changement ; si elle devient veuve, elle retombe à la charge de ses parents ou de l’État (car très probablement son mari était fonctionnaire) et elle grossit l’affreux troupeau des solliciteuses qui bat les portes des antichambres officielles.
Moralement : la jeune fille de la bourgeoisie est très au-dessous de la fille du peuple, parce que la fille du peuple est un être libre et que la jeune fille de la bourgeoisie est un esclave.
Parce qu’elle ne peut pas gagner dix sous par jour la jeune fille de la bourgeoisie n’a pas d’autre carrière que le mariage ; en conséquence :
Elle est à peu près forcée de prendre le mari que sa famille lui présente, terrorisée ou au moins intimidée par la vie qu’on lui fera dans sa famille si elle le refuse ; et, comme dans l’ancienne noblesse, à cause des usages, la jeune fille était forcée d’accepter le mari qu’on lui présentait à seize ans, quitte à prendre plus tard des compensations très légitimes ; de même, à cause des nécessités économiques, la jeune bourgeoise est forcée de subir le mari qu’on lui présente à vingt-cinq ans, quitte à prendre plus tard des revanches qui sont de droit.
Mariée avec un mari qui se trouve être bon, elle a un sort supportable, quoiqu’il n’y ait de sort vraiment supportable pour une femme que d’avoir épousé un homme qu’elle aimait ; enfin elle a un sort à peu près supportable ; mais encore elle se sent, devant ce bon mari, absolument dépendante de lui, dans l’impossibilité de le quitter s’il devenait mauvais, liée matériellement à lui et absolument incapable, à moins d’être absurde, quand il dit : « Je suis le maître », de lui dire : « Tu ne l’es pas. » Esclavage.
Mariée à un mauvais mari, elle a cette perspective, quelque prétendues mesures libératrices que, par le divorce, l’État ait prises en sa faveur, de ne pouvoir jamais se séparer de lui ; puisque c’est lui qui gagne l’argent et puisqu’elle est incapable d’en gagner ; et il n’y a texte de loi qui vaille contre cela et qui permette à la femme libre de s’en aller, quand, de par la nécessité de manger, elle est forcée de rester. Esclavage.
Veuve enfin, elle passe de l’état d’esclave à celui de mendiante publique, ce qui est, à la vérité, une promotion ; car c’est passer de l’état de mendiante privée à celui de mendiante publique ; mais encore solliciter les secours de l’État ou de la municipalité, essuyer les rebuffades, s’entendre dire : « Travaillez » et répondre : « Vous savez bien que je ne sais rien faire ; je suis une bourgeoise », cela est extrêmement dur. Esclavage.
Par orgueil de caste et pour que leurs filles ne fassent point comme des ouvrières ou n’aient pas l’air de faire comme des ouvrières, les bourgeois mettent leurs filles bien au-dessous des ouvrières ; ils les mettent dans une condition servile.
Et c’est avec entêtement, avec susceptibilité et avec gloire : la plus grande injure — prenez-y bien garde ! — que vous puissiez faire à un bourgeois de France c’est de lui dire : « Vous devriez faire apprendre un métier à votre fille. »
— Un métier ? Couturière ? Pour qui me prenez-vous ?
— Un métier moins lucratif, institutrice, professeur.
— Étudiante ? Pour qui me prenez-vous ?
Vous voilà brouillé avec lui (ce n’est pas que ce me soit arrivé ; je ne suis pas assez bête pour avoir jamais dit cela à un bourgeois).
Or il a trente-cinq mille francs à donner en dot à sa fille. Mais sa dignité s’oppose à ce que sa fille s’élève intellectuellement au rang d’ouvrière ou d’institutrice. Il aime mieux qu’elle soit une chose. Oui ; car pas même une servante.
Je voulais placer une jeune fille tombée en misère. Institutrice, il n’y fallait pas songer ; elle était petite bourgeoise, je doute qu’elle sût lire. Ouvrière ? En quoi ? Elle ne savait pas l’alphabet même d’aucun métier. Alors servante, disais-je à la dame à qui je parlais d’elle : « Mais, non ! Vous ne savez donc pas que les servantes sont des ouvrières ? Elles sont des ouvrières en cuisine ou des ouvrières en chiffons. Votre jeune bourgeoise, ayant été élevée par sa bourgeoise de mère à ne rien savoir ni de cuisine ni de couture, ne peut être ni couturière ni femme de chambre. Les petites bourgeoises ne savent que parler correctement le français de leur province et ne sont aptes qu’à faire des enfants ; ni l’une ni l’autre de ces deux fonctions ne sont rémunératrices. »
Inversement une jeune fille est très modeste institutrice ; elle épouse un millionnaire ; le millionnaire en cinq ans gaspille sa fortune ; elle reste avec lui, devenu misérable. Il devient malfaiteur ; elle le quitte et redevient institutrice pour vivre et faire vivre un enfant qu’elle avait. Elle me disait : « Je ne suis pas du tout à plaindre : je suis une ouvrière qu’un fils de famille trouve jolie, prend pour maîtresse et abandonne quand il en a assez. Elle a toujours en réserve son métier et, abandonnée, elle revient tranquillement à sa machine à coudre. Moi de même. J’étais désolée des folies de mon mari, non éperdue de terreur ; j’avais un métier ; quand je n’ai plus pu y tenir, j’ai quitté sans désespoir. Je n’étais pas forcée de tomber moralement aussi bas que mon mari ; j’avais gardé ma machine à coudre. »
Faire de son fils un fonctionnaire ; marier sa fille avec un fonctionnaire ou un homme riche, voilà tout le rêve d’un bourgeois de France ; faire de son fils et de sa fille des êtres assez munis et assez armés pour être indépendants, voilà de quoi ou il n’a pas idée, ou il a horreur.
Relativement à ses filles, il ne s’aperçoit pas, lui, très vertueux et mettant à un très haut prix la chasteté féminine, qu’il risque fort d’en faire des courtisanes et que cela arrive assez souvent.
De deux façons : tout comme la jeune noble de l’Ancien Régime mariée sans qu’on la consulte, la jeune fille de la bourgeoisie de notre temps, mariée contre son gré ou sans son gré, est très préparée à prendre un amant plus tard. Les étrangers, malgré nos romans, sont priés de croire que cela est assez rare à cause de la médiocre sensualité des Françaises ; mais enfin je ne disconviens pas que cela arrive.
Autre façon, plus fréquente : la jeune fille à qui l’on n’a pas laissé d’autre carrière que le mariage et qui sait qu’elle n’a pas d’autre carrière que le mariage, encore que cette carrière soit très aléatoire, s’applique de toutes ses forces à y entrer : elle fleurette avec acharnement ; elle cherche avec acharnement et avec des ruses féminines à prendre un homme au filet ; elle fait métier de courtisane ; elle est vierge-courtisane, littéralement. Remarquez que la jeune fille qui ne fleurette pas, mais dont la mère fleurette pour elle (cas fréquent) et qui épouse sans l’aimer l’homme qu’on a racolé pour elle, est vierge-courtisane tout de même. Voilà où aboutissent les idées, traditions, préjugés et mœurs bourgeoises.
Ce tableau est un peu en retard. Depuis une génération ou un peu plus, les vierges-courtisanes sont sensiblement plus rares. Les jeunes bourgeoises ne fleurettent plus guère ; même elles ne se prêtent plus guère au fleuretage de leurs mères pour elles ; elles restent volontiers filles. Pourquoi ? Incontestablement parce que leur niveau moral s’est élevé et que le rôle de vierge-courtisane leur répugne et qu’elles ont l’idéal de toute femme à âme propre, épouser qui l’on aime ou ne point épouser. Fort bien ; mais comme, en même temps, elles sont toujours celles qui ne peuvent être qu’esclaves puisqu’elles ne peuvent gagner leur vie, elles ont des sentiments de femmes libres et ne peuvent remplir la destinée de femmes libres. Reste qu’elles demeurent filles dans la maison de leur père tant que leur père vit et petites choses très misérables et très tristes après, mineures toujours. « Qu’est-ce qu’un mineur ? demandait un enfant. A quel âge qu’on ne l’est plus ?
— Il n’y a pas d’âge, répondit son père : quand on gagne sa vie on n’est plus mineur ; tant qu’on ne gagne pas sa vie on est mineur. » Les bourgeois français ne rêvent qu’avoir des fils quasi-mineurs c’est-à-dire fonctionnaires et avoir des filles mineures jusqu’à leur décès.
Je suis bien loin de mon sujet ? J’y suis pleinement. C’est un peu de paresse, beaucoup d’orgueil, entendu tout de travers et surtout une terreur profonde des responsabilités qui font tous ces maux. Ne pas agir beaucoup ; mais surtout n’agir qu’en sous-ordre, et n’exercer de professions que celles où l’on agit en sous-ordre et n’avoir de situations, homme ou femme, que celles où l’on n’agit qu’en sous-ordre, c’est l’idéal bourgeois tout entier. Le bourgeois français aime passionnément à ne pas intervenir dans ce qu’il fait et à obéir à quelqu’un qui lui dicte ce qu’il a à faire et qui en soit responsable. « Ce que je fais ne me regarde pas » est le mot qu’il aime à dire et la pensée qu’il aime à conserver. Toute profession ou toute situation qui exige une activité libre lui déplaît, parce qu’elle exige qu’il prévoie, qu’il calcule, qu’il combine, qu’il fixe les chances pour ou contre et qu’en définitive il risque. Or prévoir, calculer, combiner et risquer, c’est se placer en face d’une responsabilité future, présente déjà en tant que prévue ; c’est-à-dire : « un jour aurai-je à me féliciter ; un jour n’aurai-je pas à me reprocher d’avoir fait cela ? » et cette responsabilité épouvante. Le Français redoute d’être responsable devant lui-même.
Voilà pourquoi le fonctionnariat le dévore et pourquoi ses filles répugnent tellement à être des êtres libres et pourquoi lui surtout n’a qu’avec horreur l’idée qu’elles le soient.
Observez combien en France il y a peu de professions libres et aussi comme les professions libres se nationalisent peu à peu, se transforment peu à peu en professions d’État. Il n’y a de professions libres que l’agriculture, l’industrie, le barreau et la médecine. Comprenez tous les métiers d’ouvriers dans l’industrie, naturellement. Or… d’abord le socialisme voudrait que toutes ses professions fussent nationalisées et que tout homme fût fonctionnaire de l’État et c’est probablement l’avenir ; mais laissons cela. En attendant que ce soit un avenir atteint, c’est la tendance générale. Les grandes entreprises industrielles, l’État veut se les annexer et commence à se les annexer en effet, jurant qu’elles seront mieux menées entre ses mains qu’en d’autres mains. L’événement ne prouve pas toujours d’une façon éclatante qu’il ait raison ; mais ce n’est pas la question présente.
Le Français aime-t-il que les choses se transforment ainsi, voilà la question présente. Or, oui. Et c’est bien simple. L’ouvrier des chemins de fer se dit : « Avec l’État, on travaillera moins, on aura moins de responsabilité, l’on avancera par la politique. On travaillera moins, parce que l’État ayant intérêt politique à accueillir favorablement plus de demandes d’emploi, multipliera les emplois et, selon sa coutume invariable, à son point de vue très rationnelle, mettra toujours trois fonctionnaires où il en faudra un. On travaillera moins et l’on aura moins de responsabilité, l’État ayant toujours intérêt à ne pas renvoyer des fonctionnaires qui sont les électeurs des parlementaires dont il dépend ; on aura moins de responsabilité. On avancera par la politique, tout de même que pour raisons politiques on ne sera pas renvoyé ; le fonctionnaire bon électeur, qui pourra très bien être bon fonctionnaire, avancera bien ; mais avancera bien mieux le bon agent électoral qui, parce qu’il sera bon agent électoral, sera mauvais fonctionnaire ; on avancera par la politique. »
L’intérêt personnel de l’ouvrier de chemins de fer, directement contraire, du reste, à l’intérêt général, est que l’industrie des chemins de fer soit nationalisée.
Les professions dites libérales se nationalisent aussi. Une foule de médecins rêvent d’être fonctionnaires et se font partiellement fonctionnaires. Ils obtiennent d’être médecins d’asile, médecins d’hospice, médecins de lycée, médecins de collège, médecins de chemin de fer (on sait que plusieurs chemins de fer sont d’État). Chose très remarquable et significative, ils n’y ont aucun intérêt. A moins d’être des médecins sans clientèle ils n’y ont aucun intérêt ; or l’État n’admet qu’exceptionnellement comme médecin à lui un médecin sans clientèle ; donc les médecins qui sollicitent d’être médecins d’État n’ont aucun intérêt à cela ; car ils sont beaucoup moins payés par l’État qu’ils ne le seraient par les particuliers et le temps qu’ils consacrent à l’État est presque du temps perdu, pendant lequel ils pourraient gagner de l’argent ailleurs. Un directeur de Compagnie de chemins de fer me disait : « Nous diminuons progressivement, conformément à la loi de l’offre et de la demande, les émoluments de nos médecins ; nous en trouvons toujours et de très bons ; nous finirons par ne les payer qu’en permis de circulation et nous en trouverons encore ; je ne comprends pas ; mais c’est ainsi. »
A un médecin qui me priait d’appuyer sa candidature à un poste de médecin de chemin de fer je demandais : « Pourquoi y tenez-vous ? C’est une perte. Pendant les heures que vous donnerez à l’administration vous gagneriez le quintuple de ce qu’elle vous allouera ; sans compter que pendant ces heures si pou rémunérées vous manquez les occasions de métier utile, n’étant pas chez vous quand on vous vient chercher, etc. Vous êtes comme un petit commerçant bien achalandé qui fermerait son magasin six heures par jour, pendant lesquelles il irait travailler dans un petit bureau des contributions indirectes. Serait-il bien pratique ? Pourquoi donc y tenez-vous ? »
Il me répondit : « Il y a un titre et un fixe. » C’était un grand mot. Un titre et un fixe, c’est la devise même du Français. Avoir quelque chose à mettre au-dessous de son nom sur ses cartes de visite et être peu payé d’une façon très régulière, c’est le double rêve de tout bourgeois français. Avoir un titre c’est pour sa vanité ; avoir un fixe c’est pour son goût de sécurité, pour l’apaisement de sa terreur du risque et des responsabilités, pour satisfaire, au moins partiellement, son horreur de l’aventure.
Il ne faut pas croire que dans la passion qu’ont beaucoup de professeurs pour le monopole de l’enseignement il n’y ait que la haine du christianisme et l’horreur de la liberté. Il y a beaucoup de cela, je me fais un plaisir de le reconnaître ; la haine du christianisme et l’horreur de la liberté sont des sentiments français au premier chef ; mais dans cet amour énergique pour le monopole de l’enseignement il y a aussi autre chose. Il y a le désir, non seulement d’appartenir soi-même à l’État et d’être sustenté par lui et de n’enseigner que ce qu’il veut qu’on enseigne ; mais le désir que tout professeur soit dans cette situation, qu’il n’y ait aucun professeur qui n’y soit. Pourquoi ? Parce que le professeur d’État, quoique profondément dévoué à l’État, a un peu honte d’être un homme lié, d’être un homme dont la pensée n’est libre que dans une mesure assez restreinte et par conséquent désire qu’il n’y ait aucun professeur qui soit, ou même qui paraisse plus libre que lui. Ce sentiment est naturel.
On me dira : beaucoup ne l’ont pas et qui sont peut-être la majorité. C’est très vrai ; mais c’est parce que ceux-ci sont très intelligents. Ils comprennent ceci : la liberté des travailleurs libres est garantie de la liberté relative des travailleurs de l’État. Évidemment ! S’il n’y a que travailleurs d’État, l’État, d’abord les paye ce qu’il veut et a une tendance, à laquelle il finit par céder, de ne leur donner que des salaires de famine ; ensuite il peut exiger d’eux, travailleurs manuels, en efforts physiques, travailleurs de la pensée, en servilité, tout ce qu’il veut ; esclavage pur ; c’est ce que le régime socialiste réaliserait. Mais s’il y a des travailleurs de l’État et des travailleurs libres, le travail libre fait au travail d’État une concurrence de liberté ; c’est-à-dire que le travailleur d’État, s’il est trop molesté, peut toujours s’évader du travail d’État et se jeter dans le travail libre ; et, parce qu’il le peut, il est libre virtuellement et, parce que l’État sait qu’il le peut, il est forcé de lui laisser une certaine mesure de liberté, même réelle, comme aussi de le rémunérer honnêtement.
La liberté du travailleur libre fait donc la liberté relative du travailleur encaserné.
Les professeurs, pour revenir à leur cas particulier, savent donc très bien que s’ils sont libres dans une mesure très acceptable, c’est parce qu’il n’y a pas de monopole de l’enseignement et ils se disent : « Si nous avions le monopole d’enseigner, nous serions bien ! C’est pour nous que la souveraineté c’est la mort ! »
Je suis entré dans l’enseignement d’État (très averti de ce qu’il était, puisque mon père était professeur) sans aucune appréhension, parce qu’il y avait un enseignement libre, ce qui, d’une part me permettait de sortir de l’enseignement d’État, et d’autre part me permettrait de n’en pas sortir, m’y assurant une vie tolérable précisément parce que l’État savait qu’en sortir m’était possible. S’il n’y avait pas eu d’enseignement libre je ne serais pas entré dans l’enseignement d’État.
— De sorte que vous seriez entré dans l’enseignement libre que s’il n’y en avait pas eu !
— Non ; je ne me serais mis dans aucun enseignement ; j’aurais pris une autre carrière.
— Mais si toutes les carrières eussent été d’État ?
— Régime socialiste ; alors j’aurais été dans un autre pays, estimant qu’un pays en pur régime socialiste est inhabitable.
Ceux des professeurs qui repoussent le monopole de l’État raisonnent donc parfaitement dans leur intérêt même et en dehors de toute considération de principes et idées générales.
Mais ceux qui désirent le monopole sont gens, d’abord, comme je l’ai dit, qui sont étatistes, ou gens qui ont à l’égard du christianisme une invincible répulsion ; ensuite des gens qui aiment qu’on leur impose une façon de penser parce qu’ils aiment qu’on pense pour eux et voilà précisément le fond des choses.
Il n’y a rien de plus curieux à étudier que cette mentalité. C’est une mentalité catholique. Les penseurs partisans du monopole sont des catholiques ultramontains. Le catholique est un homme qui fuit la responsabilité de penser. Eux tout de même, exactement. La responsabilité de penser est très lourde. Elle a fait trembler plus d’un esprit. Il ne faut pas manquer de courage et il faut manquer de modestie pour se dire à un moment donné : « Je ne tiendrai pas compte de la pensée de mon troupeau et je tâcherai de penser avec mon cerveau comme je digère avec mon estomac. » Cela n’a l’air de rien et cela demande un immense effort. Il est étonnant comme l’homme est naturellement modeste. Il délègue des gens pour penser pour lui et il se reconnaît incapable de penser lui-même. Tout le catholicisme n’est que cela.
J’ajoute tout le protestantisme, à très peu près. Sans doute les protestants pénétrés de la pensée de Luther ont des formules de ce genre : « Toute religion que l’on ne s’est pas faite à soi-même est une superstition et non une religion » ; « Faites-vous vous-même une âme, ou vous n’en aurez point » ; « Celui qui accepte d’un autre l’âme qu’il doit avoir n’est qu’un corps. » Si bien que je disais à un protestant : « Alors, tout protestant qui n’est pas hérétique au protestantisme n’est pas protestant ? » — « Vous croyez plaisanter », me répondit-il.
Oui, les protestants ultra-libéraux raisonnent ainsi ou font effort pour raisonner de la sorte. Mais la plupart ne sont que des catholiques latitudinaires. Ils ont leur dogme où ils prétendent parfaitement que le fidèle s’ajuste et ils demandent très bien au fidèle de donner sa démission d’être pensant. La seule différence c’est qu’ils sont moins stricts. In dubiis libertas. Il y a seulement un peu plus de dubia chez les protestants. L’esprit catholique domine et pénètre toutes les religions parce qu’il est l’esprit religieux lui-même ; l’esprit religieux c’est : craignez de penser isolément ; pensez par troupe ; væ soli putanti.
C’est cet esprit religieux, c’est cet esprit catholique que les monopolistes possèdent admirablement ou plutôt dont ils sont possédés. Pour eux, comme pour les catholiques, il faut qu’il n’y ait qu’une croyance. Qui la donnera ? Le troupeau à chacun. Et qui la donnera au troupeau ? le chef du troupeau. Ils sont les fidèles de l’État-Pape.
Et ce papisme anticlérical est, comme le pape catholique quand il est puissant, partisan de toutes les mesures de coercition et n’admet de clergé de la pensée que le sien et que celui de la sienne ; cela est bien simple.
Mais pourquoi les monopolistes ont-ils cet état d’esprit, en dehors, assez souvent, de toute pensée religieuse ou politique ? Un peu par monisme, un peu et surtout, par effroi de la responsabilité intellectuelle. Le monisme, qui est un goût très répandu, est le culte de l’uniformité. Que tout soit égal, cela, pour certains esprits, est très beau et satisfait leur esthétique particulière et pour que tout soit égal le meilleur moyen est que toutes choses soient la même chose. Une seule pensée dans tout l’État cela nivelle et égalise admirablement tous les cerveaux et ne permet pas ces différences entre les esprits supérieurs et les esprits moindres qui sont si désagréables à la vue ; une seule pensée dans tout l’État, cela est l’ordre même, puisqu’il est le contraire de l’irrégularité et par conséquent du désordonné ; une seule pensée dans tout l’État c’est la fin de l’anarchie et l’anarchie impossible ; il n’y a pas de plus beau spectacle ; c’est la Bauce ; la Bauce est une perspective admirable.
N’y a-t-il pas une douleur presque physique à voir un Voltaire et un Rousseau différer d’opinion pendant vingt ans et, par leurs disciples, pendant beaucoup plus longtemps ? Ce douloureux spectacle aurait été épargné à l’humanité s’il y avait eu unité de pensée imposée par une autorité intellectuelle supérieure qui n’eût pas admis de divergences. Cette pensée unique, résumé de la pensée générale de la nation, eût sans doute supprimé Voltaire aussi bien que Bousseau et Rousseau aussi bien que Voltaire, mais elle eût établi l’uniformité et il n’y a rien de beau comme l’uniformité, ce signe et du reste cette forme de l’égalité. Ut fint æqualitas.
Avez-vous remarqué que Montesquieu met au choix ? Au choix entre quoi ? Entre la liberté et l’égalité, très nettement ; c’est dans sa Défense de l’esprit des lois : « J’ai fait sentir que nous sommes libres dans l’État politique par la raison que nous ne sommes point égaux. » Et en effet tout son livre fait sentir cela ; mais il ne l’a jamais dit aussi formellement que dans cette ligne-ci. On ne peut être libre qu’en raison de l’inégalité, pour l’assez bonne raison que l’égalité supprime toute liberté et est bien forcée de la supprimer pour subsister elle-même, puisque toute la liberté, dès que quelqu’un en use, crée une supériorité ou une infériorité et détruit l’égalité. Liberté et égalité sont donc antinomiques et il faut choisir. Nous choisissons, nous, monistes, l’égalité, parce qu’elle est plus belle créant l’uniformité ; nous repoussons la liberté comme créant l’irrégularité des lignes et par conséquent la laideur. Voilà le monisme intellectuel.
Les monopolistes sont assez souvent des monistes, des artistes épris de la Bauce. Ils sont beaucoup plus souvent des amoureux d’irresponsabilité, des hommes qui reculent devant la responsabilité intellectuelle. Il n’y a rien de cruel pour certains esprits comme d’avoir une pensée dont ils ne peuvent pas se décharger et se reposer sur quelqu’un qui la leur a donnée ou qui l’a comme eux. Ils se sentent seuls et ils sentent autour d’eux comme un grand silence qui les effraye. Doudan dit quelque part : « Dès que l’on avance un peu dans une étude, le bruit des lieux communs se tait et l’on se trouve dans un grand silence qui est très favorable au travail de la pensée. » Fort bien ; mais ce grand silence est pénible à un très grand nombre d’esprits. Il les accable en leur signifiant qu’ils ne pensent plus en commun avec leur groupe, avec leur parti, avec leur nation, avec leur religion. L’homme qui quitte sa religion, sa patrie, seulement son parti, a froid. Il se sent éloigné du foyer, il se sent séparé, exilé, émigré. J’en ai connu qui, trouvant que leur parti avait tort, le disant, le suivaient encore, parce qu’à le quitter il y aurait eu une sorte d’arrachement. Il ne leur semblait pas que l’homme fût fait pour penser juste tout seul ; mais plutôt, à la rigueur, s’il le fallait, pour penser faux et injustement avec sa troupe. Il leur était moins douloureux de s’arracher à eux-mêmes que de s’arracher à leurs entours.
— Mais n’est-ce pas là ce qu’on appelle manquer de conscience ?
— Je ne crois pas ; car c’est précisément un trouble et un émoi de conscience qui arrêtaient ceux dont je parle. Ce n’est pas manquer de conscience, c’est plutôt en avoir deux ; c’est avoir une sorte de conscience collective luttant contre une conscience individuelle. Et en un mot c’est reculer devant une pensée dont on est responsable, puisqu’on l’a seul. La pensée qu’on a avec d’autres n’est pas lourde à porter, puisque tant d’autres la portent avec vous. Voilà l’irresponsabilité intellectuelle et même un peu l’irresponsabilité morale. Les hommes qui repoussent la liberté d’enseignement et qui veulent que l’enseignement ne soit que métier d’État sont des hommes qui veulent penser par ordre, sur ordre, selon un ordre et pour l’ordre. C’est peut-être pour cela qu’ils s’appellent libres penseurs.
Ils sont éminemment sociaux, je le reconnais ; mais ils sont pour employer la terminologie de Comte, dans la statique sociale et non dans la dynamique sociale. Avec eux et eux étant seuls, l’État ne serait point troublé, mais il ne bougerait jamais ; car — quoique la chose soit contestée par quelques sociologues modernes — c’est tout à fait mon avis que ce sont les inventeurs qui sont créateurs de mouvement. « L’État, dit Nietzsche, est le monstre le plus froid de tous les monstres froids » ; et je ne me flatte pas de savoir de certaine science ce qu’il veut dire. Peut-être veut-il faire entendre que l’État n’a en lui-même aucune chaleur créatrice et qu’il doit la recevoir des individus qui en ont. Il est possible.
Au demeurant, croyez que quand l’État sera chargé de penser pour tout le monde il y aura un refroidissement intellectuel très général ; il y aura conservation relative et toujours plus faible de chaleur ancienne ; mais il n’y aura plus de foyer. Je conviens qu’il y aura uniformité et qu’on n’entendra plus la cacophonie des voix discordantes, ce qui est peut-être un grand bien.
Tant y a que la crainte des responsabilités est la raison de cette passion du fonctionnariat qui est la marque au moins la plus apparente du caractère français et que cette passion du fonctionnariat, en même temps qu’elle est un signe de l’affaiblissement de l’énergie française, en est une source.
Que la famille française soit une des plus belles choses que la France puisse proposer au respect et même à l’admiration de l’étranger et que l’étranger, spontanément la respecte et l’admire souvent et même toutes les fois qu’il ne la juge pas sur le témoignage de nos romanciers surannés, j’en conviens de tout mon cœur et suis très heureux d’en convenir. Mais ceci est un livre de critique qui marque les points faibles de notre constitution morale et de notre constitution politique pour tâcher de suggérer l’idée et le désir de réparations possibles.
Or dans la famille elle-même l’effroi des responsabilités, ou, et aussi, la manière fausse d’entendre les responsabilités sont des points faibles qu’il faut signaler et avec toute la précision qu’on y pourra mettre.
Les bourgeois français aiment leurs enfants de tout leur cœur et même ils les aiment trop si l’on peut trop les aimer ; enfin ils les aiment de tout leur cœur. Ce pays est peut-être le seul — ou il est celui où cela se passe le plus souvent — où mari et femme qui ne s’aiment point finissent par s’aimer dans leurs enfants et par amour de leurs enfants, de telle sorte qu’ils deviennent absolument dévoués l’un à l’autre. S’ils savaient s’observer (et cela ne doit pas laisser de leur arriver quelquefois) ils se diraient, jusqu’à leur premier enfant : « Nous ne nous aimons guère ; nous nous sommes mariés par convenance, comme on fait presque toujours en France, et sans nous connaître, comme on fait toujours en France ; ou nous nous sommes mariés par inclination, comme on fait quelquefois en France, mais sans nous connaître comme en France on fait toujours ; et voilà que nous ne nous aimons point du tout. »
Et ils se diraient à partir de leur premier enfant : « ce qui sauve tout c’est l’enfant ; elle l’aime infiniment, je l’aime beaucoup ; je suis content d’elle relativement à lui ; nous ne nous querellons plus beaucoup depuis qu’il est là ; à elle je pardonne tout à cause de lui. »
Et ils se diraient vingt ans plus tard : « Nous les avons élevés avec un dévouement absolu, avec des soins infinis et une sollicitude de tous les instants ; c’est la meilleure mère du monde ; je le lui dis avec émotion ; elle me dit avec attendrissement que je suis un très bon père ; ces moments sont très doux. Tiens ! Mais… nous nous aimons ! »
Les époux français s’aiment profondément après qu’est passé l’âge de l’amour. Cela vient de ce qu’ils s’aiment dans l’amour qu’ils ont pour leurs enfants. Je crois qu’il y a des pays où c’est l’amour qui fait les enfants et qu’en France c’est des enfants que naît l’amour. Pourvu qu’il y soit, c’est l’essentiel.
Les Français aiment donc profondément leurs enfants. Seulement, et par amour pour leurs enfants ils n’en font pas ; et par amour pour leurs enfants ils ne les élèvent pas.
Par amour pour leurs enfants ils n’en font pas. Comme Ugolin dévorait ses fils pour leur conserver un père, les Français s’abstiennent d’avoir des enfants pour leur conserver un père riche ou à l’aise et pour qu’ils ne soient point dans la misère. La terreur des pères de famille français c’est d’avoir plus de deux enfants, ou, même, plus d’un. S’ils en ont plus de deux, ils les aperçoivent, dans l’avenir, moins à l’aise qu’ils ne sont eux-mêmes et en droit de le leur reprocher et c’est devant cette responsabilité qu’ils reculent avec effroi. Si même ils n’en ont que deux ils se disent, avec raison du reste et en bons calculateurs, que quand leurs enfants se marieront, eux, parents, subsistant encore, malheureusement, le bien sera divisé en quatre, deux portions pour les parents, une pour chaque enfant ; que, par conséquent chaque enfant n’en aura qu’un quart jusqu’à la mort de ses parents, portion congrue, portion bien faible : « Oh ! le pauvre petit ménage qu’aura notre fille ! Oh ! l’étroite entrée dans la vie qu’aura notre fils, qui, en sa qualité de fonctionnaire, sera peu payé. Il faudrait n’avoir qu’un enfant. »
Ainsi raisonnent-ils, par crainte de la responsabilité qu’il y a à avoir plus de deux enfants, plus d’un. Ce qui fait quelquefois qu’ils poussent jusqu’à deux, c’est, quand ils commencent par une fille, le désir d’avoir un fils ; mais ce désir même ne les pousse pas toujours jusqu’au courage d’avoir deux enfants. Toujours ils en désirent un, l’amour paternel étant très vif chez eux ; mais plus d’un, très rarement. Ils ont besoin d’avoir un être sorti d’eux qu’ils aiment, qu’ils chérissent, qu’ils caressent et qu’ils gâtent délicieusement et de qui ils se croient aimés ; or un seul suffit pour cela et, dès qu’ils l’ont, le sentiment paternel est éteint par le sentiment paternel lui-même, je veux dire le désir d’avoir des enfants éteint par la satisfaction d’en avoir et par l’idée des devoirs immenses qu’ils ont à l’égard de celui qu’ils ont.
Il y a en France, ne nous y trompons pas et sachons le dire, une désapprobation des pères de famille, une mésestime, oui, une espèce de mépris à l’endroit des pères de famille qui ont de nombreux enfants ; ceux-ci sont considérés comme de mauvais pères, puisqu’ils ont frustré leur premier enfant du bénéfice d’être seul ou leurs deux premiers enfants du bénéfice de n’être que deux. Ce sont gens qui n’aiment pas leurs enfants ; et leurs enfants aînés eux-mêmes partagent obscurément ce sentiment-là. Et ce sont gens aussi qui n’ont pas eu la vertu française par excellence, la vertu sacrée, la seule vertu vraiment estimée, l’économie ; ce sont des prodigues, des dissipateurs, des dilapidateurs. Au fond, aux yeux de tout bourgeois français le père de famille qui a eu six enfants est un bohème et l’on devrait lui donner un conseil judiciaire.
Ce qui s’ensuit de tout cela, c’est d’abord que la famille française est très unie, très concentrée, très ramassée, très respectable, sympathique et touchante ; mais, à un certain point de vue, n’existe pas. La vraie famille, c’est la famille nombreuse, à nombreux enfants. Dans cette famille-ci, il y a, chose étrange au premier abord, mais qui s’explique quand on y réfléchit, beaucoup plus d’amour des enfants pour le père et la mère, peut-être un peu de jalousie, je l’ai indiqué, de la part des aînés, mais de la part des puînés qui sont les plus nombreux et, par contagion, de la part de tous, beaucoup plus d’amour, de respect, de culte pour le père et la mère, qui semblent des patriarches, des chefs de gens, des chefs de nation et qui ont comme une espèce de gloire. Vous n’êtes pas sans avoir connu des familles nombreuses ; car il y en a encore ; et vous avez parfaitement démêlé ce sentiment-là.
De plus, dans cette famille à nombreux enfants, des habitudes de tribu se forment tout naturellement. Il y a dans cette famille des rejetons sains, d’autres qui le sont moins ; ceux-ci sont redressés ou tenus en respect par les autres ; le mauvais sujet a pour correcteurs, non pas seulement son père et sa mère, mais ses frères honnêtes gens ; la famille est une espèce de tribunal et de jury où les bons l’emportent et traduisent à leur barre les mauvais ; à supposer même que les mauvais soient en majorité, deux sont intimidés dans le mal par un seul qui est du côté du père et de la mère et qui est fortifié par eux comme il les fortifie ; en un mot la famille est une société, où les éléments mauvais sont plus que contrebalancés et sont contenus par les éléments bons ; tandis que, dans une famille à un seul enfant, s’il est bon, rien de mieux, mais s’il est mauvais, ses parents n’ont pas d’auxiliaire contre lui. La nombreuse famille a en elle-même une très grande force pour le bien.
Dans la famille à un enfant unique, il arrive d’abord ceci, souvent, que l’enfant unique disparaît et que ce grand effort d’amour fut en pure perte, par lequel la famille s’est bornée à un seul enfant ; ensuite, si l’enfant unique ne disparaît point, il arrive ceci qu’il est élevé avec une excessive faiblesse, qu’il est gâté, par suite qu’il est égoïste et qu’il n’aime point ses parents. Il y a des exceptions ; elles sont assez rares.
Que l’enfant unique n’aime point ses parents ou les aime peu, c’est une chose si naturelle qu’elle n’a guère besoin d’être expliquée : c’est par la jalousie amoureuse que l’enfant apprend l’amour ; jalousie amoureuse le plus souvent tendre, douce et très aimable ; mais enfin c’est parfaitement par jalousie amoureuse : « Tu aimes mieux ma sœur que moi ; tu ne m’aimes pas tant que mon frère. — Mais si ! Je vous aime autant l’un que l’autre. » Le petit jaloux est à peu près convaincu ; en attendant c’est un mouvement de jalousie qui lui a appris l’amour et l’amour ne sortira pas de son cœur.
L’enfant unique, uniquement adoré, trouve cela naturel, et se laisse adorer sans réciprocité et sans rien qui l’excite à la réciprocité, ou qui, même, lui en donne l’idée. L’enfant unique est analogue au mari trop aimé de sa femme ou à la femme trop aimée de son mari ; il n’aime point ; cela semble trop dû qui n’est pas refusé, qui ne l’est jamais, même à demi, même un peu, même apparemment ; cela semble trop dû qui vous est prodigué.
Chose très particulière, que je crois avoir observée, ou peut-être je me trompe ; les parents à enfant unique semblent trouver tout naturel de n’être point aimés du tout ; peut-être ne s’en aperçoivent-il pas ; je crois pourtant qu’ils s’en aperçoivent un peu et qu’ils trouvent que cela va de soi ; ils semblent sentir qu’à l’infini doit répondre rien — « infini, rien », comme dit Pascal à propos de tout autre chose — qu’à une affection sans bornes, doit répondre, par impuissance de l’égaler, une affection très languissante, et à une affection d’une incroyable activité une affection toute passive.
Toujours est-il que l’enfant unique est très passif en affection et que ses parents n’aperçoivent pas cette passivité ou en prennent leur parti ou semblent la voir avec une espèce de plaisir. Les situations anormales dénaturent les sentiments. Vous connaissez tous l’amour éperdu qu’a pour sa femme l’homme que sa femme n’aime point, ses regrets désespérés quand il la perd, son mot, bien souvent entendu : « La pauvre femme ! Comme elle ne m’aimait pas ! Comme je n’ai pas su m’en faire aimer ! » Les parents à enfant unique ne sont qu’un peu comme cela ; mais ils le sont un peu, les mères surtout : « Il ne m’aime pas ! Il m’est si supérieur ! Il est adorable ! Comment ne pas aimer cet enfant-là ? »
Et en effet la non-affection de celui que vous aimez vous confirmant dans le sentiment que vous avez de sa perfection incommensurable avec votre indignité, vous confirme dans l’adoration que vous avez pour lui.
Seulement, c’est imbécile. C’est à cette imbécillité-là que conduit le soin imprudent de n’avoir qu’un enfant au lieu de dix.
Les conséquences ethniques ne sont pas moins graves ni moins douloureuses à considérer. Un peuple non géniteur placé à côté de peuples très prolifiques, ou seulement plus prolifiques que lui, est doucement envahi par eux d’une façon continue. La France, entre l’Allemagne et l’Italie, perd pacifiquement une bataille par an du côté de l’Italie et deux du côté de l’Allemagne. Les enfants qu’elle ne fait pas sont remplacés par ceux que font l’Allemagne et l’Italie et qu’elles nous envoient par manque de place chez elles et abandon de places vides chez nous. Rome est devenue une ville grecque, disait Juvénal ; avec beaucoup moins d’hyperbole que lui, je dirais : la France urbaine est devenue allemande et italienne. Ajoutez le peuple cosmopolite, le peuple juif, qui ne se trouvant nulle part mieux qu’en France et étant très prolifique, peuple notre territoire urbain très largement. A la vérité et je tiens essentiellement à le dire, le creuset intellectuel français est si fort, si ardent, si puissant, que de fils d’Allemands, de fils d’Italiens et de fils de Juifs il fait très vite des Français qui ont presque tous les caractères des Français de race et qui sont presque indiscernables des Français de vieille souche. Allemands, Italiens et surtout Juifs sont très productifs de Français ayant les qualités et les défauts français. Mais voilà qui n’est consolateur qu’à demi ; car si ces fils de métèques sont des Français très acceptables au point de vue de l’intelligence et même du cœur, il ne se peut pas qu’ils soient très français au point de vue du patriotisme. La chose a lieu, me dira-t-on. Je le sais ; mais je sais aussi qu’elle est rare. C’est parmi les fils de métèques qu’est l’état-major des antipatriotes et c’est surtout parmi les métèques qu’on trouve le plus d’indifférents à l’idée de Patrie. De sorte que c’est la paucinatalité, comme dit M. Édouard Petit dans la langue qui lui est particulière, qui contribue le plus à l’affaiblissement du patriotisme.
Il est remarquable, en tous cas, que le fléchissement du patriotisme chez nous a très précisément coïncidé avec la diminution de la natalité proprement française. Un moyen de battre en ruine le patriotisme, si odieux à certains, est de ne pas avoir d’enfants. Quand un instituteur devient père je gage que les autres lui disent : « Vous faites des enfants ; vous n’êtes pas des nôtres. » S’ils ne le lui disent pas, c’est qu’ils n’y entendent rien.
J’ai dit : par terreur des responsabilités, les Français ne font pas d’enfants ; ils élèvent mal ceux qu’ils font ; je passe à l’examen de cette seconde assertion.
Rien n’effraye plus le Français que d’élever son enfant lui-même. Il gâte ses enfants, il ne les élève pas. D’abord quand il s’agit d’une fille, le père français ne l’élève jamais ; il la laisse élever à sa mère ; c’est toujours une lourde faute. J’ai hâte de dire que le père, très occupé en dehors par le soin très sacré de gagner la vie de ses enfants, ne peut pas consacrer beaucoup de temps à l’éducation de ses filles, ni même de ses fils. Encore est-il qu’il doit donner et avec beaucoup d’autorité une direction générale. Je dirai presque surtout l’éducation des filles le regarde jusqu’à un certain âge de celles-ci, jusqu’à leur quatorzième année environ. La mère a une foule de qualités féminines qu’elle communique insensiblement à sa fille et rien de mieux ; mais elle a aussi une foule de défauts féminins qui doivent être contrebalancés par l’influence masculine, paternelle. Ces défauts que la mère ne peut pas combattre chez sa fille, que même elle ne peut pas ne pas lui donner, il faut que le père les signale à sa fille, toujours, certes, en disant que sa mère ne les a pas, et en s’appuyant sur cette affirmation que sa mère ne les a pas pour les mieux combattre ; mais enfin il faut qu’il les signale et qu’il les condamne.
Par parenthèse en les combattant chez sa fille avec affirmation énergique que la mère ne les a pas, il les guérira, du même coup, un peu, chez la mère. Le désordre, la nonchalance, la paresse, l’atermoiement éternel (« Nous avons bien le temps ») l’inexactitude, le bavardage, j’en passe, comment veut-on qu’une mère française guérisse sa fille de toutes ces imperfections-là ? Par son exemple ? Vous plaisantez. Par ses paroles ? C’est plus possible ; mais vous n’ignorez pas que si l’on se corrige peu de ses défauts c’est qu’on les prend pour des qualités et que l’on passe sa vie à s’en féliciter.
Donc jusqu’à un certain âge, il est très important que le père intervienne très adroitement, sans doute, et avec la discrétion nécessaire, mais très diligemment, dans l’éducation de ses filles. Royer-Collard avait autant d’autorité dans sa maison que dans les assemblées politiques, ce qui chez un homme d’État est la chose la plus rare du monde. Il était très impérieux avec Mlles Royer-Collard ; il leur disait entre autres choses : « Vous ne serez pas des demoiselles, je vous en empêcherai bien. » Je ne sais pas s’il les en a empêchées ; mais je sais qu’il comprenait bien les devoirs du père de famille à l’égard de ses filles.
La plupart des pères de famille français, à l’égard de leurs filles, se contentent de les voir croître en gentillesse, en grâces, en agréments et ne s’occupent pas d’autre chose. La responsabilité d’un travail si délicat que l’éducation des filles leur paraîtrait lourde. Ils sont des Chrysale. Avez-vous remarqué que Chrysale n’a pas du tout élevé ses filles ? Elles sont toutes deux façonnées par leur mère. Philaminte a eu une influence directe sur Armande qui est devenue une pédante. Elle a eu une influence à contre-effet sur Henriette qui, ayant le tempérament de son père, a été en réaction contre sa mère, mais en réaction un peu vive, un peu agressive, poussée trop loin, jusqu’à ceci qu’elle est un peu plébéienne, un peu soubrette dans ses propos. « Cette jeune fille manque de duvet », a dit Jules Lemaître. Ou, si vous voulez, Philaminte a formé Armande et par réaction contre Armande, Henriette a donné, avec beaucoup d’esprit, dans un peu de trivial. Ce pauvre Chrysale n’a même pas eu d’influence sur sa sœur. Celle-ci s’est donnée à Philaminte, comme à une personne très distinguée dont elle était fière et heureuse d’être devenue la belle-sœur, mais, bourgeoise presque peuple, comme son frère est bourgeois presque peuple, c’est une Philaminte très commune, qui ne lit guère que des romans et dont le rôle de femme savante consiste surtout à se piquer de savoir l’orthographe ; femme savante de petite ville. Tant y a que son frère n’a pas eu d’influence sur elle et ne peut même pas dire : « Ma pauvre bonne sœur au moins m’était restée. »
Il y a chez nous beaucoup de pères de famille qui lui ressemblent. Bien des chefs de famille français sont des Chrysale.
Il est un point extrêmement grave dans l’éducation des filles où cette terreur de la responsabilité est poussée jusqu’au plus grand ridicule et aussi constitue le plus grand danger du monde. A la vérité ce sont les mères que ce soin concerne et les pères n’y ont rien à voir. Je parle de la révélation à faire à la jeune fille des rapports entre homme et femme. Il est entendu dans la plupart des familles françaises que cette révélation ne doit jamais avoir lieu, ou doit avoir lieu deux ou trois heures avant le coucher de la mariée. Il n’y a rien de plus dangereux. Ou la jeune fille reste ignorante, ce qui arrive beaucoup plus souvent qu’on ne croit, ou elle apprend les choses par ses jeunes amies. Dans le premier cas elle est exposée à de graves périls ; dans le second elle a une instruction confuse, trouble et qui la trouble, et indécente. Les mystères de la vie doivent être enseignés nettement, chastement, sérieusement, gravement, comme la chose la plus grave en effet, la plus sérieuse et la plus chaste ; mais les mères reculent devant la responsabilité qu’il leur semble qu’elles encourent en les enseignant.
Dévelouter l’âme de leurs filles leur semble une mauvaise action. Elles aiment donc mieux que d’autres la fassent ? Non pas précisément ; mais elles remettent indéfiniment à la faire jusqu’au moment où vaguement elles se disent, sans vouloir en être sûres, qu’elle est faite. Il y a là un manque de courage très caractérisé, qui est en même temps une forte imprudence. La jeune fille doit être instruite brièvement et clairement sur les réalités de l’amour dès qu’elle est jeune fille. Le seul moyen de rendre les dangers évitables est de ne pas les laisser inconnus et le seul moyen d’empêcher les curiosités d’être malsaines est de les satisfaire sainement.
On voit quelles nombreuses et diverses phobies à l’égard des responsabilités existent dans les familles françaises. Chez ce peuple si courageux, le courage civil manque et aussi le courage familial. Le courage familial est le premier, comme en date, de tous les courages. C’est celui sur lequel s’appuient tous les autres ou plutôt il est l’atmosphère où tous les autres devraient, sinon précisément prendre naissance, du moins se nourrir, se développer, s’entretenir et se retremper.
Il y a deux choses en politique, la constitution politique et les mœurs politiques. La constitution politique, chez les Français, pour commencer par elle, est fondée sur l’irresponsabilité universelle. Sous l’ancien régime il y avait une responsabilité très réelle, c’était celle du roi. On l’oublie trop ; mais si le roi était absolu, ce qui, du reste, était absurde, il était éternellement et absolument responsable et on le lui faisait sentir. Notez bien que depuis la fin des guerres civiles du XVIe siècle la royauté française a gouverné despotiquement ; mais toujours combattue par des révoltes. Le règne de Louis XIII est une lutte incessante de la royauté contre la noblesse en insurrection ; la minorité de Louis XIV de même, en ajoutant à la noblesse les magistrats et le peuple ; Louis XIV, quand il gouverne lui-même, a à lutter contre les Protestants qu’il a imprudemment provoqués ; et il est toujours inquiet du côté des Parlementaires et vit toujours comme à la veille d’une Fronde. Comprenons bien que la monarchie dite absolue se sentait continuellement menacée et par conséquent se sentait très responsable. Elle avait ses moments d’enivrement de pouvoir absolu, mais perpétuellement le sentiment confus — quelquefois très clair — que quelqu’un existait, bien près d’elle, qui lui demandait des comptes ou qui allait lui en demander. Sa sagesse, intermittente, tint à cela ; sa folie fut de ne pas comprendre que cette responsabilité confuse et indéterminée, il fallait l’organiser, qu’un despotisme tempéré par l’insurrection ou par la peur de l’insurrection est un despotisme menacé, un despotisme intimidé, mais non pas une monarchie tempérée ; qu’il faut préciser la responsabilité pour qu’elle soit normale et pour qu’elle soit féconde en résultats heureux ; qu’il faut désarmer l’insurrection par avance en donnant la parole à l’opposition et qu’on ne trouve pas le peuple en face de soi quand on lui a permis de parler et quand on a tenu compte de ses paroles. — Mais encore la responsabilité existait et elle était très nettement sentie.
Elle l’était d’autant plus que la royauté se sentait, un peu vaguement, je le reconnais, mais se sentait usurpatrice. Elle savait qu’il avait existé une constitution, que le royaume avait eu des « lois fondamentales » liant le roi, inviolables au roi et que le roi avait peu à peu laissé tomber en désuétude, surtout à la faveur des troubles civils, toujours utiles au vainqueur, mais lois fondamentales qui avaient existé et qui existaient comme virtuellement encore. Je ne connais pas un écrivain politique de l’ancien régime qui ait soutenu que le royaume de France fût un royaume despotique. Tous ont dit qu’il y avait des lois au-dessus du roi et que le roi ne pouvait pas faire tout ce qu’il voulait. Quand la royauté disait — et elle l’a dit cent fois, s’adressant aux Parlementaires — « que le pouvoir législatif était dans le roi » elle savait qu’elle ne disait pas la vérité et elle se sentait parfaitement usurpatrice.
Le clergé seul lui disait presque toujours qu’elle était souveraine, ne tenant son pouvoir que de Dieu ; seulement il lui constituait, du même coup, une responsabilité très redoutable ; il lui criait qu’elle était responsable devant Dieu et qu’elle devait compte à Dieu de ce qu’elle faisait contre le peuple ou sans s’inquiéter de lui.
On me dira que cette responsabilité peut paraître légère, indéfinie, parce qu’elle est infinie et que la royauté pouvait un peu dire comme Tartuffe : « Si ce n’est que le ciel… » Il ne faudrait pas trop prendre les choses ainsi ; il ne les faudrait prendre de la sorte que si le clergé eût dit cela à la royauté tête à tête et à voix basse. Mais il les disait tout haut et c’est ici que la responsabilité temporelle commence. Il les disait tout haut et le peuple les entendait aussi bien que le roi et prenait là le sentiment de la responsabilité royale. Gouverner justement était un devoir envers Dieu, soit ; mais c’était un devoir envers le peuple que de le gouverner comme Dieu voulait qu’on le gouvernât. Là se retrouvait encore, quoique affaiblie, la vieille intervention du pouvoir spirituel dans le pouvoir temporel au nom du Dieu souverain, intervention qui avait été souvent si puissante et si salutaire sur les princes barbares. Remarquez qu’un souverain craignant Dieu sent sur lui une responsabilité plus lourde quoiqu’il soit prince absolu, qu’un souverain nommé par le peuple et relevant nominalement de lui. Quand l’Église disait : « Toute puissance humaine vient de Dieu », elle courbait, croit-on généralement, elle écrasait le peuple sous le souverain. Prenez garde ! En disant au roi que la puissance venait de Dieu elle le faisait du même coup responsable devant Dieu d’une façon terrible. Au contraire, le souverain qui se dit qu’il ne relève que du peuple sent bien qu’il ne relève de personne, qu’il ne relève que du succès, qu’il sera aimé tant qu’il sera heureux, détesté, abandonné, renversé quand la fortune tournera contre lui. Le souverain qui est de Dieu a fait un pacte avec Dieu ; le souverain qui relève du peuple a fait un pacte avec le hasard. Il faut tenir compte de cela.
Je reconnais, j’ai reconnu, que pour que le pacte avec Dieu sortisse son effet salutaire, il faut que le prince ait la crainte de Dieu et il faut convenir aussi que c’est précisément cette crainte qui s’était très notablement affaiblie chez nos rois de l’ancien régime, le dernier excepté ; mais j’ai voulu faire entendre que, sous l’ancien régime, si la responsabilité constitutionnelle n’existait pas, une responsabilité cependant existait et même à triple forme, responsabilité envers Dieu qui ne laissait pas de se faire sentir encore, responsabilité envers une Constitution « qui n’était jamais qu’enfreinte » comme a dit spirituellement Mme de Staël, mais dont on avait cependant l’idée et qui était souvent rappelée par les jurisconsultes ; responsabilité envers le peuple, devant qui le roi, précisément parce qu’il avait annihilé les corps intermédiaires, se sentait tout seul en cas de faute grave, ce qui met en état de réflexion et de crainte.
De nos jours, constitutionnellement, nous avons limité les responsabilités du pouvoir jusqu’à les faire presque nulles ; et par les mœurs politiques altérant la Constitution nous avons réduit à rien les responsabilités déjà très faibles constitutionnellement du pouvoir central et de ses agents. Le président de la République a d’assez grands pouvoirs ; il peut proroger la Chambre des députés pour plusieurs mois ; il peut, avec l’aveu du Sénat, dissoudre la Chambre des députés et en appeler à de nouvelles élections ; il peut, ce qui est un veto suspensif, ordonner aux Chambres une nouvelle délibération d’une loi votée par elles. Il est curieux que toutes ces dispositions sont devenues lettres mortes, n’existent plus que sur le papier, sont dans la pratique comme si elles n’étaient pas et en réalité n’existent point. Depuis la dissolution de la Chambre par le président Mac-Mahon, au 16 mai 1877, jamais une Chambre des députés n’a été dissoute. Jamais, depuis 1871, le président n’a provoqué une seconde délibération d’une loi votée. Jamais, depuis 1877, le président n’a prorogé une Chambre des députés. Il y a plus. Constitutionnellement le président a le droit de communiquer sa pensée aux Chambres par des messages. Thiers usa très souvent de ce moyen de gouvernement. C’en est un en ce sens que, par le message, le président à la vérité n’ordonne rien ; mais s’il y a discordance entre son parlement et lui il en fait juge la nation qui lui dira, soit en nommant à nouveau les mêmes députés qu’elle n’est pas avec lui, soit en en nommant d’autres qu’il est avec elle. C’est donc une responsabilité qu’il prend et un moyen détourné de gouverner qu’il adopte quand il adresse un message aux Chambres. Jamais, depuis Mac-Mahon, ce moyen n’a été employé.
Et enfin, constitutionnellement, le président est irrévocable pendant sept ans. Les Chambres ont révoqué un président, Jules Grévy, sans aucun texte formel de révocation puisque cela eût été inconstitutionnel ; mais en lui intimant l’ordre de se démettre par la formule célèbre : « La Chambre… le Sénat… attendant une communication de M. le Président de la République… »
Il résulte de tout cela, suivant l’expression très heureuse de M. Aulard, qu’une Constitution réelle a remplacé la Constitution légale et si radicalement qu’on n’oserait pas violer la Constitution réelle pour appliquer la Constitution légale et que procéder constitutionnellement paraîtrait effrontément inconstitutionnel.
Et cette Constitution réelle tient en un mot : le Président de la République française n’est rien ; ou dans un autre mot : il n’y a pas de Président de la République française.
Cela est si vrai qu’un homme d’État qui est nommé président de la République ne sent pas autre chose que ceci que sa carrière politique est finie. Elle l’est totalement et pour toujours. Car, comme président de la République, il ne devra que ne rien faire et ne rien dire ; et même quand il ne le sera plus, l’usage voulant qu’un ancien président de la République ne soit ni sénateur ni député, il devra continuer de ne rien dire et de ne rien faire. La présidence de la République ostracise un homme politique pendant tout le temps qu’il l’a et pendant tout le temps qu’il ne l’a plus. Elle l’annihile en se posant sur lui et l’oblitère en le quittant.
Ces principes, qui ne sont inscrits nulle part et qui sont en vigueur toujours sont si forts qu’un président qui n’était pas d’accord avec ses ministres, M. Loubet, ne renvoyait point ses ministres, ne prorogeait pas la Chambre, ne dissolvait pas la Chambre, ne demandait pas une deuxième délibération d’une loi votée, n’adressait pas de messages aux Chambres ; mais quelquefois, dans un banquet ou une réception, prononçait quelques paroles exactement contraires à la politique de ses ministres. Il soulageait ainsi sa conscience ; mais il mettait en vive lumière la « Constitution réelle » et l’étrange paradoxe de cette Constitution réelle. On pouvait lui dire : « Si vous pensez ainsi, que n’employez-vous les moyens constitutionnels de le faire savoir et les moyens constitutionnels de le faire prévaloir dans les limites où vous le pourrez constitutionnellement ? » Et comme il ne le faisait point, ses discours en marge signifiaient très clairement ceci : « Selon la Constitution réelle je n’ai aucun des droits que me donne la Constitution légale, et je ne puis parler que comme homme privé ; et pour ce qui est d’agir je ne puis agir d’aucune façon. »
Il n’y a donc pas, en France, de Président de la République ; il n’y a donc pas, en France, de chef de l’État.
Ceci est très important à considérer, parce que cela revient à dire que la France est une démocratie pure. Quand j’expose tous les inconvénients, redoutables à mon avis, de la démocratie pure et de ce qu’elle amènera peu à peu et même très rapidement avec elle, on m’oppose les démocraties antiques et la démocratie américaine. C’est confondre république et démocratie et il n’y a pas de confusion plus forte. Les démocraties anciennes n’ont jamais existé, voilà pour elles ; et la République américaine n’est pas une démocratie.
Les républiques anciennes étaient des aristocraties, excepté, pendant un temps très court, la république athénienne, chez qui la démocratie a fini par s’établir, coïncidant du reste avec la décadence de la nation. La république lacédémonienne était une aristocratie. La république romaine a passé sans transition de l’aristocratie au gouvernement d’un seul. Je n’ai peut-être pas besoin de dire que la république de Venise était radicalement aristocratique.
Quant à la république américaine, elle est une monarchie constitutionnelle ; elle n’est pas autre chose qu’une monarchie constitutionnelle. Avec sa toute-puissance en politique extérieure ; à l’intérieur avec ses ministres qui ne sont pas responsables devant le parlement ; avec son droit d’initiative législative dont il use ; avec son droit, dont il use aussi, de nommer tous les fonctionnaires de l’État, le président de la République américaine est un souverain. Il l’est d’autant plus que, si les ministres ne sont pas responsables devant les Chambres il ne l’est pas non plus, n’étant pas nommé par elles et étant nommé par le peuple. Au fond et en toute réalité le président de la République américaine est un souverain constitutionnel très puissant, qui n’a à s’inspirer que de l’intérêt public et qui n’a à s’inquiéter que de l’opinion publique pour être populaire, pour être réélu et, quand il a été réélu et ne peut plus l’être, pour être en honneur dans son pays. C’est un souverain pro tempore ; mais c’est un souverain. Un ambassadeur de France aux États-Unis me disait : « Le président de la République américaine est incomparablement plus roi que le Roi de la Grande-Bretagne et beaucoup plus empereur que l’Empereur allemand. »
Il n’y a donc jamais eu et il n’y a pas dans l’univers de démocratie pure, si ce n’est la démocratie française. Voilà pourquoi nous qui l’étudions, nous sommes forcés pour prévoir ce qu’elle deviendra et pour la critiquer et conseiller en considération de son avenir, de raisonner presque dans l’abstrait. On nous le reproche assez ; mais nous ne pouvons pas faire autrement, ou nous ne pouvons guère faire autrement. Nous raisonnons avec quelques souvenirs de la démocratie athénienne, qui, elle, a existé, mais environ un demi-siècle ; ainsi faisait déjà Rousseau quand, ce qui lui arrivait en dépit du Contrat social, il attaquait la démocratie pure. Nous raisonnons un peu, aussi, avec la Révolution française que nous considérons, dans la carrière qu’elle a fournie, dans la courbe qu’elle a tracée de Mirabeau à Babeuf comme le schéma de l’histoire de la démocratie, comme la figuration prophétique de l’évolution de la démocratie pure. Nous raisonnons aussi, un peu, avec l’histoire de la troisième République française, avec les tendances qu’elle a montrées, la direction qu’elle a prise et nous annonçons la démocratie de demain comme le prolongement de la démocratie de 1871 à 1911, comme la radicalisation progressive de la démocratie d’aujourd’hui. — Mais enfin, nous raisonnons surtout dans l’abstrait, considérant l’essence même de la démocratie, c’est-à-dire l’égalité absolue et affirmant que la démocratie française se rapprochera de plus en plus de son essence, se rapprochera de plus en plus de la démocratie pure.
— Est-il légitime de raisonner ainsi et est-il donc impossible que la démocratie se corrige elle-même en se développant, s’amende en s’affermissant et crée elle-même les contrepoids dont elle a besoin ?
— Oui ; je crois qu’il est légitime de raisonner ainsi et je ne crois pas que la démocratie française se corrige elle-même en se développant parce que — oh ! que l’américain Barrett-Wendell, dans sa France d’aujourd’hui, a bien vu cela ! — parce que le propre du Français est d’être radical, le propre du Français est d’être idéologue, le propre du Français est d’aller jusqu’au bout de ses idées et de n’avoir pas peur, et tout au contraire, en considérant jusqu’où ses idées le mèneront.
Rien n’est plus juste. Quand la France a été catholique-étatiste, elle a vu sans frayeur, elle a vu sans pitié, même pour elle, elle a vu avec une satisfaction quasi-unanime deux millions de Français et des meilleurs et des plus utiles, forcés de s’éloigner d’elle pour que fût réalisée cette idée : une seule religion d’État et une seule religion dans l’État. Idéologie passionnée. « Périssent les colonies plutôt qu’un principe ! »
Quand la France a été nationaliste, c’est-à-dire éprise du principe des nationalités, elle a prêché et dogmatisé contre elle, contre son intérêt évident ; elle a combattu contre elle, elle a versé son sang contre elle, pour créer contre elle des nations ; pour que fût réalisée cette idée : de grandes nationalités groupées selon la race et selon la langue. Idéologie passionnée. Ne nous y trompons point, un des Français les plus représentatifs du caractère intellectuel français, c’est Napoléon III.
Si la France est ainsi faite intellectuellement, nous ne doutons guère qu’éprise de l’idée démocratique elle ne la pousse jusqu’au bout en droite ligne et selon le plus court chemin.
Et voilà pourquoi, en cette question, nous raisonnons in abstracto, d’abord parce que le fait démocratique étant un fait nouveau nous ne pouvons guère faire autrement ; ensuite parce qu’ayant affaire à un peuple qui lui-même agit dans l’abstrait, d’après l’abstrait, c’est une assez juste méthode que de raisonner dans l’abstrait sur ce qu’il fera de lui.
Résumé de cette digression : la France est une démocratie éprise de la démocratie pure et qui tend de toutes ses forces à réaliser la démocratie pure.
Suis-je loin de mon sujet ? Je ne crois pas. La France est une démocratie qui tend vers la démocratie absolue. C’est pour cela qu’elle s’organise spontanément, presque automatiquement, selon le principe de la démocratie absolue ; et ce principe c’est d’abord l’égalité absolue, c’est ensuite qu’il n’y ait de responsabilité nulle part et que personne ne soit responsable. Les Athéniens, à l’époque où ils furent en démocratie, n’avaient pas de gouvernement ; ils étaient gouvernés par la foule des citoyens qui, comme toute foule, n’était responsable devant personne, si ce n’est devant l’histoire, qui du reste le leur a fait bien voir. Or comment supprimer la responsabilité ? En la divisant, en la subdivisant, en la dispersant, en l’éparpillant de telle sorte qu’elle soit insaisissable partout, que de personne on ne puisse dire : « Is ficit. » C’est précisément ce qu’a fait notre constitution et ce qu’ont fait plus encore nos mœurs politiques.
En France ce qui gouverne, c’est le Parlement. Ce n’est pas le prétendu « chef de l’État » ; nous l’avons montré. Ce ne sont pas les ministres, qui, perpétuellement soumis au Parlement, gouvernant et administrant sous la dictée du Parlement, ne sont pas autre chose que les agents exécutifs, que les commis du Parlement. Toute l’action gouvernante est dans les deux Chambres. Or les parlementaires sont irresponsables parce qu’ils sont neuf cents. Chacun d’eux, quand il prend une décision, se sent couvert par tous les autres et a ce sentiment très juste qu’il faudrait avoir bien mauvais caractère pour s’en prendre à lui. Ce qui gouverne et ce qui gouverne uniquement c’est une masse confuse qui n’offre aucun point où l’on puisse se prendre quand il s’agit de se plaindre, de réclamer ou de s’irriter. La grande théorie de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs, est une théorie de la responsabilité. Est responsable le chef de l’État et ses ministres s’ils gouvernent ; est responsable le magistrat s’il est bien entendu qu’il ne peut pas rejeter sa responsabilité sur le gouvernement qui lui donne des ordres. Est responsable le législateur s’il n’est pas le législateur innombrable ; si d’autre part il n’est pas un pouvoir confus, qui, légiférant, gouvernant, administrant et pesant même sur la justice, assume en apparence tant de responsabilités que réellement il n’en a plus aucune.
Car on peut objecter, mais l’objection ne sera pas juste, que voilà bien un bel exemple de soif de responsabilité qu’un corps législatif qui se fait tout, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir administratif, pouvoir judiciaire et qui appelle pour ainsi parler sur lui seul toutes les revendications possibles. Mais je dis que l’objection est fausse parce que, à tout prendre sur soi, on ne prend rien distinctement, formellement, clairement. La France se sent gouvernée, administrée et même jugée par ses députés et sénateurs ; mais outre qu’ils sont une foule, ce qui divise et partage la responsabilité, c’est par un pouvoir exécutif, par un pouvoir administratif, par un pouvoir judiciaire que le Parlement gouverne, administre et juge, sans qu’on puisse distinguer quelle quantité d’autorité ou d’influence le Parlement verse, introduit, fait passer dans chacun de ses pouvoirs. De sorte qu’en tant que pouvoir de gouvernement, d’administration et de justice, le Parlement est un pouvoir occulte et que la France se sent gouvernée, administrée et jugée par un pouvoir occulte et insaisissable.
Et, en outre, parce que le Parlement se mêle de tout comme pouvoir occulte, quand il est sur son domaine de législateur il échappe aux responsabilités en ceci qu’on ne paraît pas sur son domaine, même au moment où l’on y est, lorsque l’on est sans cesse sur tous les autres. L’ubiquité du Parlement le couvre même quand il s’occupe de son affaire, en ce qu’elle divertit l’attention que l’on pourrait porter sur son affaire et sur lui s’en occupant. Ils font des lois : ils font tant de choses qu’on ne les envisage point précisément comme législateurs. Ils font des lois ; c’est tellement une partie secondaire de la mission qu’ils se donnent que ce n’est pas là-dessus précisément que se porte l’attention publique qui, du reste, sur les autres choses qu’ils font, ne peut être qu’incertaine et indécise.
Le grand défaut du gouvernement parlementaire quand il est une sorte de syncrétisme, quand ses différents rouages ne sont pas nettement délimités et distincts, c’est que la revendication légitime flotte, s’égare, ne sait où se prendre, a par conséquent le sentiment de son impuissance et finit par se ramener à une sorte d’indifférence et de résignation. Nous sommes gouvernés dans des ténèbres artificielles qui ont été très habilement formées pour que ni les gouvernés ne sachent qui reprendre, ni les gouvernants ne sachent très précisément ce qu’ils font. Nous sommes gouvernants et gouvernés à tâtons…
— Tout cela, c’est de la rhétorique !
— Mais regardez donc un exemple tout récent. Dans l’affaire de délimitation de la Champagne, le gouvernement prend une décision, bonne ou mauvaise, ce n’est pas cela qui est en question. Cette décision ayant causé une insurrection en Champagne, le Sénat, sur interpellation, décide qu’il ne devra pas être fait de délimitation, et de ce fait condamne le Cabinet. Le Cabinet n’avait qu’une chose à faire : se retirer. Il ne se retire point mais remet la question aux mains du Conseil d’État par un projet de loi en blanc, et c’est-à-dire qu’il charge le Conseil d’État de faire la loi. La Chambre des députés à son tour discute l’affaire avec force protestations à l’égard du Sénat et donne sa confiance au gouvernement. Quelle confiance ? Ce n’est pas au gouvernement qu’il fallait accorder confiance sur cette affaire, puisqu’il s’en était dessaisi, c’était au Conseil d’État et l’ordre du jour de la Chambre aurait dû être celui-ci : « La Chambre ayant écouté le gouvernement qui n’a pas d’avis, n’en ayant pas elle-même, et confiante dans le Conseil d’État qui est prié d’en avoir un, passe à l’ordre du jour. » Tant y a qu’en cette affaire, au moment où j’écris, nous ne sommes pas gouvernés par le gouvernement qui n’a pas d’opinion, nous ne le sommes pas par la Chambre qui n’a pas d’opinion, nous ne le sommes pas par le Sénat qui a son opinion dont il n’est pas tenu compte ; nous le sommes par le Conseil d’État qui n’a aucun mandat pour gouverner et qui n’est qu’une assemblée consultative ; et ceci est une situation inconstitutionnelle au premier chef.
Mais au fond de cette situation inconstitutionnelle qu’y a-t-il ? Il y a l’horreur des responsabilités et que tout le monde — excepté le Sénat — se dérobe. Le gouvernement se dessaisit et n’a plus de volonté et ne veut plus en avoir ; la Chambre exprimant sa confiance dans l’absence de volonté et d’opinion du gouvernement, s’affirme avec éclat sans opinion et sans volonté ; et tout le monde, excepté le Sénat, se dérobe aux responsabilités en s’en remettant à un Conseil de législation et d’administration qui n’en a pas.
L’idéal de tous ces messieurs semble être que celui-là décide à qui personne ne peut demander compte. La passion de se dérober aux responsabilités est ici saisie sur le vif. Car n’est-il pas étrange qu’un gouvernement déjà irresponsable parce qu’il n’est que l’agent d’exécution d’un Parlement, se dérobe à une ombre de responsabilité en se déchargeant du soin de décider sur une assemblée qui ne fait pas partie du gouvernement ; et qu’une Chambre, déjà irresponsable à cause de son nombre, écarte d’elle une ombre de responsabilité en s’en remettant à un gouvernement qui s’en remet à un tiers et en se confiant à un gouvernement qui se confie à un troisième groupe ?
Éparpiller la responsabilité de manière qu’il n’y en ait plus de saisissable, vous voyez bien que c’est le régime.
Si le gouvernement est irresponsable, les agents du gouvernement ne le sont pas moins et le sont peut-être davantage. On sait assez en quoi consiste, en Grande-Bretagne et aux États-Unis d’Amérique, la liberté individuelle, quelle est sa sauvegarde et ce qui fait qu’elle existe. Ce qui fait qu’elle existe, c’est que vous, particulier, vous pouvez faire un procès à un fonctionnaire qui vous moleste, même dans l’exercice de ses fonctions. Le législateur Anglo-Saxon a compris que l’on peut avoir justice à invoquer contre un agent du pouvoir aussi bien que contre un égal et que même il est assez vraisemblable que je trouve qui me moleste ou qui m’opprime plutôt dans un homme puissant par sa fonction que dans un de mes égaux. Donc en Angleterre et en Amérique on peut faire un procès à un fonctionnaire qui, même dans l’exercice de fonctions, vous paraît vous avoir fait tort.
En France on ne le peut pas, en ce sens qu’à la vérité on le peut ; mais que si on le fait, le fonctionnaire appelé élève un déclinatoire d’incompétence qui transporte l’affaire devant le tribunal des conflits, lequel étant composé en majorité de fonctionnaires de l’État ne peut pas donner raison au particulier contre le fonctionnaire. En fait le droit pour un particulier de faire un procès à un fonctionnaire relativement à l’exercice de ces fonctions, en France, n’existe pas.
Et quand on songe qu’il pourrait si bien exister sans que le fonctionnaire fût beaucoup plus responsable, sans qu’il le fût davantage ! Du moment que la magistrature dépend tellement du gouvernement, on sait pourquoi, qu’elle n’admet pas qu’elle puisse donner tort à un gouvernement contre un particulier, ni contrarier d’aucune façon les désirs du gouvernement, que serait-il besoin de lui dérober la judicature sur les fonctionnaires attaqués par les particuliers, puisqu’il est bien probable qu’elle ne l’exercerait jamais en faveur de ceux-ci ni au détriment de ceux-là ? Eh bien, non ; il ne suffit pas que la magistrature se considère comme un agent du pouvoir pour qu’on croie assurée l’irresponsabilité des autres agents du pouvoir ; il faut encore, pour que cette irresponsabilité soit intangible, qu’il y ait pour ces agents un régime d’exception et de privilège. C’est multiplier les assurances et les sauvegardes de l’infaillibilité du fonctionnaire. Que le fonctionnaire de France est heureux et qu’il peut en prendre à son aise !
En réalité il n’est point si heureux et il n’est pas aussi à son aise qu’on le pourrait croire. Il est terriblement gêné et terriblement responsable. Mais il est gêné par ceux par qui il devrait ne pas l’être et responsable à ceux à qui il serait essentiel qu’il ne le fût point. Il a des comptes à rendre à son gouvernement d’abord, ce qui est absolument légitime et inattaquable ; il en a à rendre ensuite et de beaucoup plus délicats à ce gouvernement occulte dont nous avons parlé. Il a à administrer dans l’intérêt des parlementaires de sa région, des sénateurs et des députés de sa région et contre les adversaires des députés et sénateurs de sa région. Le gouvernement occulte ne lui demande pas autre chose et n’exige de lui impérieusement que cela. C’est chose sur quoi j’ai insisté ailleurs et sur quoi je n’ai pas à m’étendre ici.
Il résulte de cela que le fonctionnaire, irresponsable devant ses concitoyens — il n’est pas élu — irresponsable devant la justice — il n’est pas justiciable — est responsable devant des quasi irresponsables, les parlementaires, et devant des gens, ces mêmes parlementaires, qui relativement aux services qu’ils ont pu lui demander sont complètement irresponsables.
En effet devant qui le parlementaire vient-il, la législature terminée, rendre ses comptes ? Devant son parti. Sur quoi son parti l’interrogera-t-il ? Il pourra lui demander comment il a voté, quelles lois il a faites. Mais jamais il ne lui demandera s’il a exercé une influence, une intimidation, une pression abusive sur les fonctionnaires du département. Au contraire, s’il reprochait quelque chose, à cet égard, à son député, ce serait de n’avoir pas déployé assez de vigueur pour faire agir les fonctionnaires dans l’intérêt du parti.
Donc le fonctionnaire du pouvoir, irresponsable devant la justice, est responsable devant des quasi irresponsables, qui, relativement à ce qu’ils lui font faire, sont irresponsables tout à fait.
D’où il suit que le fonctionnaire n’a pas la responsabilité qui serait utile et a celle qui est funeste ; n’est pas responsable dans le sens du bien public et est étroitement responsable dans le sens de l’injustice sociale, dont il se trouve qu’il est chargé.
Tel est ce groupement, en principe et en apparence si bien fondé en droit, en raison et en équité, dans la pratique, et par la façon dont on l’a altéré si dangereux pour la raison, la justice et le bien général. En somme on a fondé un gouvernement impersonnel qui est devenu irresponsable et je ne sache rien au monde de plus périlleux.
Les remèdes seraient de deux sortes, remèdes constitutionnels, remèdes moraux.
Remèdes constitutionnels : on songera tout de suite, naturellement, à la monarchie. Il est assez naturel, la démocratie s’acheminant au despotisme parce qu’elle est impersonnelle, de songer à la monarchie qui étant essentiellement personnelle peut fonder la sauvegarde de la liberté. Je crois que ce serait une erreur. On dit toujours : il n’y a qu’un roi qui puisse être au-dessus de tous les partis, et qui, étant au-dessus de tous les partis, puisse songer uniquement au bien public et même à la liberté de tous, ne voulant pas, précisément, qu’aucun parti l’emporte sur les autres, opprime les autres et par suite lui-même, de sorte qu’il y a solidarité entre la liberté du prince et la liberté des citoyens.
Ce n’est pas mal raisonné et il y a plaisir à exposer ou à résumer les opinions de gens qui raisonnent si bien. Mais, si nous consultons les faits et si nous nous rappelons notre histoire, d’où vient qu’il y a autant de partis se disputant le pouvoir sous un roi dit absolu que dans une république ? Le fait n’est pas contestable. Sous tout roi il y a eu des partis, c’est-à-dire des coteries, chacun ayant son chef, ses sous-chefs, sa clientèle, ses sportulaires, et qui, chacun profitant des fautes des autres, disputant la faveur royale et l’obtenant à son tour tant par les fautes des autres que par ses intrigues propres, se succédaient au pouvoir exactement comme nos partis ou nos fractions de parti se succèdent au pouvoir maintenant ; d’où il résulte qu’il n’y a pas plus de suite aujourd’hui dans les affaires que du temps de l’ancien régime ; mais aussi qu’il n’y avait pas plus de suite dans les affaires du temps de l’ancien régime qu’il n’y en a aujourd’hui.
On répète incessamment après Renan dans sa Réforme intellectuelle et morale, qu’un homme ayant les facultés d’un grand homme d’État ne pourrait jamais aujourd’hui devenir ministre, par la raison qu’il ne pourrait devenir ni député ni sénateur ; qu’il fut bien plus facile à Turgot d’être ministre en 1774 qu’il ne le serait de nos jours ; que, de nos jours, sa modestie, sa gaucherie, son manque de talent comme orateur l’eussent arrêté dès les premiers pas et même avant le premier pas ; « qu’en 1774 pour arriver il lui suffit d’être compris et apprécié de l’abbé de Viry, prêtre philosophe très écouté de Mme de Maurepas. » Rien de plus juste ; mais on oublie d’ajouter que Turgot, s’il arriva très facilement, s’en alla plus facilement encore et qu’il ne resta que deux ans au pouvoir pour n’y remonter jamais, renversé par une intrigue.
Ceux qui font valoir le mérite de la royauté supposent toujours un roi très intelligent et très obstiné qui sait choisir ses ministres et qui sait les garder, se tenant au-dessus des partis autant qu’il peut s’y tenir, c’est-à-dire absolument. Ce n’est pas tout à fait une supposition ; car cela est arrivé ; tels ont été Louis XIII, peut-être dominé, mais mettant tant de fermeté à être dominé toujours par le même homme, qui était de génie, que je le considère comme le plus intelligent et le plus énergique de tous nos rois ; et Louis XIV, tout au moins pendant cette première moitié de son règne où il soutint Colbert et Louvois contre tous leurs ennemis et même l’un contre l’autre. La théorie du roi très intelligent, très ferme et au-dessus de tous les partis n’est donc pas une simple supposition ; mais encore elle vise une exception et ce n’est pas sur une exception qu’il faut bâtir une théorie.
La vérité est que, n’y ayant rien de plus rare qu’un roi intelligent et ferme, il y a lutte des partis et succession des partis au pouvoir et par conséquent instabilité, autant sous un roi qu’en République.
Ajoutez, ce que j’ai dit quelquefois, mais le devoir du théoricien politique est de se répéter, que pour ce qui est de la France, la République existant depuis quatre-vingts ans, c’est avoir la première vertu de l’homme politique à savoir le respect des faits considérables et des traditions enracinées que d’accepter la République et d’essayer seulement d’en tirer le meilleur parti. Je dis que la République existe en France depuis 1830 parce que, quand dans une nation trois monarchies se disputent le pouvoir, la nation tend vers la République comme vers la solution nécessaire, et virtuellement y est déjà et même matériellement y est déjà, puisqu’elle est gouvernée par une monarchie, non pas universellement admise, ce qui est l’essence même de la monarchie, mais presque universellement contestée ; d’où il suit qu’elle est gouvernée par un parti, qu’elle est gouvernée pour un temps par un parti, ce qui est l’essence même de la République.
Il est donc foncièrement vrai, profondément vrai que la France est en République depuis quatre-vingts ans, que c’est un fait considérable et depuis longtemps acquis qu’il faut subir et qu’il est essentiellement traditionniste, en 1911, d’être républicain.
La monarchie absolue (ou parlementaire de façon consultative, comme l’était la monarchie de l’ancien régime) étant écartée, faudrait-il avoir recours à la monarchie strictement parlementaire, c’est-à-dire à la monarchie où le roi règne et ne gouverne pas et où gouverne, légifère, administre, juge, le parti qui a la majorité ? Comme entre cette monarchie et la République je ne vois, quelque effort que j’y fasse, aucune espèce de différence, si ce n’est celle que constitue l’existence d’une liste civile, par désir de ne point perdre mon temps et de ne point faire perdre le sien au lecteur je ne dirai pas un mot de la monarchie parlementaire.
Il convient donc que la France reste en République et ce serait, à mon avis, un immensurable dernier malheur pour elle qu’elle épuisât ses forces dans un essai de restauration monarchique contesté, traversé, entravé et très probablement éphémère et qui, s’il n’était pas éphémère, prolongerait d’autant les luttes, les traverses, les discordes intérieures et la déperdition des forces.
Soyons donc républicains ; mais qui dit républicain ne dit pas démocrate, ni surtout démocrate borné et superficiel, pour se servir des expressions de Renan. Il s’agit de faire une république viable et c’est-à-dire une république qui, comme toutes les républiques qui ont vécu, ait une base démocratique et contienne un élément aristocratique.
L’élément aristocratique existe dans la nation ; il existe toujours ; seulement le jeu, le paradoxe ou l’ironie des institutions peut être, qu’existant dans la nation, il soit très soigneusement éliminé de tous les pouvoirs gouvernants ; et c’est précisément ce qui se passe chez nous.
L’élément aristocratique dans une nation, c’est tout ce qui a eu assez de vitalité et de force de cohésion et de sentiment de sa responsabilité pour se grouper, s’associer, s’engrener, s’organiser, devenir une chose vivante et c’est-à-dire une personne collective. Un élément aristocratique c’est l’ordre des avocats ; un élément aristocratique (ou qui pourrait l’être avec une autre organisation et un autre esprit) c’est la magistrature ; un élément aristocratique c’est l’ordre des médecins ; un élément aristocratique c’est l’armée et je veux dire le corps des officiers ; un élément aristocratique ce sont les chambres de commerce ; un élément aristocratique ce sont les villes, tout au moins les grandes, qui sont de véritables personnes collectives, ayant leur passé, leurs traditions, leur amour-propre et le sentiment de leur responsabilité dans le temps, de leur responsabilité envers les ancêtres et envers les descendants ; un élément aristocratique (et ils le savent bien) ce sont les syndicats ouvriers.
Je ne donne que des exemples.
Tout ce qui dans la nation n’est pas purement individuel est élément aristocratique.
Ce sont ces éléments qui en France sont éliminés des pouvoirs publics. Détail curieux : par préoccupation de parti, dans la Constitution de 1875, pour la nomination du Sénat, ce qui a été presque éliminé ce sont les villes, alors que précisément, comme grandes personnes morales, elles devaient avoir une représentation plus considérable que celle des campagnes et l’auteur aristocratique de la Constitution de 1875 a fait sur ce point œuvre bassement démocratique.
Ce sont ces éléments aristocratiques qui devraient, par représentation élective, former, et exclusivement selon moi, la Chambre haute. La Chambre haute serait la représentation de tout ce qui dans la nation a de la cohésion, de la vitalité collective et le sentiment de la responsabilité collective. Et c’est la Chambre haute qui seule ferait fonction législatrice, ayant seule, à mon avis, qualité pour la faire.
A côté d’elle, la Chambre issue du suffrage universel, absolument nécessaire pour que les gouvernements sachent l’état de l’opinion populaire, aurait un droit de veto sur les lois faites par la Chambre haute ; car le peuple étant absolument incapable de savoir ce qu’il veut, mais très capable de savoir ce dont il souffre et ce qu’il ne veut pas, doit être en conséquence, représenté par des gens qui ne font pas les lois ; mais qui ont le droit de repousser celles dont ils ne veulent point.
Enfin le Président de la République, nommé, comme aux États-Unis par la nation en tant que nation constituée, c’est-à-dire, non par le suffrage universel direct, mais par le suffrage universel à deux degrés et par exemple, soit par les conseils généraux, soit plutôt par les conseils régionaux, provinciaux, aurait assez d’autorité pour avoir un avis dont on tiendrait compte, ne serait pas le simple serviteur du Parlement, ne serait pas un simple magistrat surnuméraire, un simple magistrat honoraire avant de quitter sa place et du moment même qu’il l’occupe, ne serait pas, dès le moment de son élection, un simple futur ancien président, ce qu’il est, sans rien de plus, sous le régime actuel ; mais aurait, par ses messages qu’il oserait écrire, par son droit de seconde délibération qu’il oserait exercer, par son droit de dissolution, même du Sénat, dont il oserait user, la prépondérance qu’il est nécessaire qu’un chef d’État exerce pour que la responsabilité gouvernementale soit ramassée quelque part.
Objection. Mais est-il vrai que dans la France actuelle les éléments aristocratiques que vous signalez soient réellement des éléments aristocratiques ? Quelle cohésion et quelle vitalité par cohésion offre la magistrature française et quelle personne collective constitue-t-elle ? Quelle personne collective trouvez-vous dans l’armée, quelle dans l’Université, quelle dans les Chambres de commerce, quelle dans les villes ? Ne trouvez-vous point qu’il n’y a de cohésion, de vitalité collective et de sentiment commun de la responsabilité nulle part, excepté peut-être dans le plus ancien et dans le plus nouveau des organismes corporatifs, c’est à savoir dans le clergé et dans les syndicats ouvriers ?
— L’objection est très juste. Il est bien évident que si la démocratie inorganique est dans les institutions c’est qu’elle est dans les faits et il serait bien étrange qu’elle fût dans les institutions sans qu’elle fût dans la réalité concrète. Si a priori et si idéologiquement que soient faites les institutions chez certains peuples, encore est-il que les faits, quand ils sont énormes, s’imposent à elles et en elles s’introduisent comme de force et que si des faits aristocratiques considérables et puissants existaient en France, bon gré, mal gré qu’en aurait eu le législateur, ils seraient entrés dans la législation.
Oui, c’est parce que les aristocraties naturelles et spontanées se sont relâchées et comme énervées en France qu’il n’en est pas tenu compte dans la Constitution ; c’est parce que la magistrature n’est plus guère qu’un corps de fonctionnaires obéissant comme le corps, très honorable du reste, des contributions indirectes, qu’il n’a pas paru qu’il y eût lieu de le considérer comme corps aristocratique ; c’est parce que l’Université, l’armée, les villes, le commerce ont une existence beaucoup plus officielle que personnelle et beaucoup plus d’État que de corporation, qu’elles n’ont pas pu passer, qu’il est assez naturel qu’elles n’aient pas pu passer aux yeux du législateur pour de grandes personnes collectives ; c’est parce que le peuple de France est un peu devenu « poussière humaine » et « tas de sable » selon les expressions consacrées chez les écrivains aristocrates, que la Constitution française ne tient pas compte des cohésions et des collectivités ; et c’est parce que le peuple de France est purement démos que son régime est démocratique.
— Et par conséquent c’est vous qui, en demandant une organisation aristocratique pour un peuple qui ne contient pas de forces aristocratiques, raisonnez a priori et en pur idéologue.
— Pardon, cependant ! J’ai parlé, non de forces aristocratiques, mais d’éléments aristocratiques, ce que je dis qui existe toujours. Ces corps sans puissante vie collective, existent cependant et sont des corps. Et quand ces corps existent et pourvu qu’ils existent, ce sentiment de vitalité collective et ce sentiment de responsabilité collective, on le leur donne ou on l’augmente en eux et de faible qu’il est on le fait fort, en leur accordant une grande importance et une grande place dans l’État.
La loi de la cause qui est effet et de l’effet qui est cause s’applique ici parfaitement. C’est parce que les éléments aristocratiques sont faibles dans la nation et parce que individu et corporation disent à l’envi : « Tout à l’État et que l’État fasse tout » et parce qu’il n’y a ainsi pas grande différence entre les corporations et les individus, c’est pour cela, c’est bien pour cela, que le régime est grossièrement démocratique ; mais aussi ce serait parce que des éléments aristocratiques, si faibles que j’avoue qu’ils soient, on tiendrait compte ; c’est parce que, les considérant, tels qu’ils sont, comme étant encore des forces sociales plus importantes que « la poussière », on leur confierait la part la plus considérable du gouvernement ; c’est pour cela qu’on développerait en eux le sentiment de la vitalité collective et de la responsabilité collective, qu’on leur donnerait une conscience, ou que de faible on ferait leur conscience forte et qu’on en formerait sans doute de très grandes et très considérables personnes morales.
Tout ce que je viens de dire est à mon avis parfaitement nécessaire pour constituer une république et pour qu’une république existe ; et tout ce que je sais d’histoire antique, d’histoire moderne et d’histoire contemporaine, je crois qu’il me le prouve ou tout au moins qu’il prouve beaucoup moins le contraire, ce qui est beaucoup ; mais je reconnais que ceux-là, sans avoir raison, ne sont pas dans le faux complètement qui disent que la Constitution importe peu et que la meilleure est encore celle que l’on a, si l’on sait s’en servir avec intelligence et avec la continuelle préoccupation de l’intérêt public. A le prendre ainsi, nous pourrions tirer un assez bon parti de la Constitution que nous avons, à la condition de la pratiquer selon son esprit et de ne pas substituer la Constitution « réelle », à la Constitution « légale ».
Nous avons un Sénat qui n’est pas du tout ce qu’il devrait être c’est-à-dire aristocratique dans le sens que j’ai donné à ce mot ; qui, étant donné l’organisation de ses collèges électoraux, n’est guère nommé que par les préfets, qui sera toujours le représentant du gouvernement, quel qu’il soit, plutôt que de la nation ; qui sera peut-être beaucoup plus « démocratique » que la Chambre des députés si l’on établit, pour le recrutement de celle-ci, le scrutin de liste avec représentation proportionnelle ; enfin nous avons dans le Sénat un très mauvais instrument législatif ; mais encore il représente la moyenne des idées rurales ; il est la Chambre des paysans ; il ne sera jamais socialiste ; il est composé constitutionnellement de gens âgés ce qui est une garantie de prudence relative ; il se renouvelle partiellement ce qui est une garantie d’ordre et de continuité dans les travaux ; il n’est pas très nombreux quoique encore il le soit trop et je ne voudrais pas en tout plus de cinq cents sénateurs et députés ; par l’effet d’un détail en apparence insignifiant de sa constitution, parce que le mandat de sénateur dure neuf ans, il est composé en partie de vétérans de la politique, les députés vieux se lassant de faire campagne électorale tous les quatre ans et ambitionnant un mandat législatif de longue durée. Enfin ce n’est pas un déplorable instrument politique.
Il prendrait certainement la prépondérance, si tout simplement il se l’attribuait ; s’il n’examinait pas le budget en quinze jours sous prétexte qu’il y a déjà onze douzièmes provisoires, s’il ne craignait pas d’inviter le président à exiger une seconde délibération d’une mauvaise loi votée par la Chambre, s’il ne craignait pas d’inviter le président à dissoudre la Chambre des députés quand l’appel aux électeurs est évidemment indiqué ; en un mot s’il ne redoutait pas jusqu’à une sorte de terreur les conflits, comme si par tout pays à gouvernement parlementaire il n’y avait pas deux Chambres précisément pour qu’il y ait conflits, c’est-à-dire pour que les lois votées par une Chambre soient contrôlées par l’autre, d’où unanimité quand elles sont bonnes et conflit quand elles sont mauvaises.
Mais, et cela est bien curieux, la superstition démocratique est si forte que le Sénat, parce qu’il est élu par le suffrage universel à deux degrés, comme les Assemblées de la Révolution, au lieu de l’être par le suffrage universel direct comme la Chambre, se croit, se sent moins légitime et a toujours peur qu’on lui reproche son origine et qu’on lui en fasse honte et il semble continuellement en rougir d’avance.
Le président, enfin, a des pouvoirs assez étendus ; le fait seul qu’il les ait, constitutionnellement, lui indique qu’il doit se mêler à la vie politique, ne pas se résigner et se réduire à faire façade ou à circuler avec pompe dans les provinces et les colonies et à être le voyageur de la République. Il est constitutionnellement le directeur de la politique nationale ; c’est ce rôle qu’il doit jouer avec discrétion, avec tact, mais qu’il doit jouer. Sans imposer son opinion, excepté, et dans les formes constitutionnelles, aux occasions tout particulièrement exceptionnelles, il doit faire qu’elle soit toujours connue. L’opinion présidentielle, le plus souvent, ne sera qu’une opinion, mais une opinion considérable, importante, une opinion venant de haut et qui aura un grand poids, non pas directement dans la délibération, mais dans l’opinion d’abord, ensuite dans l’esprit de chacun des sénateurs et des députés, par suite et en définitive dans les délibérations elles-mêmes et dans les décisions elles-mêmes.
Il faut, sur chaque question considérable, que l’opinion du président soit connue de tous. On assure qu’un ancien président de la République française a dit, parlant du temps où il était en charge : « Je me suis tu constitutionnellement. » Ne la voilà-t-il pas bien la superstition qui règne dans les mondes politiques relativement à la Constitution « réelle » ? Quoi ! La Constitution qui donne au Président le soin de nommer les ministres et de présider les délibérations du Conseil de ministres et de provoquer des secondes délibérations des Chambres, etc. etc., cette Constitution impose au président le silence ! La Constitution est de se taire ! Et, comme il est absolument impossible de penser sans parler et également impossible de prendre l’habitude de se taire sans perdre celle de penser, la Constitution veut que le président ne pense pas ? Voilà qui est bien étrange.
Je conviens que si l’ancien président a voulu dire : « La Constitution me donnait le droit de ne pas parler », il est incontestablement dans le droit ; mais tout indique qu’il a voulu dire : « La Constitution m’imposait le devoir de me taire » et voilà qui est singulier. On a dit que le silence des peuples est la leçon des rois ; mais on ne conçoit pas comment le silence des rois pourrait être la leçon des peuples et les rois doivent aux peuples les leçons qu’ils pensent leur donner. Or les familiers du président dont nous parlons savaient sûrement que ce président n’était point de l’avis de son premier ministre ; il était important pour l’instruction des parlementaires et de tous, pour que l’on pût faire là-dessus les réflexions convenables et utiles, que cette divergence, sans être étalée, fût connue.
Le président est donc invité par la Constitution à jouer un rôle et en conscience il devrait le jouer.
Il est vrai que sénateurs et députés, jaloux d’être seuls gouvernants, ont une tendance à nommer président de la République un personnage, très honorable toujours, mais effacé et, par son âge ou par son caractère, volontiers nonchalant ; c’est ce qu’ils ont fait souvent et il y a à gager que désormais c’est ce qu’ils feront toujours. Le désir d’être puissant sans être responsable crée celui de ne placer au premier poste que quelqu’un qui ne soit pas responsable non plus et ne veuille point l’être.
Enfin la magistrature, même constituée comme elle l’est, pourrait, recherchant, honnêtement et sans impatience, mais recherchant les responsabilités au lieu de les fuir, jouer un rôle très considérable, très utile et celui qu’elle doit faire. Sans doute, ici, il faut dire que sa constitution elle-même invite la magistrature à s’effacer et à n’être qu’un agent docile du gouvernement. Le grand vice de la magistrature en France c’est qu’elle est une carrière, comme l’enregistrement, qu’on y entre jeune et à très minces émoluments et qu’on y avance lentement comme partout si l’on se borne à faire bien son service et rapidement comme partout, si l’on rend des services au gouvernement. Donc on y recherche l’avancement ; on est dominé par le soin de l’avancement et l’on fait souvent ce qu’il faut pour l’obtenir.
En Angleterre la magistrature n’est pas une carrière ; elle est le couronnement d’une carrière. Sont nommés magistrats de vieux avocats qui ont fait toute leur carrière, et illustre, dans le barreau et qui y ont contracté des habitudes d’indépendance qu’ils ne perdent point et qui du reste n’ont aucune raison de désirer l’avancement puisqu’ils n’avancent pas ou très peu. En un mot le métier de juge est une retraite, très brillante et par parenthèses largement pourvue ; mais c’est une retraite ; le juge anglais a toutes les raisons du monde d’être parfaitement indépendant.
On voit que les bons effets ne tiennent pas toujours, ne tiennent pas absolument à l’institution, mais tiennent beaucoup plus aux pratiques. Il n’y aurait aucune raison en Angleterre pour que l’on ne fît pas de la magistrature une carrière ce qui entraînerait tous les inconvénients que l’on voit que la chose a ici ; seulement on ne le fait pas, par habitude prise, par mœurs, peut-être par sentiment confus qu’il n’est pas de la dignité de la magistrature que la magistrature soit une carrière et dès lors, sans qu’il y ait le moindre texte de loi sur cette affaire, on a une magistrature excellente.
Je dis pourtant que même avec une constitution légale de la magistrature, qui est mauvaise, ou même avec l’habitude, qui est mauvaise aussi, de faire de la magistrature une carrière comme une autre, la magistrature serait excellente si elle voulait l’être. Il lui suffirait d’avoir, mais collectivement, mais tout entière ou presque tout entière, le sentiment de sa responsabilité, qui est immense, le sentiment qu’elle n’est rien de moins que la clef de voûte d’un pays libre ; que le citoyen ne sera libre, c’est-à-dire utile, que s’il sent que son bon droit sera reconnu et sera soutenu contre le pouvoir central par un pouvoir parfaitement indépendant et impartial. Une magistrature qui serait pénétrée de cette idée s’assurerait son indépendance en la prenant, en l’affirmant, en l’exerçant. Quelque avide que puisse être le gouvernement de toute autorité et de toute omnipotence, il ne pourrait pas « épurer » la magistrature tous les six mois et il faudrait bien qu’il subît une magistrature indépendante, impartiale et austère.
Les bonnes institutions sont une chose excellente ; mais on rend bonnes, dans la pratique, même les mauvaises par la manière dont on en use. En particulier il n’importe presque pas que l’indépendance ne vous soit pas assurée par la loi si l’on est indépendant de son naturel et si l’on est un corps composé d’individualités qui de leur naturel sont indépendantes et ne se laissent pas mener.
Nous avons donc une Constitution que, certes, il faudrait corriger ; mais qui, même telle qu’elle, ne serait pas plus mauvaise qu’une autre ou dont on ne sentirait pas les imperfections, si nos caractères étaient meilleurs, plus fermes, plus élevés et plus autonomes. Et ceci nous amène aux dernières considérations générales que nous avons à présenter au lecteur.
Le caractère français n’est pas à la hauteur de l’esprit français et c’est de là que vient tout le mal. L’esprit français est de tout premier ordre. Comme créateur d’idées, comme conquérant de la connaissance, comme créateur de beauté, aucun esprit dans le monde n’a plus de valeur que l’esprit français et peut-être n’en a autant. Le caractère français est défectueux. « Il y a en France, disait Renan, autant de gens de cœur et de gens d’esprit que dans aucun autre pays ; mais tout cela n’est pas mis en valeur. » Pourquoi tout cela n’est-il pas mis en valeur ? Qu’est-ce qui manque pour que tout cela y soit mis ? Le caractère, la volonté.
Nous sommes légers, nous sommes sans persévérance, sans obstination, sans ténacité. Nous sommes prompts à l’abandonnement. Nous sommes enfants, nous sommes vieillards, nous ne sommes jamais — je parle de la majorité — dans la force de l’âge. Sans être des paresseux et tant s’en faut, nous aimons à nous reposer sur ceux qui nous font travailler ; c’est le paradoxe de notre nature ; nous aimons à nous abandonner à l’État en acceptant qu’il nous impose même de lourdes tâches. Le fond de cette inclination paradoxale c’est le manque de volonté personnelle et ce manque de volonté personnelle vient lui-même de l’horreur des responsabilités.
Ce n’est pas tant que nous ne voulons pas agir que ce n’est que nous ne tenons pas à ce qu’on nous impute les effets de l’action. Nul plus que nous n’aime à dire : « Je m’en lave les mains ; ce n’est pas ma faute ; que voulez-vous que j’y fasse ? Je n’y puis rien, puisque je ne suis rien. »
Nous avons été façonnés ainsi par deux siècles de despotisme brillant et dont nous ne laissions pas, non sans quelque cause, du reste, d’être fiers. Nous nous sommes habitués à ne nous compter pour rien et à compter que tout se fait par tous sans que personne y contribue. Cela est naturel parce que tout se faisait autrefois par la royauté sans qu’aucune initiative partît des individus. Nous nous imaginons maintenant que tout se fait par la collectivité sans qu’aucun des individus dont la collectivité se compose ait une volonté d’acte. Tous ont remplacé un et il n’y a rien de changé.
Mais précisément tout est changé et une démocratie ne peut pas par elle-même, en soi, et par ce seul fait qu’elle existe, remplacer une volonté centrale et une intelligence centrale. Il faut qu’elle tire de son sein ou que de son sein se tirent des individus qui sachent vouloir. Des individus qui savent vouloir, qui acceptent les responsabilités et qui aiment la responsabilité et qui s’unissent dans une pensée et une volonté commune et qui acceptent et aiment des responsabilités communes, ce sont des aristocrates.
D’où il suit qu’une démocratie ne peut vivre qu’à la condition de tirer d’elle des aristocraties ou de souffrir que des aristocraties se tirent d’elle.
Cela paraît singulier ; mais rien n’est plus certain. La vitalité des démocraties se mesure à la force génitrice d’aristocraties qu’elles portent en elles.
Et encore il ne suffit pas, comme je me laissais aller à le dire pour un instant, que les démocraties souffrent qu’il sorte d’elles des collectivités aristocratiques ; il faut que les démocraties soient aristocratiques elles-mêmes en ce sens qu’elles aient en elles-mêmes de la volonté et du goût de la volonté. Il faut que les individus qui les composent aient le sens du vouloir individuel, de la persévérance individuelle, de la ténacité individuelle ; car c’est seulement à cette condition qu’elles comprendront les qualités de leurs aristocraties et les supporteront et les soutiendront et les aimeront, tout en les surveillant.
Une nation est une armée qui aime son état-major parce qu’elle comprend les qualités et les vertus de son état-major et elle ne les comprend que si elle les a elle-même à l’état rudimentaire mais très réelles et déjà fortes. Une nation est une collection de volontés et une organisation de volontés. La collection de volontés c’est elle-même ; l’organisation de volontés c’est les aristocraties qu’elle s’est données et qu’elle approuve et félicite d’avoir des volontés fermes. La volonté du peuple doit être que ses chefs aient de la volonté.
Je répète souvent ce mot d’un candidat dans une comédie : « Citoyens, tout ce que vous voudrez, je le voudrai encore plus que vous. » La réponse des citoyens devrait être : « J’ai une volonté et cette volonté est que vous ayez une volonté et que vous sachiez ce que vous voulez. »
Le goût des responsabilités est le respect de soi-même et le respect de la collectivité dont on fait partie. Il faut savoir, individu se respecter soi-même, collectivité respecter sa conscience collective et le devoir qu’elle vous impose, nation respecter sa conscience nationale et le devoir national qui est de vivre libres à l’intérieur et à l’extérieur. Le désir secret de compter chacun sur un autre, sur d’autres ou sur tous les autres est une démission et une désertion. Nous avons trop de démissionnaires par indifférence et de déserteurs par inertie.
Il faut réagir contre ce défaut national que la douceur naturelle de nos mœurs a fait naître et que de longs âges de despotisme ont entretenu comme avec soin. Ne dites jamais : « Ce n’est pas ma faute », c’est la faute de tous, même des plus humbles. Ne dites jamais : « Je n’y puis rien ». On y peut toujours quelque chose, ne fût-ce qu’en donnant l’exemple de l’énergie personnelle et en cherchant autour de soi d’autres énergies, même très obscures, auxquelles on puisse associer la sienne ce qui forme un noyau de force sociale.
Je ne dirai pas : le royaume d’ici-bas est aux énergiques et à ceux qui ne craignent pas qu’on leur fasse des reproches. Il ne s’agit pas de régner, il s’agit de vivre. On ne vit que par la volonté. Gœthe disait : « On ne meurt que quand on renonce à la vie ; on vit tant que l’on veut vivre. » Ce n’est peut-être pas tout à fait vrai des individus ; mais c’est vrai des peuples. Nietzsche a beaucoup parlé de la volonté de puissance. Il y a beaucoup à dire là-dessus ; mais il est une volonté de puissance qu’on ne saurait trop recommander et souhaiter à tous ceux qu’on aime, à commencer par soi, c’est la volonté de puissances sur soi-même.
| Les Idées et mœurs juridiques | |
| Professions | |
| Dans la famille | |
| Dans les mœurs politiques | |
| Pour chacun de nous |
ACHEVÉ D’IMPRIMER LE
30 OCTOBRE 1929 PAR
L’IMPRIMERIE FLOCH,
A MAYENNE (FRANCE).